Coordinateurs : Jean-Marie Guillouët et Christian Stein
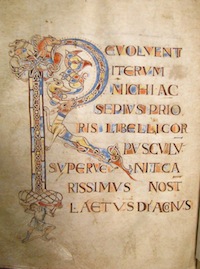


Les sociétés humaines sont des sommes de communautés qui s’emboîtent ou se superposent de manière plus ou moins harmonieuse. La vocation de cet axe est de rassembler des travaux et projets consacrés à l’émergence et au fonctionnement de ces liens communautaires en tant qu’ils structurent des relations individuelles ou collectives de toutes natures et à toutes les échelles, cités, États, peuples, sectes religieuses, etc. L’ensemble de ces relations s’effectue également dans un cadre spatial qui est toujours organisé, monumentalisé ou élaboré imaginairement dans le but de construire, de soutenir ou de nier des identités et des mémoires collectives.
Plusieurs grandes directions seront particulièrement explorées en parallèle. Il y a d’abord celle des outils de la construction communautaire, puis celle des manifestations de cette dernière. Dans l’un et l’autre cas, les deux versants de ces constructions seront au cœur des travaux de l’axe 1 : les identités positives aussi dites choisies ou d’appartenance comme les identités négatives, contestées ou imposées. Enfin, ces questions ne pourront pas être posées sans que soient pris en considération les lourds et importants enjeux historiographiques charriés par les études historiques comme archéologiques et par les récits mobilisés pour raconter comme pour publiciser ces communautés.
Programmes et outils de l’axe « Élaboration du passé et constructions communautaires »
CARE. Corpus Architecturae Religiosae Europae IV-X saec. (P.Chevalier)
Le programme français du Corpus architecturae religiosae europeae (IV-X saec.) [CARE] – financé par l’ANR pour 2008-2011 – a tenu compte des impératifs fixés par l’ensemble des équipes des pays impliqués dans le vaste projet européen initié en 2002 par l’IRCLAMA de l’Université de Zagreb (Croatie). L’Italie, l’Espagne, la République Tchèque, la Slovaquie, la Pologne et la Croatie ont commencé depuis quatre à cinq ans les travaux préparatoires à cette ambitieuse entreprise ; la Hongrie s’est jointe en 2008 au groupe centre-européen ; le Benelux et l’Irlande ont amorcé leur corpus en 2009-2010 ; le Royaume Uni en 2012 et en 2017 l’Albanie travaillera avec le Kosovo et le Monténégro ; le Portugal, la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie sont intéressées. La Suisse, l’Allemagne, l’Autriche et la Slovénie où des inventaires complets ont été publiés très récemment participent depuis 2011 à l’alimentation de la base de données en ligne. Le travail le plus avancé pour la publication papier est celui des Italiens du Nord. Fort d’études de fouilles récentes, le corpus français a trouvé un rythme de croisière et des protocoles couvrant l’ensemble des édifices compris dans les diverses tranches chronologiques, en mettant l’accent sur les VIIe-VIIIe siècles plus difficiles à appréhender et les décennies très riches en monuments précédant ou suivant l’an Mil, mais aussi sur les évolutions des sites les plus anciens dans la longue durée.
C’est à la France qu’est revenue la tâche de mettre au point la base de données informatique en ligne que tous partageront (c’est notamment déjà le cas de l’Italie, de la Belgique, de la Croatie, de l’Irlande et du Royaume uni) après traductions en anglais et dans les langues choisies par les pays ou groupes de pays. Le Corpus d’informations textuelles et graphiques concernant chaque édifice connu est ainsi progressivement publié région par région sur ces bases de données en ligne à l’architecture commune, hébergées collectivement sur la ([www.huma-num.fr/ TGIR Huma-Num]). À terme, ce Corpus facilitera les travaux de comparaisons, les échanges et discussions, et ouvrira sur le Web à un très vaste public des pans peu connus de notre patrimoine et du patrimoine religieux européen antérieur à l’an Mil, en particulier pour les travaux archéologiques récents.
Le lancement du projet CARE à l’UMR 5594 du CNRS (Dijon), devenue depuis l’UMR 6298, date du 1er janvier 2008 après acceptation de l’Agence Nationale pour la Recherche, pour les 4 années 2008-2011. La collecte et l’analyse des données sur environ 2700 monuments se poursuit depuis et réunit actuellement plus de soixante chercheurs en poste dans une vingtaine d’universités, au sein de diverses institutions de recherche ou de gestion du patrimoine, ainsi que des archéologues de terrain, des étudiants en master, des doctorants et post-doctorants, des dessinateurs topographes, etc. Le développement de la base de données a été assuré par le Laboratoire Le2i de l’Université de Dijon et la cartographie par la MSH de Dijon.
Le projet vise à établir des fiches relatives aux édifices religieux au sens large – pas seulement des églises – ayant fait l’objet d’études archéologiques. L’objectif est d’arriver, par une sélection de champs à remplir qui décortiquent de manière analytique les vestiges, à faciliter les lectures comparées. Pour ce faire, une charte graphique a été établie pour la périodisation des phases de construction, encourageant comme la partie rédigée de chaque fiche des discussions critiques qui insistent sur la justification des datations proposées.
DicoTopo : Le dictionnaire topographique de la France (M-J Gasse-Granjean et C.Mordant)
Le Dictionnaire topographique de la France est une entreprise éditoriale et scientifique lancée au XIXe siècle par le Comité des Travaux historiques et scientifiques (CTHS), visant à rassembler l’ensemble des noms de lieux anciens et modernes de la France entière. Forte de trente-cinq volumes départementaux, la collection qui en est issue, publiée par le CTHS, fait depuis 2009 l’objet d’un projet de réédition électronique visant à en rendre progressivement accessible l’ensemble des données.
Ce programme national est animé par le Comité des travaux historiques et scientifiques avec le concours de l’UMR 6298 ARTEHIS de Dijon, de l’Ecole nationale des Chartes, du Centre d’Onomastique des Archives nationales et de la MSH de Dijon. Il est soutenu par le Service interministériel des Archives de France (SIAF).
Lire César au XXIe siècle (S.Lefevbre)
Une équipe pluridisciplinaire a été constituée, rassemblant latinistes et historiens :
- Coudry Marianne, Université de Haute-Alsace, UMR 7044 ARCHIMEDE ;
- Cogitore Isabelle, Université Grenoble Alpes, UMR 5316 Litt&Arts-Translatio ;
- De Giorgio Jean-Pierre, Université de Clermont Ferrand, EA 4280 CELIS ;
- Lefebvre Sabine, Université de Bourgogne-Franche-Comté, UMR 6298 ARTEHIS ;
- Wyler Stéphanie, Université de Paris Diderot-USPC, UMR 8210 ANHIMA.
Axe thématique d’ARTEHIS de rattachement : CORPUS
Participant(s) d’ARTEHIS : S. Lefebvre
Durée : 2016-2020
Résumé : /
MEMBRES de l’EQUIPE
Abert Franck Barbier
Barbet-Massin Dominique
Bardey David
Josiane Bardey
Baudry Georgie
Büttner Stéphane
David Belot Antoine
Bully Aurelia
Clouzot Martine
Deflou-Leca Noëlle
Dubuc Cécile
Duval Colin
Frénéat Adrien
Gasse-Grandjean Marie-José
Guillouet Jean-Marie
Janin Marie-Anaïs
Jouquand Maïwenn
König Gaëtan
Kossmann Perrine
Lefebvre Sabine
Lesmesle Bruno
Londiveau Gaël
Mastrorosa Ida Gilda
Mercuri Laurence
Montagné Geoffroy
Mouillebouche Hervé
Rehbi Oussama
Rameau Bapstiste
Stein Christian
Tabbagh Vincent
Thabarant Bernie
Vincent Marion