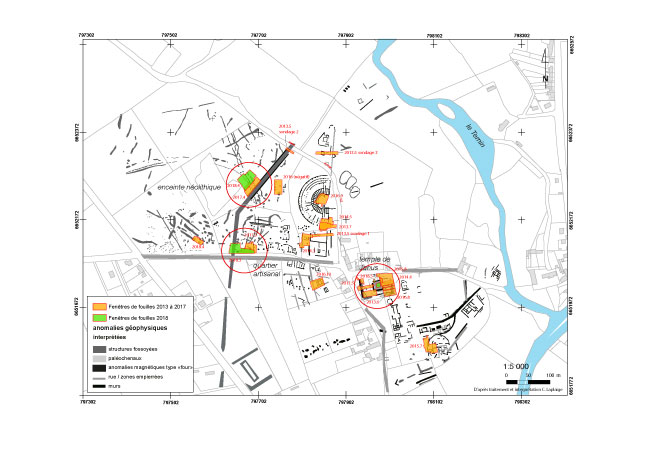Saint-Dizier « Les Crassées » (Haute-Marne) : bilan du troisième programme triennal / Campagnes 2021-2023

Dates de fouille : du 25 mai au 09 juillet 2021, du 30 mai au 08 juillet 2022 et du 30 mai au 07 juillet 2023 Responsables : Raphaël Durost (Chargé de recherches, Inrap, UMR 6298 ARTeHIS), Stéphanie Desbrosse-Degobertière (Chargée de recherches, Inrap, UMR 6273 CRAHAM) Collaborateurs : Anne Delor-Ahü (Inrap, UMR 7041), Serge Février, Valentin Miclon (UMR 6273 CRAHAM), Mikaël Sévère, Pierre Testard (Inrap), Marie-Cécile Truc (Inrap, UMR 6273 CRAHAM) La campagne de 2023 était la dernière avant une période de plusieurs années destinée à produire une publication monographique des résultats. Le contenu des trois dernières campagnes est dans le prolongement des précédentes, qui ont eu lieu chaque année depuis 2011 (excepté en 2020). L’étude des aménagements non funéraires des deux aires de fouille ouvertes depuis dix ans s’est achevée en 2021, ce qui a permis de s’étendre au secteur intercalé entre les deux aires, sur le versant de la vallée, et d’atteindre une surface 2 300 m². L’occupation couvre les douze premiers siècles de la période historique. Figure 1 : Plan chronologique simplifié au terme de la campagne de 2023 L’occupation gallo-romaine se manifestait déjà par deux bâtiments résidentiels en dur, l’un au sud, au sommet du versant, utilisé à une date inconnue, et l’autre en contrebas, au nord, bâti au milieu du IIIe siècle et abandonné à la fin du IVe siècle. Figure 2 : Plan simplifié de l’occupation gallo-romaine Les trois dernières campagnes permettent de connaitre le premier dans son intégralité (385 m²), sans pour autant arriver à fixer sa chronologie et la fonction de chacune de ses pièces tant l’occupation funéraire postérieure bouleverse les strates antiques. Rappelons toutefois qu’une pièce au moins bénéficie d’un chauffage par hypocauste, dont l’affaissement a piégé plusieurs milliers de tesselles d’une mosaïque noire et blanche, et que le sol d’une autre conserve les lambeaux d’une épaisse dalle de mortier, peut-être celle d’une piscine. L’exploration intégrale de la salle centrale, qui borde les deux précédentes, constitue le principal acquis des campagnes récentes. Bien que son niveau de circulation soit particulièrement plus encaissé, sa réutilisation en chapelle funéraire mérovingienne nous prive de toute la stratigraphie antique. L’arase de son sol garde néanmoins la trace d’un bassin polygonal de 3,4 m², maçonné au mortier hydraulique, au centre de la pièce. Un caniveau de vidange lui est appuyé et traverse le bâtiment pour déverser son contenu à l’extérieur. Sa fonction n’est pas connue. Il peut tout autant s’agir d’un bassin ornemental, balnéaire ou cultuel. Figure 3 : Moitié conservée du bassin polygonal gallo-romain. Les murs qui l’entourent sont mérovingiens L’état de conservation du second bâtiment est bien meilleur puisque l’occupation funéraire médiévale ne l’atteint pas et que la stratigraphie au pied du versant n’est pas érodée (elle atteint en moyenne 1,60 m d’épaisseur). Les 282 m² étudiés correspondent à l’extrémité sud du bâtiment, consacrée aux bains. Les trois dernières campagnes ont permis d’achever la fouille des deux praefornia et des bordures extérieures est et ouest de l’édifice. L’étude de la bordure sud n’est quant à elle pas achevée. À cet endroit, une allée composée de deux rangées de dalles part de la galerie qui borde la façade orientale, et se dirige vers le sud pendant 7 m. Elle permet sans doute d’assainir un cheminement sur le versant très humide. Les données chronologiques obtenues confirment l’occupation du bâtiment du milieu du IIIe siècle jusqu’à la fin du IVe siècle. Figure 4 : dalles de l’allée gallo-romaine liée au bâtiment nord Ces deux bâtiments appartiennent probablement à un établissement rural aisé, dont l’essentiel de l’assiette nous échappe. La découverte d’un qanât antique postérieur au bâtiment sud le démontre. L’aire étudiée en atteint un segment linéaire de 30 m de longueur qui traverse en diagonale le haut de la pente, et dont seuls 4 m sont fouillés. À cet endroit, il forme une tranchée de 2 m de profondeur creusée dans les alluvions grossières, jusqu’à atteindre l’étage d’argile plastique sous-jacent, en surface desquelles l’eau ruisselle abondamment sur tout le versant. L’immersion permanente a permis la conservation de deux tronçons de caniveau en chêne, déposés l’un derrière l’autre dans l’axe de la tranchée. Cet aménagement est donc destiné à drainer les eaux souterraines vers le nord-est, en contrebas. Un tel investissement doit servir à alimenter une installation économique ou ornementale conséquente, illustrant la part d’inconnu qui persiste malgré plus de dix campagnes de fouille. Figure 5 : caniveau en chêne du qanât gallo-romain Figure 6 : plan simplifié de l’occupation mérovingienne L’occupation du Ve siècle ne se manifeste pour l’heure que par du mobilier détritique dans les niveaux d’abandon. L’aménagement médiéval le plus ancien reste une sépulture aristocratique du début du VIe siècle, implantée dans la bâtiment antique sud, en bordure de la salle profonde dotée du petit bassin. Les campagnes récentes révèlent qu’au VIIe siècle, cette pièce est déblayée et surmontée d’une élévation en dur, sans trace de mortier, munie d’une entrée dans le côté nord. L’installation en son sein d’une femme adulte inhumée en sarcophage, contre l’angle nord-est, révèle la vocation funéraire de l’édifice. L’agglomération de la plupart des sépultures mérovingiennes autour de lui et de la sépulture mitoyenne du VIe siècle, exprime quant à elle l’importance spirituelle du lieu. Hélas, en dehors de ce sarcophage préservé grâce à l’effondrement de l’élévation, le reste du contenu de la salle est bouleversé par un creusement postérieur à l’occupation funéraire, manifestement destiné à visiter en détail la pièce. Les fragments d’armes et de bijoux mérovingiens rencontrés dans le sédiment laissé par les visiteurs, ainsi que les nombreux restes humains, laisse deviner la nature des dépôts détruits. Figure 7 : Photogrammétrie (© M. Sévère) du réaménagement en chapelle funéraire (teinte rouge) de la salle gallo-romaine (teinte jaune) Un total d’un peu plus d’un millier d’inhumations est étudié au terme des trois dernières campagnes (voir la première figure). Elles se concentrent toujours plus autour des deux édifices de culte du Xe au XIIe siècle qui succèdent à la chapelle mérovingienne. L’accumulation d’individus inhumés jusqu’au XIIe siècle contre cette dernière, probablement reconstruite durant la période carolingienne, montre l’attractivité qu’elle exerce jusqu’à l’abandon du cimetière. L’ouverture du secteur située entre les deux aires de fouille antérieures permet d’atteindre la limite septentrionale du cimetière. Deux aménagements successifs y matérialisent la rupture de pente du versant. Le premier est fossoyé et le second en élévation, en pierres sèches. L’organisation des sépultures suggère qu’elles tiennent compte de cette limite : bien qu’elles en occupent les deux côtés, l’implantation des plus proches forme deux lignes qui lui sont parallèles. Il semble qu’une distance minimale constante soit respectée de part et d’autre. Ce constat est toutefois déroutant puisqu’il conclut à la fois au respect du marqueur parcellaire, et à la fois à son franchissement. La plupart des sépultures ne contient aucun mobilier. L’évolution chronologique du plan du cimetière est donc très difficile à établir, d’autant plus que les chevauchements ne dépassent jamais quatre tombes successives. Les mesures archéométriques réalisées à ce jour sur 68 individus montrent toutefois une augmentation démographique à partir du Xe siècle puisque 47 des fourchettes de datation excluent les siècles antérieurs. L’aire fouillée témoigne également de constructions non funéraires durant cette période. En dehors des trous de poteau, dont la répartition ne permet hélas de dégager aucun plan architectural cohérent, six cabanes artisanales semi-excavées sont présentes. Deux d’entre elles sont implantées dans le cimetière et les quatre autres plus au nord. Le creusement des deux premières provoque la destruction d’inhumations antérieures puis, après leur abandon et leur colmatage, elles sont elles mêmes entamées par de nouvelles sépultures. Ces structures témoignent d’une conception du cimetière comme un espace polyvalent, apte à accueillir le travail destructeur d’artisans. Faute d’éléments chronologiques précis pour le moment, il n’est pas encore possible de déterminer si les sépultures détruites sont visibles depuis la surface à ce moment-là, mais il est évident que les squelettes rencontrés par les terrassiers suffisent à les signaler. Le projet artisanal ne s’interrompt pas pour autant. Par ailleurs, les manipulations habituelles des restes osseux rencontrés par les fossoyeurs de nouvelles inhumations ne sont pas possibles dans de telles cabanes : le squelette ne peut être ni réduit dans un coin de la fosse, ni rapidement reversé en vrac dedans. Les os exhumés doivent nécessairement subir un autre traitement, à l’écart de leur emplacement d’origine. Figure 8 : cabane artisanale semi-excavée du XIe ou XIIe siècle, implantée dans le cimetière contemporain
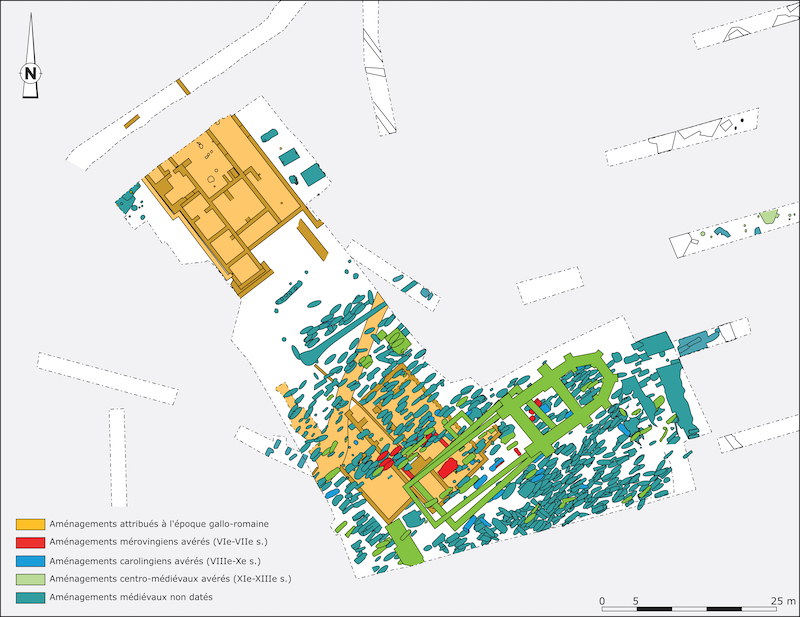
L’occupation gallo-romaine
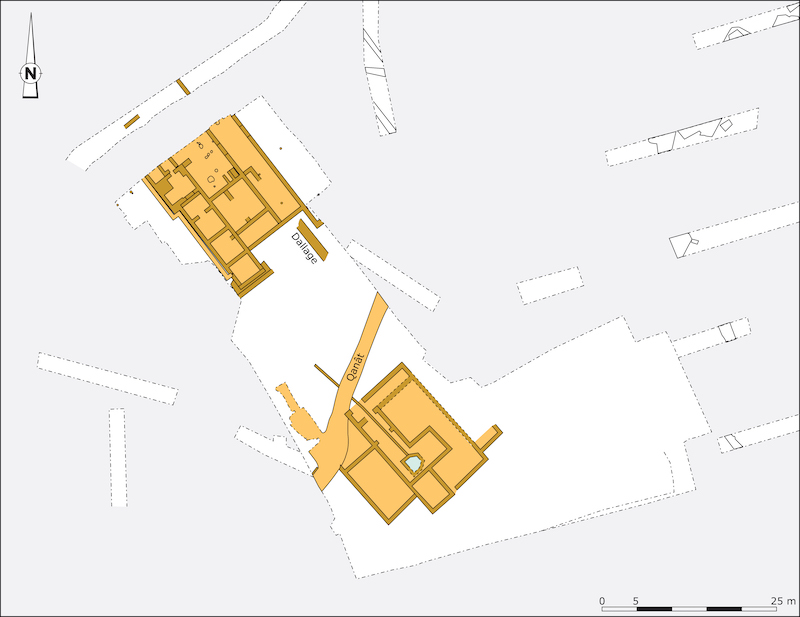



L’occupation mérovingienne


L’occupation carolingienne et centro-médiévale

Complexes monastiques et ecclésiaux de l’archipel du Kvarner (Croatie) / campagne 2023 sur le site de Martinšćica (île de Cres)

Responsables : Sébastien Bully (CNRS-UMR ARTEHIS) et Morana Čaušević-Bully (université de Bourgogne Franche-Comté-UMR Chrono-environnement) Participation au chantier : Dates du chantier : Financements : Résultats : Un second temps de la mission a été consacré à des prospections géophysiques (GPR et magnétomètre) dans l’environnement plus ou moins proche du complexe, révélant, peut-être, des structures de la pars rustica de la villa dans le secteur dit de la baie. Dans ce même secteur, une importante couche de dépôt de murex observée dans une coupe du terrain sur la grève indique un très probable atelier de production du pourpre. Nous avons également pu mener les prospections géophysiques sur le site de Mirine qui avaient été initialement projetées en 2022. Les prospections ont porté sur une large emprise autour du complexe paléochrétien et de la villa de l’Antiquité tardive, permettant de circonscrire en partie son emprise. Fouillée entre 2015 et 2020, la villa a fait l’objet cette année d’une seconde et dernière campagne de travaux de conservation. En parallèle, l’article de synthèse sur l’abondant mobilier amphorique mis au jour lors des fouilles de la villa a été finalisé par Adrien Saggese et sera prochainement proposée à la revue Prilozi de l’Institut Archéologie de Zagreb. 4- Carte géophysique de Martinšćica (cartes géophysiques : F. Welc ; infographie L. Fornaciari et A. Stock, d’après S. Bully et M. Čaušević-Bully)Mission archéologique franco-croate du ministère des Affaires étrangères
ANR MONACORALE (WP 2) / École française de Rome
Ministère des Affaires étrangères français, Ministère de la Culture croate, ANR MONACORALE
Pour cette première année du nouveau programme quadriennal du MEAE, la campagne 2023 a porté sur le site de Martinšćica (île de Cres) et dans une moindre mesure sur le site de Mirine (île de Krk). Concernant le dossier principal de Martinšćica, nous avons achevé la fouille de la grande église paléochrétienne en menant à terme celle de son vestibule interne (VIa) dont il subsistait encore trois tombes à étudier. Cependant, après un important travail de déboisement, la fouille a surtout porté sur l’espace VIb – interprété jusqu’alors comme un vestibule externe –, sur le « parvis » de l’église (espaces VIc et e) et sur le secteur au sud des « vestibules » (VId). Cette première campagne portant sur les parties occidentales de l’église – sur une surface d’environ 180 m2 –, a révélé des dispositifs et des formes d’occupations insoupçonnés jusqu’alors. On retiendra principalement la découverte d’un large et long portique desservant l’église dans une phase précoce, révélant une relation étroite et monumentale avec la villa maritime de l’Antiquité tardive. Le portique est ensuite remplacé en plusieurs états successifs par des constructions à caractère artisanal et domestique : four à pain, foyers, canalisations, pot de stockage, latrines (?), etc. Ces structures, stratigraphiquement complexes, demandent pour la plupart une finalisation de leur fouille afin de s’assurer de leur phasage et de leur interprétation, mais elles renforcent l’hypothèse de l’installation d’une communauté monastique sur le site. 1- Localisation des interventions sur l’environnement du complexe (cl. S. Bully)
1- Localisation des interventions sur l’environnement du complexe (cl. S. Bully) 2- Les parties occidentales de l’église paléochrétienne à l’issue de la campagne (cl. S. Bully)
2- Les parties occidentales de l’église paléochrétienne à l’issue de la campagne (cl. S. Bully) 3- Prospections géophysiques par GPR et magnétomètre menées sur les sites de Martinšćica et de Mirine (cl. S. Bully)
3- Prospections géophysiques par GPR et magnétomètre menées sur les sites de Martinšćica et de Mirine (cl. S. Bully)
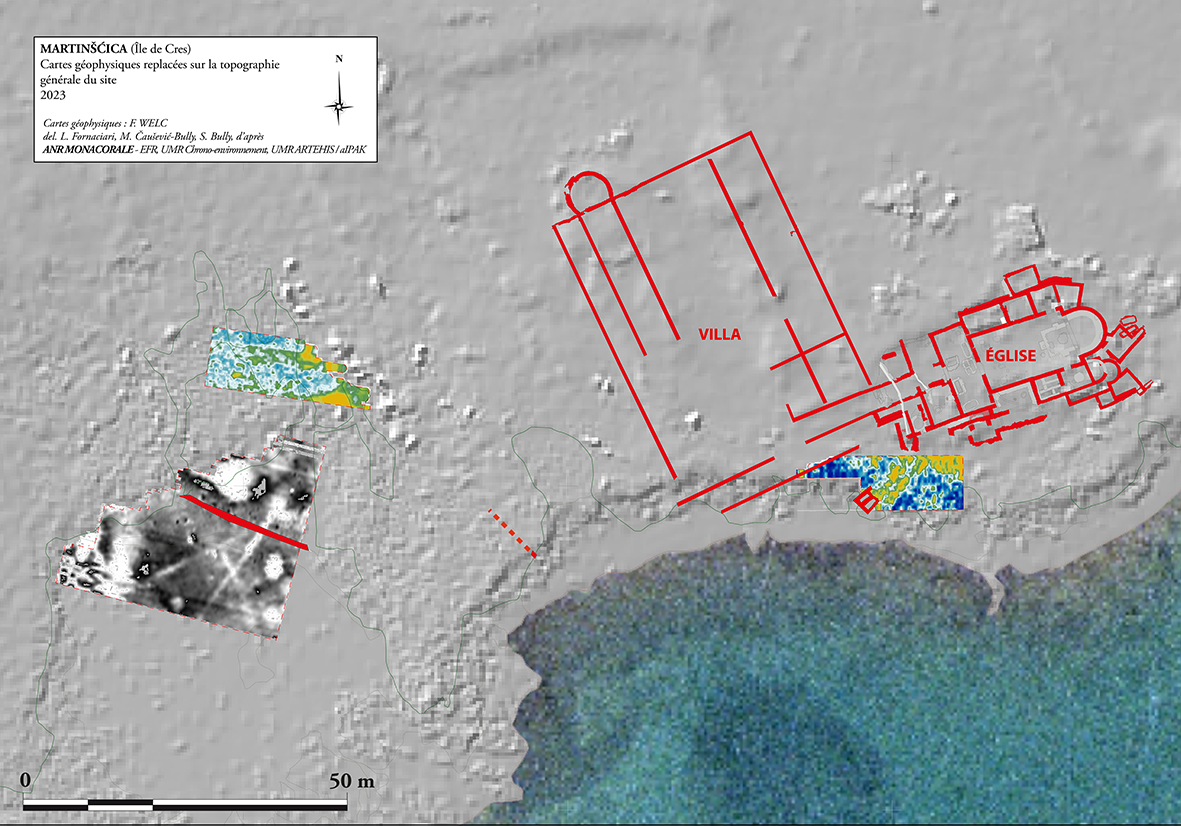
 5- Secteur de la villa maritime de l’Antiquité tardive de Mirine après la campagne de conservation de 2023 (cl. S. Bully)
5- Secteur de la villa maritime de l’Antiquité tardive de Mirine après la campagne de conservation de 2023 (cl. S. Bully)
Quatre années de fouilles sur le sanctuaire antique de Cobannus (Saint-Aubin-des-Chaumes Couan, Nièvre)

Pierre Nouvel, UMR 6298 Artéhis / Université de Bourgogne Franche-Comté Voilà quatre ans que nous avons débuté l’étude du sanctuaire antique dédié à la divinité Cobannus. Ce que nous visons, c’est l’étude complète de cet exemple caractéristique des lieux-de culte des campagnes de la Gaule de l’Est. L’année 2022 a coïncidé avec la fin d’une première étape. Elle a couvert quatre années, une probatoire (2019) suivie d’une triennale de fouille programmée (2020-2022, fig. 1 et 2). Elles ont permis au total l’exploration de 1 955 m² et de restituer l’évolution du sanctuaire en neuf étapes successives, depuis l’époque gauloise jusqu’à la fin du IVe siècle de notre ère. Cela correspond à peu près au tiers de l’extension du complexe, surface estimée à partir des données obtenues lors des prospections géophysiques. Fig. 1 : Vue aérienne des fouilles 2022 (cliché M. Thivet, 17 juin 2022). Fig. 2 : Mosaïque des orthophotographies réalisées par drone sur les quatre campagnes de fouilles sur le sanctuaire antique de Couan à Saint-Aubin-des-Chaumes (Nièvre) Cliché M. Thivet, Université de Franche-Comté. Ce sanctuaire se situe à environ sept kilomètres au sud-ouest du bourg de Vézelay (Yonne), sur la commune de Saint-Aubin-des-Chaumes (Nièvre). Les opérations de fouilles se sont déroulées tous les mois de juin, sauf en 2020, où il a fallu la reporter en août à cause des contraintes sanitaires. Elles ont pris la forme d’un chantier école des Universités de Bourgogne et de Franche-Comté. Il a été encadré par Matthieu Thivet (Ingénieur de Recherche, Université de Franche-Comté, avec en particulier la supervision de la topographie et de la géophysique), Loïc Gaëtan (Inrap GES), Anaïs Lachambre (Bibracte) et Rebecca Perruche (Université de Franche-Comté), qui remplacera Pierre Nouvel dans la responsabilité de l’opération à partir de 2024. Le financement de l’opération a été assuré grâce au soutien du Ministère de la Culture / SRA Franche-Comté. Nous avons pu profiter du soutien logistique de l’EPCC Bibracte et de l’accueil enthousiaste des propriétaires des terrain, M. et Mme Marcelot, ainsi que de leur fils Pierre Marcelot, maintenant exploitant des terrains où se trouvent les vestiges. Le décapage de la terre remaniée par les labours et le rebouchage des fouilles, réalisé chaque année immédiatement après la fin de la campagne, ont été confiés à l’entreprise Trans-Terre de Saint-André-en-Terre-Pleine. L’équipe est logée dans les gîtes de Charancy (Saint-Aubin-des-Chaumes, Nièvre) et de Foissy-près-Vézelay (Yonne), où elle a reçu le meilleur accueil possible. De nombreux spécialistes ont contribué à l’exploitation des données : Sophie Goudemez (UMR 6298 Artéhis) pour la faune, Sylvie Mouton (Inrap GES) pour la céramique, Kevin Charrier pour les lots numismatiques et Rebecca Perruche pour le petit mobilier en particulier métallique. L’analyse des matériaux de constructions et des terres-cuites architecturales a été confiée à Jacques Ledier, les fragments de verre à Laura Bécard (Master ASA, Dijon), les blocs architectoniques à Serge Février et la statuaire à Eloïse Vial (Bibracte). Enfin, Maria Hajnalova (université de Nitra, Slovaquie) a expertisé les prélèvements paléo-environnementaux. Fig. 4 : Vue de la partie ouest de l’aire de fouille 2022 en fin de campagne. Au premier plan, le fossé de péribole puis les vestiges du bâtiment septentrional et enfin, à l’arrière-plan, la cour nord. Chaque année, les travaux de fouille ont consisté dans l’exploration complète, jusqu’au substrat géologique, des niveaux archéologiques conservés sous les labours (fig. 4). Leur analyse stratigraphique précise et l’étude des mobiliers que contenait chacune des couches a permis de restituer l’évolution du site, depuis sa création, à l’époque gauloise, jusqu’aux derniers réaménagements, au cours de l’Antiquité tardive. A l’aide d’un drone, M. Thivet a réalisé des photographies verticales, assemblées sous formes d’orthomosaïques successives (fig. 2), qui documentent chacune des étapes de fouille (fig. 5). Fig. 5 : Orthophotographie de la fouille 2022 (acquisition / traitement : M. Thivet). Ces documents géoréférencés ont servi de base pour la réalisation de plans phasés, c’est-à-dire de plans rassemblant l’ensemble des structures conservées contemporaines d’une étape d’aménagement. Fig. 6 : Le fossé gaulois à profil en V délimitant l’aire centrale quadrangulaire du sanctuaire, creusé dans le calcaire et comblé progressivement durant le début de l’époque romaine. Fig. 7 : La fosse qui avait contenu le trésor de Cobannus, pillée en 1977. La fouille (ici seulement réalisée sur une moitié) a reconnu sa forme et son remplissage, très aéré. Il était caractéristique d’un remaniement très récent, différent de celui des fosses voisines comblées à l’époque romaine. Fig. 8 : Evolution synthétique du sanctuaire de Couan, d’après les données livrées par les quatre campagnes de fouille 2019 à 2022. Les fouilles réalisées depuis 2019 ont permis de préciser ses différentes évolutions, depuis la fin de la période laténienne (gauloise) jusqu’aux dernières décennies du IVe siècle de notre ère. Neuf états successifs principaux d’aménagement ont été documentés (fig. 8 et 9). Retenons en particulier deux séquences : la première, en terre et bois, datée de la période laténienne et de l’époque-romaine précoce (états 1 à 3), la seconde, caractérisée par la mise en œuvre des modes de constructions maçonnés (états 41 à 7), datée de la fin du Ier à la fin du IVe siècle de notre ère. États Principaux aménagements Particularité Datation absolue Etat 1 Creusement du fossé / structures pré-anthropiques Terre et bois La Tène moyenne / finale ? Etat 2 Occupation de l’enclos fossoyé Terre et bois Gallo-romain précoce Etat 3 Occupation de l’enclos fossoyé, voie et limite palissadée, bâtiment sur poteaux dans la cour 5 Terre et bois Julio-claudien Etat 41 Creusement de carrières, terrassement du temenos Terre et bois Après milieu Ier de n.-è. Etat 42 Construction du péribole, du temple et du mur de clôture, 1er bâtiment oriental, premier état de voie Pétrification Fin Ier s. de n.-è. Etat 43 Deuxième état de voie, rajout d’une galerie et réaménagement du bâtiment oriental et construction du bâtiment septentrional Maçonné Début IIe siècle de n.-è. ? Etat 5 Deuxième état des bâtiments périphériques, caniveau oriental Maçonné IIe siècle de n.-è. ? Etat 6 Séparation des cours 5 et 7, condamnation de la voie et destruction de la galerie Maçonné IIe siècle / début IIIe Etat 7 Mise en place des pièces 2, 3, 15 ; aménagement du fossé au nord (espace 17) ; enfouissement du dépôt ; incendie et démantèlement Maçonné Fin IIIe siècle et IVe siècles Etat 8 Récupération, arasement et colluvionnement Moderne / contemporain Fig. 9 : Tableau synthétique des phases d’évolution du sanctuaire de Couan reconnues à la fouille. L’état 1 (fig. 8 et 9, A) reste méconnu. Il correspond à une occupation gauloise, avec en particulier le creusement d’un fossé de quatre mètres de large pour moins de deux de profondeur (fig. 6). Il détermine un enclos apparemment carré, selon un modèle mis en évidence sur plusieurs sites régionaux, avec une enceinte modeste en termes de superficie (ici 22 x 22 soit autour de 600 m² internes). Il est envisageable, d’après le seul poteau découvert sous les remblais de l’état 2, qu’un bâtiment cultuel en terre et bois ait précédé le temple maçonné d’époque impériale, comme cela avait été observé à Nitry. L’état 2 (fig. 9 et 10, B) a lui aussi subi d’importantes destructions lors des terrassements de l’état 41. Il est daté de l’époque romaine précoce. D’après ce que l’on en perçoit, il semble perpétuer la structure initiale du fossé de péribole. Ce dernier semble cependant doublé par une palissade extérieure qui pourrait lui être concentrique, à 30m de distance. Un bâtiment sur poteaux, très arasé, a été reconnu dans l’espace intermédiaire ainsi délimité, au nord du temenos. C’est dans les remplissages du fossé de cet état qu’a été découverte une remarquable statue anthropomorphe en pierre, rejetée après avoir été volontairement mutilée. Elle fait 25,6 cm de hauteur conservée, 16,9 cm de large pour 7,4 cm maximum d’épaisseur (fig. 11). La sculpture aujourd’hui acéphale montre un corps tronqué dans les parties supérieures et inférieures. Le personnage est représenté jusqu’à mi-cuisse, le bras gauche replié sur la poitrine. Il porte un vêtement à chevrons qui recouvre le torse et les fesses alors que les cuisses sont nues. Les figures humaines dressées sont connues depuis le Hallstatt et empruntent différents styles tout au long des âges du Fer. Fig. 11 : Photographie de face et de revers de la statue protohistorique en calcaire découverte sur le sanctuaire de Couan (© Bibracte/Antoine Maillier 2019). L’état 3 (fig. 8 et 9, C), daté de la première moitié du Ier siècle ne révèle pas d’évolution majeur. La palissade extérieure est reconstruite et se matérialise maintenant par deux lignes de poteaux. A l’est du temenos, un chemin creux ou cavée se met en place. Au nord, dans la cour septentrionale, deux trous de poteau ont été reconnus, associés chacun à un dépôt de vase entier (fig. 12). Il confirme l’accueil de pratiques ritualisées dans cet espace intermédiaire. Fig. 12 : Céramique complète retrouvée déposée dans une petite fosse associée à des trous de poteau de l’état 3 (première moitié du Ier s. de n.-è.). L’état 41 (fig. 8 et 9, D) correspond aux prémices de la pétrification du sanctuaire, dans le troisième tiers du Ier siècle de notre ère. Les travaux consistent dans la mise en place d’une terrasse recouvrant le temenos (en déblai vers l’est, en remblai vers l’ouest) et dans le curage du fossé péribole. Ils s’accompagnent d’une grande phase d’extraction de calcaire (fig. 13). Ces matériaux ont servi aux remblais, mais aussi à la fabrication de chaux, comme le prouve des structures de chaufourniers fouillées dans la cour septentrionale. Fig. 13 : photographie des carrières creusées vers le milieu du Ier s. de n.-è. pour extraire la pierre nécessaire à la reconstruction maçonnée du sanctuaire (à gauche, excavation encore comblée de son remplissage marron, à droite sondage dans le front de taille est). Trois fours à chaux ont été explorés. Il s’agit de grandes excavations circulaires d’à peu près 3 m de diamètre pour un peu plus de 3 m de profondeur. Nous n’avons pas repéré de fosse d’accès ou d’enfournement à la base. Il semble donc que les couches de matériaux calcaires extraits, alternant avec des niveaux de charbon de bois, étaient directement cuits dans ces structures, qui ne servaient ainsi qu’une seule fois. Fig. 15 : Vue des fondations en pierres du temple (au plan formé de deux carrés imbriqués) fouillé à moitié en 2019. La cella de plan carré, à gauche, est perforée en son centre par une vaste fosse tardive de récupération. Le mur périphérique qui l’entoure servait de soubassement à une galerie. Au premier plan à droite, on observe le départ d’un mur qui correspond au piédroit de l’escalier d’accès. Il est probable que ces matériaux ont aussi servi à l’édification du complexe maçonné qui marque l’état 42 (fig. 8 et 9, E). Cette phase de pétrification semble devoir être fixée à l’époque flavienne. Elle concerne à la fois le temple (à plan centré, ouvert à l’est, fig. 15), son mur péribole (construit sur la lèvre extérieure du fossé antérieur), un bâtiment annexe à l’est et un mur de délimitation extérieur. Ce dernier reprend, en partie, le tracé des anciennes palissades des états 1 à 3. L’espace intermédiaire est parcouru par une voie sinueuse, qui semble contourner l’espace sacré central (fig. 16). Cette organisation générale va se perpétuer au cours des IIe, IIIe et IVe siècles. L’état 43 (fig. 8 et 9, F), daté du de la première moitié du IIe siècle, voit le remaniement du bâtiment oriental et le creusement d’un grand fossé de drainage oblique. Il traverse la partie nord de l’espace compris entre le mur péribole et le mur périphérique. C’est également à cette période que sont construits une galerie prolongeant le péribole vers l’est et une base d’autel devant l’escalier d’accès au temple. Ce dernier surmonte le fossé de péribole définitivement comblé. Il se positionne ainsi immédiatement à l’aplomb de la statue de culte protohistorique, enfouie dans le remblai sous-jacent remontant aux états 1/2. Le bâtiment oriental va être totalement reconstruit au cours de l’état 5 (fig. 8 et 9, G), daté du IIe siècle. Un autre corps de bâtiment plus modeste prend alors place au nord. Au-delà, dans la cour, une ligne de bases empierrées (peut-être des édicules) sont disposées sur le comblement du fossé de drainage de l’état précédent. Fig. 16 : Vue de la voie contournant le sanctuaire à l’est (premier siècle de notre ère), recoupée par les fondations de bâtiments plus tardifs (IIe-IVe siècles). Lors de l’état 6 (fig. 8 et 9, H), à la fin du IIe ou au début du IIIe siècle, on assiste à la mise en place d’un mur percé d’un seuil, qui conduit à la délimitation de deux espaces de cours, à l’est et au nord du péribole. Cela entraine la condamnation de la voie orientale et de la galerie qui précédait à l’est le temenos (fig. 16). Un autre seuil, au nord-est du péribole, permet d’accéder dans une petite galerie sur poteaux qui couvre le nord-est de l’espace central. C’est aussi de cette période que l’on date les remaniements du bâtiment septentrional et l’aménagement d’un système de drainage, au-dessus du mur de délimitation extérieur. Ce caniveau, équipé d’un bassin de régulation en amont (?) se jette à l’aval dans une espèce de mare, délimitée par un mur de barrage. La dernière étape de l’antiquité (état 7, fig. 18), datée du IIIe et du IVe siècle, donne au sanctuaire sa physionomie définitive, mais aussi la plus complexe. Contrairement à ce qui s’observe dans nombre d’ensembles cultuels périurbains, nous assistons ici à une activité constructive assez marquée. La mise en place de deux nouvelles pièces (3 et 4) au nord-est et d’une troisième au nord (15) confirme que le sanctuaire de Couan fait encore l’objet, jusque dans la deuxième moitié du IVe siècle, d’une fréquentation importante et d’un entretien rigoureux. En témoigne d’ailleurs la présence de deux fosses à chaux, dans le bâtiment est et au nord-est (fig. 17). Un petit dépôt monétaire datée de cette période a d’ailleurs été découvert à l’ouest, contre la paroi extérieure du péribole. C’est à la fin de cette phase qu’est enfoui le trésor du temple, au centre de la cour septentrionale. Sa richesse démontre que le site n’avait encore rien perdu de sa parure. Fig. 17 : Vue d’un des bacs à chaux du début du IVe siècle, fouillé par moitié en 2019 au nord-est du sanctuaire. La fin de l’état 7 se caractérise cependant par des destructions violentes, avec un incendie général qui entraîne l’abandon définitif du site. Il est peut-être immédiatement suivi de quelques phases de récupération, en particulier au centre du temple. A cet endroit, une vaste fosse semble avoir contribué à la récupération d’un puissant aménagement préexistant (un puits ? fig. 15). Son mobilier ne fournit aucun indice postérieur à la fin du IVe siècle. Après leur abandon et leur oubli, ces vestiges sont progressivement arasés par les travaux agricoles (état 8). Les étapes les plus importantes de destruction semblent aussi les plus récentes, liées aux travaux de remembrement, à un sondage de B. Lacroix et aux divers pillages, dont celui, maintenant célèbre, de 1977. Logiquement, puisque le site est marqué par une stratification assez importante et par ces phénomènes d’incisions, ce sont les phases les plus récentes liées à la pétrification du sanctuaire qui ont été les mieux documentées. L’arasement du temple, réduit à ses fondations, est cependant trop profond pour disposer d’une vision claire des choix architecturaux successifs qui ont été mis en œuvre. Tout au plus peut-on noter quelques éléments métriques et planimétriques. Le temple édifié durant la phase 42, sur une terrasse aplanie préalablement sous la forme de déblais-remblais, atteint 13m de côté au total, pour une cella de 7m de côté (surface interne de 34m², fig. 3). Le plan livré par les fouilles confirme qu’il s’ouvrait bien vers l’est, par le moyen d’un aménagement d’escalier qui semble présenter quelques affinités avec ceux de Menestreau et de Crain. De même, le massif rectangulaire dégagé à l’est devant cette entrée peut être interprété comme le soubassement de l’autel, Les aménagements internes de la cella de Couan resteront certainement difficiles à restituer, vu l’importance des perturbations causées par la fosse de spoliation centrale et l’arasement complet des niveaux de circulation. Il semble cependant qu’elle se superpose à un aménagement hydraulique, un conduit maçonné cylindrique. La nature des constructions annexes reconnues à l’est et au nord du péribole ne saurait être précisée d’amblée. Remarquons simplement que les plus importants se situent logiquement face à l’accès du temple et du péribole. A Alluy comme au sanctuaire de La Chaume, à Bibracte, on peut observer l’existence de ces corps de bâtiments, sans qu’il soit possible de juger, en l’absence de fouille, s’ils revêtent une fonction d’accueil ou plus particulièrement liturgique. Il est possible de rattacher 79 « objets » métalliques, trois récipients céramiques et environ 6 932 monnaies au célèbre trésor découvert clandestinement en 1977 sur ce site. D’après les informations retranscrites en 2009 dans la confession du découvreur rédigée devant les agents du Service Régional de l’Archéologie, nous avions une idée assez précise de la localisation et de la nature de la fosse qui avait accueilli tous ces objets. Cette cache était à près de 0,8 m de profondeur, en terrain dégagé. Le pilleur a pu mesurer, malgré les conditions désastreuses de son intervention, une fosse d’environ 1,8 m de côté. Prenant conscience de l’importance de sa découverte, il réalisa un croquis de la disposition des pièces dans la fosse (fig. 19 à droite), un schéma de localisation dans le champ et un inventaire assez précis du lot et des monnaies, documents qu’il a transmis aux Service Régional de l’Archéologie avant son décès. La campagne de fouille 2022 a permis de retrouver la fosse qui avait accueilli cette découverte (fig. 8). Sa forme, sa profondeur et sa taille confirment en tous point les éléments contenus dans le « testament » du pilleur. Plus particulièrement, la confrontation de son schéma d’organisation de la découverte avec la fosse elle-même permet de reconstituer l’organisation originelle de l’ensemble (fig. 19). Fig. 19 : A gauche, relevé en coupe et plan de la fosse découverte en 2022. Elle a vraisemblablement contenu le dépôt de Cobannus. A droite, superposition du schéma laissé par le découvreur et du relevé de la structure. Les tailles des différents objets représentés correspondent à la réalité. Comparé aux autres trésors de sanctuaires connus (par exemple dans le Loiret ceux de Neuvy-en-Sullias ou de Champoulet) le dépôt de Cobannus est particulièrement varié. Il reste tout de même dominé, comme dans la plupart des dépôts, par la statuaire en ronde-bosse et les monnaies. Sa composition témoigne également d’une volonté de la part des commanditaires de sélectionner certains mobiliers tels que des objets précieux (trois objets en or et vingt en argent) ou présentant une certaine qualité esthétique. Fig. 20 : Vue du sol d’une des pièces du bâtiment oriental, portant les traces du violent incendie qui a sanctionné l’abandon définitif du sanctuaire, vers 380 de n.-è. Cela pose évidemment la question des motivations qui ont conduit à l’enfouissement de toute cette richesse, vraisemblablement rassemblée dans la seconde moitié du IVe siècle. Les fouilles récentes ont d’ailleurs mis en évidences des traces d’incendie dans les états les plus tardifs des sanctuaires voisins (Montmarte, Nitry et Crain), ce qui reflète un contexte particulièrement agité. A Nitry, la statue de culte, encore ornée d’un collier de perles datable du milieu du IVe siècle, est détruite et laissée sur place. Une couche contenant des monnaies de la dynastie valentinienne la surmonte. A Montmarte, au Vault-de-Lugny, le temple et ses ornements font l’objet d’une destruction en règle, qui s’accompagne du morcellement et du rejet des célèbres statues de cultes aujourd’hui conservées au musée de l’Avallonnais. Les séries monétaires se closent, là encore, avant l’époque théodosienne. Le sanctuaire de Crain a lui aussi fait l’objet d’un saccage systématique, avec la destruction de la statue de culte de Minerve. Sa base a été retrouvée dans la cella, alors que son buste a été découvert dans un puits à plusieurs centaines de mètres de là. Ce contexte de destruction volontaire des sanctuaires du secteur n’est pas perceptible dans les établissements ruraux voisins. Ce sont donc précisément les lieux de culte païens qui sont visés, dans un contexte politique régional assez calme. Il semble possible de mettre ces évènements en corrélation avec l’action de saint Martin et de ses acolytes, justement dans les années 380 de notre ère. Comme le rapporte sa vita, écrite en 396-397 par Sulpice-Sévère, Martin, encouragé par le contexte politique antipaïen à Rome et par les édits de Valens puis de Théodose Ier, a mené une violente campagne d’éradication de la religion polythéiste dans le territoire de la cité d’Autun. Cette hagiographie presque contemporaine des faits nous rapporte des scènes de destructions systématiques de temples et d’idoles, accompagnées d’humiliation des fidèles. La similitude des observations faites sur les sites de Nitry, Crain, Montmarte et Couan, dans un rayon de quelques kilomètres au nord du territoire éduen, semble fournir un éclairage direct à cet épisode de fanatisme religieux (fig. 21). L’étude des niveaux d’abandon du sanctuaire de Couan (état 7c, fig. 20) confirme en grande partie cette impression, puisque l’incendie généralisé du site de produit apparemment peu après 378 d’après les monnaies qui se sont retrouvées piégées sous les toitures effondrées. On note en effet l’absence, étonnante dans le secteur, des abondantes séries monétaires des années 380 / 390, aux noms de Magnus Maximus et de Théodose. Fig. 21 : « Saint Martin détruit les idoles ». Gouache sur papier de Luc-Olivier Merson (1846-1920). Il est cependant postérieur aux années 355, période à laquelle on entreprend encore des constructions dans le bâtiment septentrional. Pourtant, le TPQ monétaire du trésor de Cobannus démontre qu’il a été mis en terre peu après 363 de n.-è. L’absence de frappes de la dynastie valentinienne dans cet ensemble est un indice majeur. Très communes dans la région, elles sont présentes, comme nous venons de le voir, dans les niveaux d’abandon du sanctuaire. Il y a donc un décalage d’une dizaine d’années entre la mise en terre du dépôt et la destruction du site. Les fouilles ont plutôt démontré que l’enfouissement dépôt de Cobannus sanctionnait la fin d’un ultime regain de dynamisme sur le site. Dans les années 350/360, le site connaît une certaine activité constructive, avec le réaménagement du bâtiment septentrional, le curage du fossé et l’installation de la terrasse, peut-être la construction de nouvelles pièces dans le bâtiment oriental (fig. 18). On ne peut oublier que cette date de 363 correspond à la fin du règne de Julien II, dernier empereur païen. Cela clôt une séquence de répit pour l’ancienne religion, après les premières attaques perpétrée sous le règne de Constance II. C’est plutôt ce contexte, l’accumulation de signes menaçants contemporains de la prise de pouvoir de Valens et Valentinien, qui aurait pu conduire les responsables du culte à la dissimulation des biens du temple. La découverte et l’étude de la fosse lors de la campagne 2022 démontrent que la fosse qui a recueilli le trésor ne présentait aucun aménagement particulier. Il s’agit d’un creusement en pleine-terre dimensionné à la mesure des objets qui devaient y prendre place. Rien à voir avec un aerium longuement aménagé ou monumentalisé comme l’est le célèbre tronc monétaire du sanctuaire voisin de Crain « Buisson de la Parparée ». Sans parler d’urgence, on distingue ici une démarche teintée d’un certain empirisme. Cette impression est renforcée par sa position topographique dans le complexe cultuel. Il n’a pas été déposé dans un bâtiment particulier, pas plus que dans l’espace consacré du sanctuaire, le temenos, où on pourrait penser qu’étaient conservés les objets les plus précieux appartenant à la divinité. Il semble que ces différents paramètres (faible profondeur, fosse sans aménagement, rejet loin du cœur du complexe dans une zone périphérique, disposition des objets sans soin ou ordre spécifique) dénotent une certaine précipitation, tout du moins une action rapide destinée à soustraire cette richesse à une éventuelle spoliation. La position de la fosse, dans la cour 5, n’est cependant pas totalement anodine. Elle prend place au milieu d’autres structures, à mi-distance de deux bases maçonnées qui pouvaient, le cas échéant, servir de repères. Ces divers aménagements (bases de stèles ou d’édicules, mais aussi fosses à dépôts de vases) nous indiquent d’ailleurs que cette cour revêtait probablement un caractère sacré. Tous ces indices cumulés nous confirment que le dépôt des objets du culte a été motivé par un climat devenu délétère pour les cultes païens. On peut supposer cependant qu’il s’agissait d’un enfouissement temporaire, dans l’attente du retour à des temps meilleurs. Force est de constater que les individus qui ont procédé à cette dissimulation ont été empêchés de venir les remettre au jour…
Pierre-stanislas.nouvel@u-bourgogne.fr
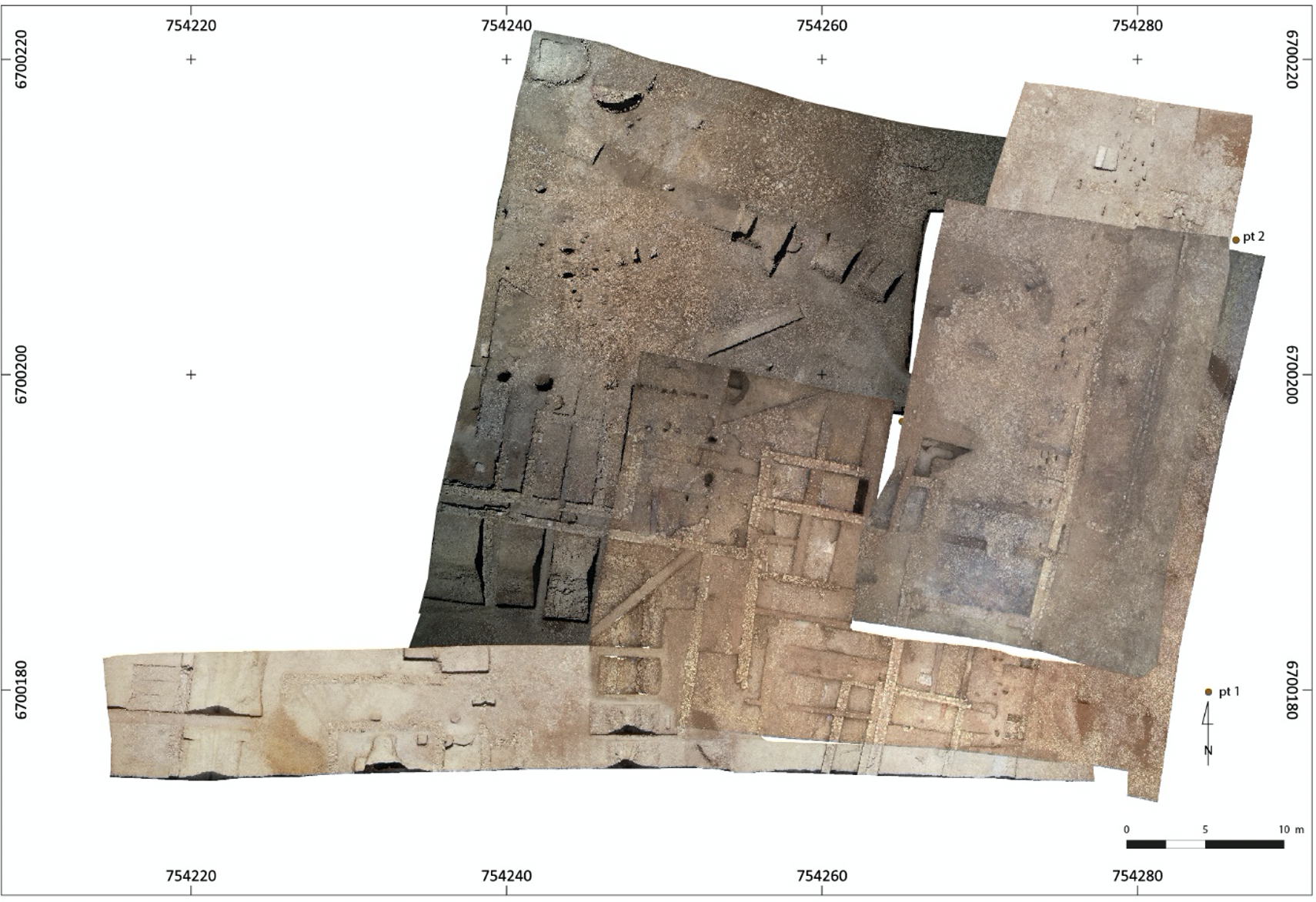
Déroulement des opérations




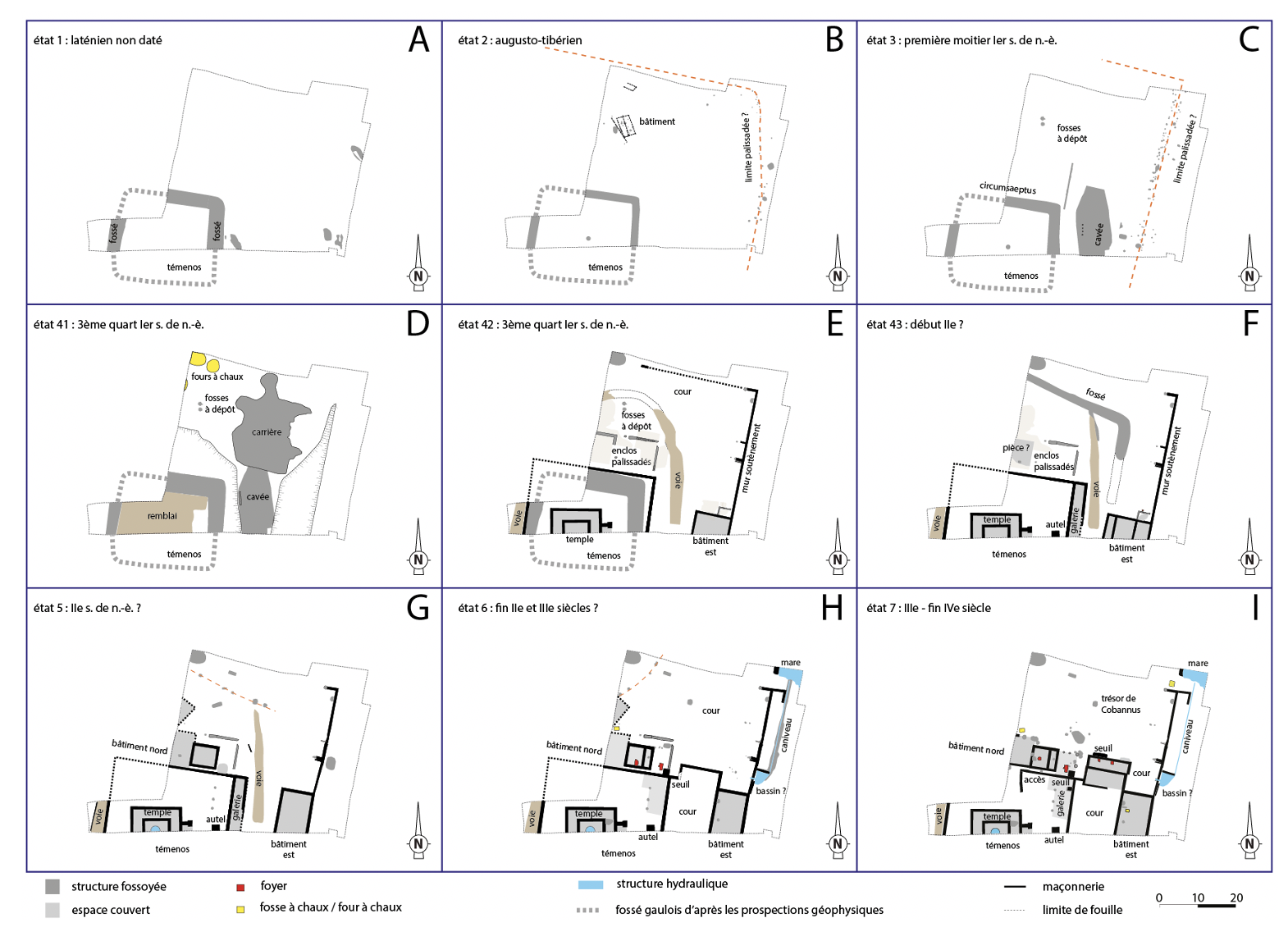
Le sanctuaire de Cobannus, de l’époque laténienne à l’Antiquité tardive






Un temple à plan centré caractéristique
Datation et motivation de l’enfouissement du trésor de Cobannus
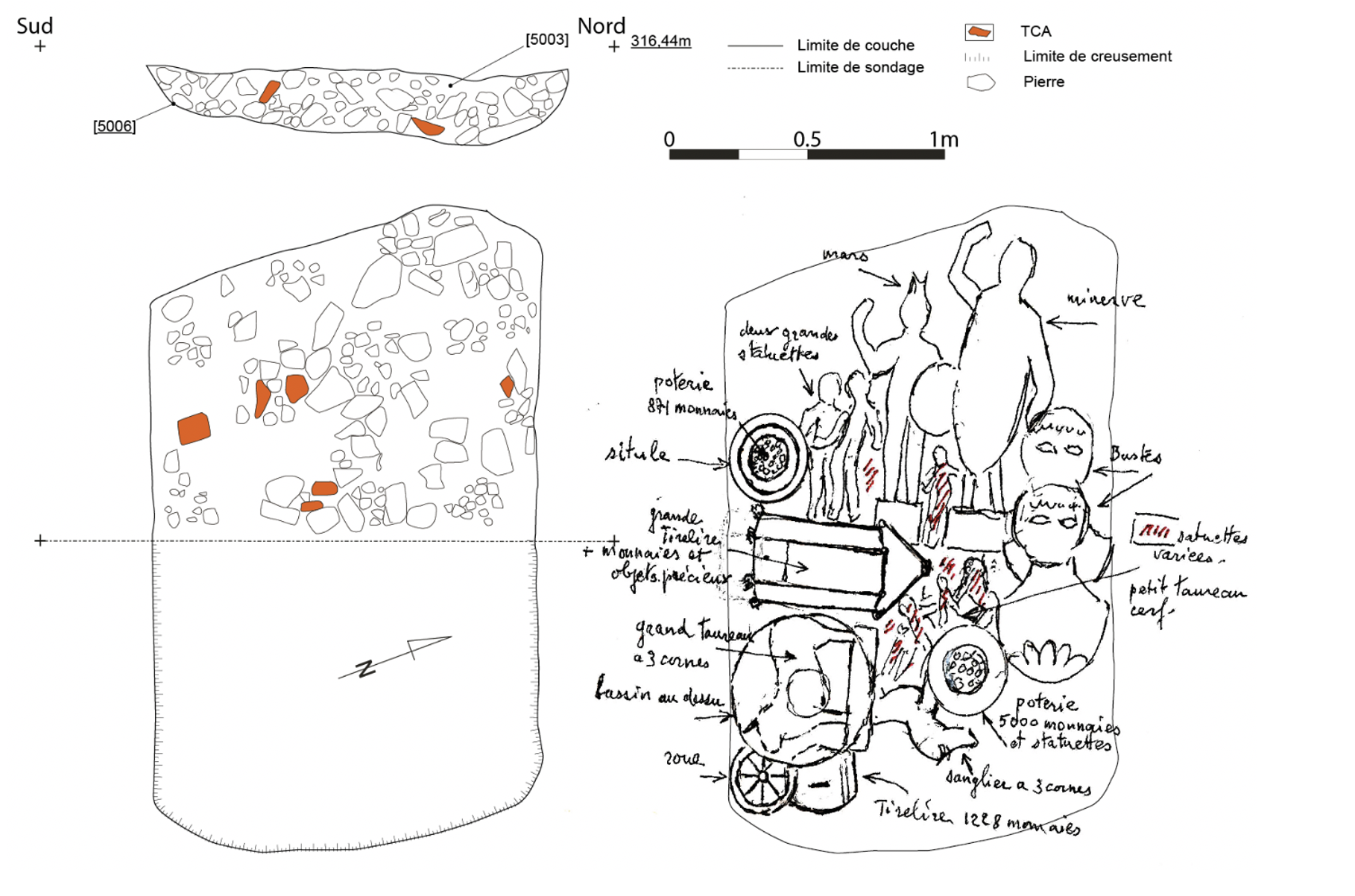


Limes et Ager. Analyse archéologique des constructions linéaires en pierre sèche (Italie) / campagne 2023
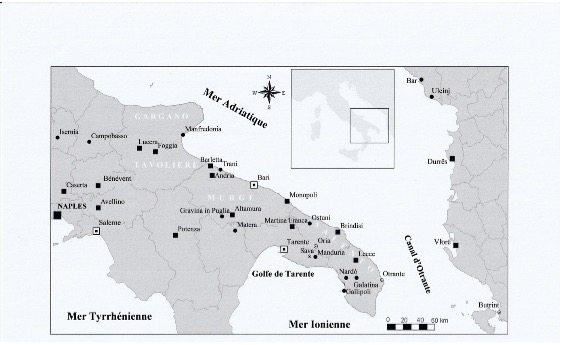
Limes et Ager. Analyse archéologique des constructions linéaires en pierre sèche : un outil pour l’archéologie des systèmes agraires et de l’organisation des espaces euro-méditerranéens. Campagne de terrain 3-14 juillet 2023 Au sein de l’axe « Fabrique du paysage », ce programme de recherches porte sur le bâti rural en pierre sèche des plateaux calcaires de la Pouille (Italie sud-orientale). Ici, depuis de nombreux siècles, l’épierrement a fourni la matière pour bâtir d’innombrables aménagements, qu’il a toujours été plus économique de conserver ou abandonner que de démonter. Certains murs et pierriers linéaires parementés peuvent atteindre jusqu’à une dizaine de km de long. À partir de l’année 2023, les grands murs, pierriers et clapiers à caractère linéaire et parcellaire en pierre sèche de la région ont été constitués en corpus spécifique et mis au centre d’un programme réunissant des spécialistes de géohistoire, géoarchéologie, construction en pierre sèche, archéologie agraire, archéologie du bâti et géomatique. Outre Giovanni Stranieri, porteur du projet et spécialiste de l’archéologie des paysages agraires, Pascale Chevalier et Mélinda Bizri apportent leur expertise en archéologie du bâti tandis qu’Amélie Quiquerez supervise les approches géoarchéologiques. De plus, une collaboration a été établie avec l’UMR 5600 EVS-ISTHME (Lyon-Saint-étienne), à laquelle appartiennent Sarah Réault, qui travaille sur les aspects géohistoriques, et Pierre-Olivier Mazagol, géomaticien. Enfin, l’équipe est complétée par Louis Cagin (Association « Une pierre sur l’autre », Drôme), murailleur professionnel et auteur de publications sur les techniques de construction en pierre sèche. Au mois de juillet 2023, une équipe de douze opérateurs – chercheurs et étudiants – a inauguré le relevé photogrammétrique, la couverture photographique à basse altitude et la caractérisation morphologique et structurale du plus imposant des murs et pierriers parementés (localement « paretoni ») de la Pouille (longueur actuellement observable 2260 m, 1,5 à 3 m de hauteur et 2 à 7 m de largeur), situé à l’est de Tarente, sur la commune de Sava. Mélinda Bizri a dirigé une équipe constituée de Nadia Saint-Luc, Nans Vidal et Océane Theillac dans la réalisation du relevé photogrammétrique du versant oriental du tronçon central du paretone, long de 527 m. Parallèlement, David Pilloix a réalisé une couverture photographique exhaustive de la totalité du paretone, via plusieurs survols de drone à basse altitude. En même temps, Pascale Chevalier et Louis Cagin, avec l’aide de Marie Sannajust et Esther Souriot, ont réalisé la description typo-morphologique des élévations, appuyée sur une lecture structurale de l’appareillage, à la recherche des phases de construction, sur le versant oriental du tronçon central. Margaux Rogazy, étudiante en prépa BCPST, a réalisé un relevé phytosociologique et arachnologique sur les deux versants du paretone, afin de repérer d’éventuelles différences concernant l’histoire de l’utilisation du sol. Enfin, Sarah Réault et Giovanni Stranieri ont parcouru la masse parcellaire autour du paretone, afin de documenter la variété typologique des aménagements en pierre sèche, les caractéristiques pédologiques et géomorphologiques du secteur, les possibilités d’accès à l’eau et l’utilisation du sol. Cette action a permis également d’établir un contact direct avec plusieurs propriétaires des parcelles environnantes et notamment avec ceux qui pourraient autoriser la réalisation de sondages dans leur propriété dans les années à venir. Les résultats de cette année probatoire sont à nuancer selon les postes d’actions. En effet, le relevé photogrammétrique a nécessité un gros travail de débroussaillage que nous avions sous-estimé. Nous demanderons pour l’an prochain une intervention en amont des services de la mairie afin de procéder plus rapidement au relevé du versant occidental. En revanche, la caractérisation morphologique et structurale, menée par Louis Cagin et Pascale Chevalier, a d’ores et déjà produit des résultats concrets et très prometteurs : la lecture du mur a permis de détecter des secteurs pouvant correspondre à d’anciens passages, des cabanes ou des abris temporaires effondrés, qui n’avaient pas été décelés jusqu’alors. Ainsi, le paretone semble devoir sa forme matérielle actuelle au fait qu’il s’est constitué en clapier sur une longue période de temps, augmentant de volume au fur et à mesure des épierrements et des dépôts atour d’un noyau initial bien moins monumental. Il semble que notre ouvrage doit donc être pensé comme un bâti évolutif, un aménagement à long terme, qui consigne l’information de chaque phase de la construction, de l’état initial – daté entre 670 et 880 n.è., sur la base des données actuellement disponibles – à sa forme actuelle. Cette hypothèse de lecture est confortée par le réexamen des photos et des relevés issus de sondages menés par le passé et devra être ultérieurement vérifiée par les sondages à venir. La lecture technique de l’ouvrage devra également prendre en compte les informations géo-pédologiques et l’appareillage de chacune des phases de dépôt dans le but d’interpréter l’ouvrage comme un reflet de l’aménagement agraire des parcelles alentours. Sur la base de ces résultats, nous pouvons envisager un programme de plus grande envergure, s’échelonnant sur la période 2024-2027. Une fois achevé le relevé photogrammétrique et la lecture structurale du versant ouest, plusieurs sondages seront menés sur le paretone de Sava, ainsi que sur les murs qui s’y connectent, assortis d’une étude géomorphologique et d’une étude géohistorique incluant la carte archéologique déjà constituée par le passé. À l’échelle de la région, nous allons également mener la caractérisation morphologique et structurale d’au moins deux autres délimitations similaires ; nous compléterons aussi le recensement de toutes les macrostructures linéaires en pierre sèche régionales, déjà réalisé par le passé. Enfin, l’organisation d’une série de rencontres scientifiques autour de ces structures liminaires et parcellaires en pierre sèche, actives ou fossiles, fera de Dijon le centre de gravité d’études comparatives à l’échelle européenne. Dès le printemps prochain, nous organiserons un séminaire de recherche comparatif portant sur l’architecture en pierre sèche dans les territoires de la Pouille, de la Bourgogne et du Grand Est. Afin de fournir une assise plus robuste au projet, un deuxième partenariat va être officialisé avec l’Università del Salento (Lecce, Italie) en la personne de Paul Arthur, archéologue médiéviste, et de Girolamo Fiorentino et Anna Maria Grasso, archéobotanistes. Nous escomptons encore proposer une collaboration, sous une forme qui reste à déterminer, avec l’École française de Rome.
Le cas de la Pouille (Italie) et approches comparatives.
Axe « Fabrique du paysage » – Projet BQR Région 2023
[Lien vers la fiche du projet]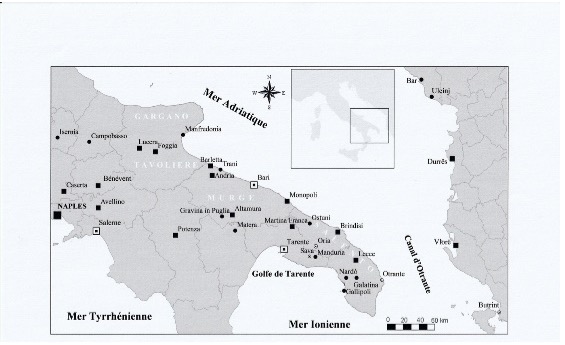





Fouille programmée de l’abbaye de Chéhéry, Châtel-Chéhéry (08), campagne 2023

Responsable : E. Gaugé, Sra, Drac Grand Est Cette campagne de fouille (ouverture de 80 m²) succède à une campagne de prospections géophysiques réalisées en 2021 et à un premier sondage en 2022. Ce dernier a permis de vérifier la conservation des vestiges et l’amplitude stratigraphique. Il a livré plusieurs occupations depuis les XIVe-XVe siècles jusque l’époque contemporaine. La campagne 2023 considère une de ces occupations, la plus ancienne repérée au sein du sondage. Elle est composée d’un premier bâtiment, dont témoignent deux murs parallèles et plusieurs niveaux d’occupation. Ces deux murs gouttereaux sont de belle facture et sont associés à un premier niveau de circulation posé directement sur les fondations et qui réutilise des carreaux de pavement des XIIIe et XIVe siècles (Fig. 1). Ils présentent un fort pendage vers le centre de l’emprise, dû à la fois au creusement plus tardif de sépultures mais aussi au substrat alluvionaire gorgé d’eau. À ce souci, semble avoir été trouvée une solution à travers l’installation de drains en terre cuite qui mènent à une fosse récupérant ces eaux. Ces drains sont recouverts d’un autre pavage qui témoigne de la continuité d’occupation de la pièce. La construction de cette dernière est postérieure au XIVe siècle puisque les carreaux ne sont pas dans leur disposition d’origine. La salle a vraisemblablement été abandonnée au milieu du XVIIe siècle. L’indigence du mobilier et l’absence de structures caractéristiques (banquettes, cheminée…) ne permettent pas de proposer de fonction pour cet espace. Le mur oriental de ce bâtiment est repris lors de la construction d’un autre édifice au cours du XVIe siècle alors que le premier est encore en élévation. Il sert de mur occidental à un bâtiment de très grande envergure se développant vers l’est. Un escalier entre deux murs de refend permettait probablement le passage entre ces deux bâtiments. La zone est ensuite abandonnée et sert à l’ensevelissement de quelques sépultures. La population découverte, deux hommes, une femme, un individu non déterminé avec un péri-natal et deux enfants est représentative d’une population de cimetière paroissial, même si la faible quantité de sépultures ne le confirme pas. Leur présence peut supposer que l’église ancienne est à proximité. Cette hypothèse d’un premier bâtiment de culte à proximité de l’église du XVIIIe siècle a d’ailleurs été évoquée dès l’année passée mais n’a pu encore être vérifiée. L’étude des plans anciens a conduit à implanter la fouille au sein de l’église du XVIIIe siècle, en supposant qu’elle reprenait l’emplacement du premier édifice de culte. Quatre supports de pilier et un mur gouttereau combinés au mur d’abside découvert l’année dernière permettent de confirmer cette position au centre de l’édifice moderne (Fig. 2). L’an passé, nous avions identifié un mur ancien servant de fondation au gouttereau sud de l’église du XVIIIe. Il a été à nouveau retrouvé cette année plus à l’est. Nous supposons qu’il pourrait s’agir de la reprise d’un mur de l’église ancienne lors de la construction moderne. L’église primitive pourrait alors se situer immédiatement au sud du cloître du XVIIIe siècle. Le sondage de l’année prochaine, s’il est autorisé, sera destiné à vérifier la présence du premier bâtiment de culte juste au sud de l’église moderne.
Equipe : outre les bénévoles, le projet associe E. Wermuth, L. Poupon, A. Berthon, C. Duval (Eveha), P. Testard et A. Louis (Inrap), V. Legros (Sra, Drac Hauts-de-France)
Dates de chantier : 26 juin au 7 juillet 2023
Financement : DRAC Grand Est

Fouilles de l’habitat et de l’enceinte palissadée de Val-des-Marais (Morains-le-Petit) « Le Pré à Vaches » (Marne)

Un habitat du Néolithique récent (3600-2900 avant J-C. ) a été mis au jour dans la région des Marais de Saint-Gond, à Val-des-Marais (Morains-le-Petit) « Le Pré à Vaches » (Marne, France). Cette découverte majeure, attendue depuis 150 ans, a été réalisée au cours de l’été 2023 grâce à une évaluation archéologique réalisée dans le cadre du programme de recherche sur le Néolithique de la région des Marais de Saint-Gond. Ce projet est coordonné par Rémi Martineau (CNRS), en partenariat avec l’INRAP, et subventionné par la DRAC Grand Est, la Communauté de communes Paysages de Champagne et la Mairie de Val-des-Marais. Le site se trouve dans la plaine de Champagne, dans la partie orientale des marais de Saint-Gond, en amont de la vallée du Petit Morin. Ce secteur, parfois appelé « sources » du Petit Morin, correspond en réalité à un fort battement de la nappe phréatique qui vient parfois inonder cette zone canalisée anciennement (fig. 1). Figure 1 : vue aérienne par drone du site de Val-des-Marais « Le Pré à Vaches » (Marne). Photo Jonathan Desmeulles, CNRS. La détection du site a été réalisée à partir de tranchées et de sondages correspondant à une superficie de 3800 m2. Il comprend au moins une enceinte palissadée et peut-être une deuxième enceinte accolée. A proximité ont été mis au jour deux grandes fosses dépotoirs, un puits et un bâtiment datés du Néolithique récent (fig. 2). Figure 2 : vue zénithale des sondages. En haut à gauche la palissade, au centre une fosse dépotoir et le bâtiment accolé à un tronçon d’enceinte. Photo Jonathan Desmeulles, CNRS. Les empreintes des poteaux refendus en deux sont remarquablement bien conservées dans les parties crayeuses (fig. 3). Un puits d’environ 2 m de diamètre, bien daté du Néolithique récent par la céramique, permettait d’accéder à la nappe phréatique. Deux grandes fosses d’une vingtaine de mètres de diamètre ont livré de la céramique, de l’industrie lithique et de la parure caractéristiques du Néolithique récent. L’une d’elles a sans nul doute été fouillée par André Brisson dans les années 1920. Figure 3 : Val-des-Marais (Marne). Vue de l’enceinte palissadée en cours de fouilles. Photo Rémi Martineau, CNRS. Entre l’enceinte et une de ces grandes fosses a été mise au jour une portion d’un bâtiment à deux nefs de 3 m de large qui se termine en abside. Sa datation au Néolithique récent est assurée par le fait que la couche supérieure de comblement de la grande fosse adjacente, bien datée du Néolithique récent par la céramique et la parure, vient recouvrir les trous de poteaux de ce bâtiment, ce qui explique que ceux-ci ne soient pas visibles à la surface de cette fosse (fig. 4). Ces différentes structures semblent constituer un ensemble organisé que seule une fouille extensive permettra de documenter en détail. Figure 4 : site du Néolithique récent de Val-des-Marais (Marne). De gauche à droite une fosse dépotoir, un bâtiment à abside et un tronçon de la palissade. Photo Rémi Martineau, CNRS. Dans cette partie nord des sondages, trois fosses en Y ont également été mises au jour. L’absence de mobilier ne permet pas pour le moment de les dater. Dans ces sondages des fosses et des trous de poteaux protohistoriques et, dans une moindre mesure, antiques, ont également été mis au jour. Dans la partie sud de la parcelle évaluée, une large dépression naturelle d’une vingtaine de mètres de diamètre a été sondée à la pelle mécanique. Cette dépression a servi de point d’eau au Néolithique (datation céramique, fig. 5) comme l’attestent les nombreuses empreintes de pattes de bovidés qui ont été observées sur sa périphérie. Il n’est pas encore déterminé si ce point d’eau situé dans une dépression au départ naturelle a fait l’objet d’un creusement sous forme d’un puits dès cette époque. En revanche un puits a clairement été creusé dans cette dépression à la fin du Hallstatt, comme l’atteste la céramique trouvée à 5 m de profondeur. Le fond n’a pas été atteint pour des raisons techniques. Dans ce secteur, deux silos, deux fosses et plusieurs trous de poteaux sont également datés de l’âge du Fer. Figure 5 : quelques exemples de tessons céramiques caractéristiques provenant de Val-des-Marais (Marne). Photo Rémi Martineau, CNRS. Cette évaluation archéologique a permis de détecter au moins une enceinte palissadée, au moins un puits, au moins deux grandes « fosses » dépotoirs et un bâtiment en abside datés du Néolithique récent par la céramique. Les structures mises au jour concernent une aire d’environ 5000 m2, mais le site pourrait s’étendre sur plusieurs hectares. Il s’agit d’un site majeur, d’une grande importance pour la connaissance du Néolithique de la moitié nord de la France. Cette découverte constitue une étape importante de ce projet de recherche et ouvre de nombreuses perspectives pour la connaissance du Néolithique. Dans la région des Marais de Saint-Gond, la découverte d’habitats néolithiques est attendue depuis 1872. Le baron Joseph de Baye qui avait découvert de grandes quantités de silex taillés dans les champs, a cherché à identifier les lieux de vie des populations qui habitaient la région au cours de la Préhistoire. Il entreprit alors de nombreuses fouilles et découvrit plus de cent hypogées, mais il ne trouva jamais les habitats qu’il cherchait. C’est André Brisson qui a découvert le site de Val-des-Marais « Le Pré à Vaches » en 1924, à partir d’outils en silex trouvés dans la terre noire des taupinières. Il a ensuite réalisé des fouilles ponctuelles jusqu’en 1933, mais l’absence de décapages mécaniques ne pouvait lui permettre de dégager et de comprendre ces grandes structures, ni l’organisation spatiale du site. Ce site d’habitat vient compléter nos connaissances sur cette région qui recèle déjà une très grande richesse archéologique pour cette période du Néolithique récent. Rappelons que 135 hypogées, 5 allées couvertes mégalithiques, 15 minières de silex couvrant plus de 400 ha, 8 polissoirs mégalithiques et des champs mis en culture par écobuage y sont déjà connus. Un tel ensemble de sites représentant tous les aspects de la société (domestique, funéraire, artisanal et agricole) ne connaît pas d’équivalent en Europe occidentale pour cette période. C’est à ce titre que cette découverte majeure prend toute son ampleur scientifique. Elle devrait permettre de répondre à de nombreuses questions sur les modes de vie et sur les relations entre les groupes humains qui vivaient dans cette région à cette période. Elle ouvre également de nombreuses perspectives de comparaisons entre les habitats et les sépultures, et devrait permettre de reconstituer l’organisation sociétale, économique et territoriale des sociétés du Néolithique. Rémi Martineau, Fabien Langry-François et Guillaume Lépine




Le sanctuaire périurbain du Chiron Fauché à Ardin (79) : Bilan de la campagne de fouille 2023

Une campagne de fouille s’est déroulée à Ardin dans le département des Deux-Sèvres pendant 3 semaines du 4 au 22 septembre 2023 où une équipe d’une vingtaine de personnes ont œuvré sous la direction de Romain Storaï (UMR 6298 ARTEHIS) sur le site de l’agglomération antique du Chiron Fauché entre les communes de Coulonges-sur-l’Autize et Ardin. L’équipe de terrain était principalement composée d’étudiants en archéologie des universités de Bordeaux, Dijon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris, Poitiers et Rennes. Cette première campagne de fouille sur le site intervient après deux campagnes de prospections pédestres et géophysiques (2021 et 2022) ayant permis de caractériser une partie de la morphologie interne de l’habitat groupé antique, jusqu’alors méconnue. A la suite des acquisitions géophysiques réalisées en 2022 à l’emplacement du sanctuaire périurbain de l’agglomération, la fouille a ciblé ce lieu de culte se situant dans la partie méridionale de l’habitat groupé qui se développe sur une cinquantaine d’hectares dans la plaine au nord de l’ensemble cultuel. La fouille a permis de mettre en évidence trois états successifs du sanctuaire aperçu lors de acquisitions géophysiques : le premier état est composé d’un sanctuaire augustéen dont seule l’entrée du péribole a pu être documentée étant donné que le temple se trouve hors de l’emprise de fouille. Le second état met en place un temple à plan centré de tradition celtique aux dimensions modestes et le dernier état présente une phase de monumentalisation caractérisée par un péribole portiqué et un temple à plan classique. Le site présentant un état de conservation permettant une lisibilité optimale des vestiges, l’évolution du sanctuaire entre les Ier et le IIIe siècle de notre ère a pu être documentée afin de poursuivre les investigations en extensif dans la partie septentrionale du sanctuaire en 2024. Ainsi, quelque 300 fragments de blocs architecturaux sculptés ont pu être retrouvés dans les niveaux de démolition du troisième état du sanctuaire. Ces éléments permettront, après leur étude, de restituer une grande partie des décors architecturaux du temple à plan classique. Dans ces mêmes niveaux d’abandon, l’élément le plus marquant de la fouille a été la découverte des statues de divinités représentant Mercure et Rosmerta. La combinaison de ces deux divinités, courante dans le nord-est de la Gaule, est inédite pour la Centre-Ouest. Parallèlement, la fouille des niveaux d’occupation des sanctuaires successifs a permis de mettre au jour des dépôts cultuels devant les façades des temples. Ces dépôts sont notamment composés de monnaies, pigments et de haches polies néolithiques. Vue de l’entrée du sanctuaire augustéen conservé sous les temples postérieurs (Cl. M. Delahaye) Vue générale de la fouille à la fin du chantier (Cl. Th. Roquet) Visage de la statue de la divinité Rosmerta (Cl. R. Storaï)


La léproserie médiévale de Fleurey-sur-Ouche / campagne 2023

Depuis 2020, des recherches sont en cours à l’est du village de Fleurey-sur-Ouche, le long du chemin menant à Velars-sur-Ouche et à proximité de la rivière ; elles visent à compléter les données récoltées dans le cadre préventif sur la configuration du village et son évolution au cours du Moyen Âge et de l’Époque moderne. Plusieurs maçonneries en élévation sont observables sous le couvert forestier (fig-1), à 1,3 km du village. Ces maçonneries avaient fait l’objet d’observations préalables par des membres de l’Association Histoire et Patrimoine de Fleurey-sur-Ouche (HIPAF). Le tracé de ces murs (courbes pour certains) est conservé dans la forme particulière du morcellement cadastral observable sur le plan de 1812. Vue par drône d’une partie des maçonneries et d’un sondage © J. Berthet, Inrap La toponymie nous incite à penser qu’il s’agit de vestiges de murs liés à la présence d’une léproserie, attestée dans les sources archivistiques à la fin du XIIIe siècle et au XVe siècle. Le site se situe en effet à proximité immédiate de la « Combe Maladière ». Le positionnement des vestiges par rapport au bourg de Fleurey est également tout à fait compatible avec cette hypothèse : les établissements accueillant des lépreux se devaient en effet d’être éloignés des villages afin de ne pas propager la maladie, mais le long des voies de passage dans le but de pouvoir récolter l’aumône. Il est fort probable que les murs actuellement en élévation soient liés à des structures agropastorales récentes mais qu’elles résultent du démantèlement des bâtiments de la léproserie abandonnée à la fin du Moyen Âge. Les sondages effectués en 2022 nous avaient permis de confirmer la fréquentation des lieux entre le XIIIe et le XIVe siècle, grâce à la présence de céramique, d’éléments de décors vestimentaires métalliques et de clous mais aussi déchets fauniques, dans un ratio de densité important compte-tenu de l’étroitesse des fenêtres d’investigation. En 2023, une équipe, composée d’étudiants et de membres de l’HIPAF, a ouvert plusieurs autres sondages (fig-2), qui ont permis de compléter les informations sur l’occupation des lieux. De nombreux artefacts ont à nouveau été trouvés, fixant la chronologie établie (fig-3). La découverte majeure de cette dernière campagne est la mise au jour, à quelques centimètres de profondeur, d’une maçonnerie de belle facture, en lien avec les niveaux datés du bas Moyen Âge, qui laisse présager la bonne conservation de certains bâtiments de la léproserie, malgré la récupération des matériaux. Sondages en cours de fouille © G. Pertuisot, Inrap/Umr ARTEHIS Ces recherches, qui sont financées par le SRA de Bourgogne-Franche-Comté et soutenues par l’Inrap par l’octroi de jours/hommes, mobilisent plusieurs chercheurs de l’UMR, parmi lesquels Georgie Baudry, Anne-Lise Bugnon et Caroline Lachiche. Fragments d’une céramique mystérieuse © G. Pertuisot, Inrap/Umr ARTEHIS Ce programme est une occasion unique de documenter l’histoire d’un établissement de soin et de relégation, dont peu d’exemplaires ont été abordés jusqu’à présent par le biais de l’archéologie. Gaëlle Pertuisot


La Montagne de Saint-Laurent à Mesmont (21), bilan de la campagne 2023

Responsable : A. Guicheteau La butte-témoin de la Montagne de Saint-Laurent à Mesmont domine largement la moyenne vallée de l’Ouche. Elle offre un plateau de 13 hectares cerné de pentes abruptes et dominé par un éperon central d’environ 3 hectares. Plusieurs campagnes de recherches conduites depuis le XVIIIe siècle montrent que le site est fréquenté depuis le néolithique, et plus intensément au 1er âge du Fer. Les recherches actuelles visent à mieux comprendre la nature de l’occupation du site au cours de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge, période de l’histoire du site jusqu’ici plutôt méconnue, alors même qu’elle livre des vestiges nombreux et bien conservés. Le programme de prospections thématiques de 2019-2021 a démontré l’existence d’une petite agglomération perchée et l’objectif de la fouille programmée pluriannuelle des années 2022-2024 est de mieux l’appréhender (fig. 1). Localisation des zones de fouille sur le plan du site au haut Moyen Âge, établi d’après les données Lidar, géophysiques et de fouilles © A. Guicheteau, avec F. Mona, F.-X. Simon et Matthieu Thivet En effet, si les sources écrites, notamment hagiographiques, permettent d’envisager le site comme un lieu de pouvoir, chef-lieu d’un pagus au haut Moyen Âge, seule l’archéologie est à même de saisir sa matérialité. Deux zones de fouille sont concernées dans ce cadre triennal. Sur l’éperon central, la fouille se concentre sur l’étude d’un vaste bâtiment à abside, probablement un lieu de culte, mesurant près de 27,5 m de long dans l’œuvre (fig. 2). Si l’absence de sépultures questionne, le plan du bâtiment, l’abondance des fragments de verre à vitre ou de luminaires et la présence d’aménagements particuliers, notamment les traces d’une possible barrière de chœur en bois, constituent autant d’arguments en faveur d’une interprétation comme édifice cultuel. Les dernières campagnes de fouilles permettent de préciser le plan et la chronologie de l’édifice, peut-être construit dès le Ve siècle. Elles montrent en tout cas la réalisation d’un vaste programme de construction, que l’on qualifierait volontiers d’édilitaire, sur le sommet du site, et la puissance du commanditaire, d’autant plus que le bâtiment à abside s’insère dans un complexe bâti plus vaste, connu par des sondages des années 1970 rouverts en 2020. À ce stade, la chronologie du matériel récupéré dans ce secteur ne dépasse pas le VIIIe siècle. Fouille de l’abside du probable lieu de culte © A. Guicheteau Sur le plateau, en contrebas de l’éperon central, l’objectif est d’appréhender l’habitat en marge du pôle aristocratique qui se dessine sur la partie sommitale. Les prospections géophysiques de 2020 avaient révélé plusieurs bâtiments sur fondations de pierres. Le choix s’est porté sur le mieux conservé a priori (fig. 3). Il recoupe un petit bâtiment sur solins de pierres de deux pièces, dont l’une présente un sol en béton de tuileau laissant voir le négatif de pilettes d’hypocauste. À ce stade, la stratigraphie et le matériel le situent dans le courant du Ve siècle. Le vaste bâtiment maçonné postérieur, occupé durant les VIe-VIIe siècles, se développe sur environ 22 m de long et sur près de 12 m de large. D’après les premiers résultats, il s’organise autour d’une pièce centrale flanquée de deux annexes et d’une galerie de façade. La qualité de la construction et du matériel récupéré – armement, accessoires vestimentaires, etc. – montrent a priori le statut privilégié de ses occupants, questionnant davantage la nature de l’occupation. À l’issue du programme triennal, les fonctions et datations des édifices devraient être établies. Cela étant, de nombreuses interrogations demeurent à propos du site, notamment sur les formes et les fonctions des autres espaces et aménagements du complexe bâti localisé sur l’éperon central, mais aussi sur l’existence supposée d’un pôle funéraire et religieux à l’emplacement du cimetière paroissial actuel. Toujours est-il que les dernières recherches révèlent l’importance de ce type de site, dont la place est manifestement centrale dans l’organisation sociale, politique et économique du territoire. Vue par drone de la fenêtre de fouille de 2023 © J. Berthet
Collaboration d’ARTEHIS : Georgie Baudry (instrumentum périodes historiques), Florent Delencre (matériau de construction en terre cuite), Franck Ducreux (mobilier âge du Bronze), Axelle Grzesznik (responsable adjointe bâti), Michel Kasprzyk (mobilier Antiquité tardive), Lydie Joan (verre), Régis Labeaune (mobilier premier Âge du Fer)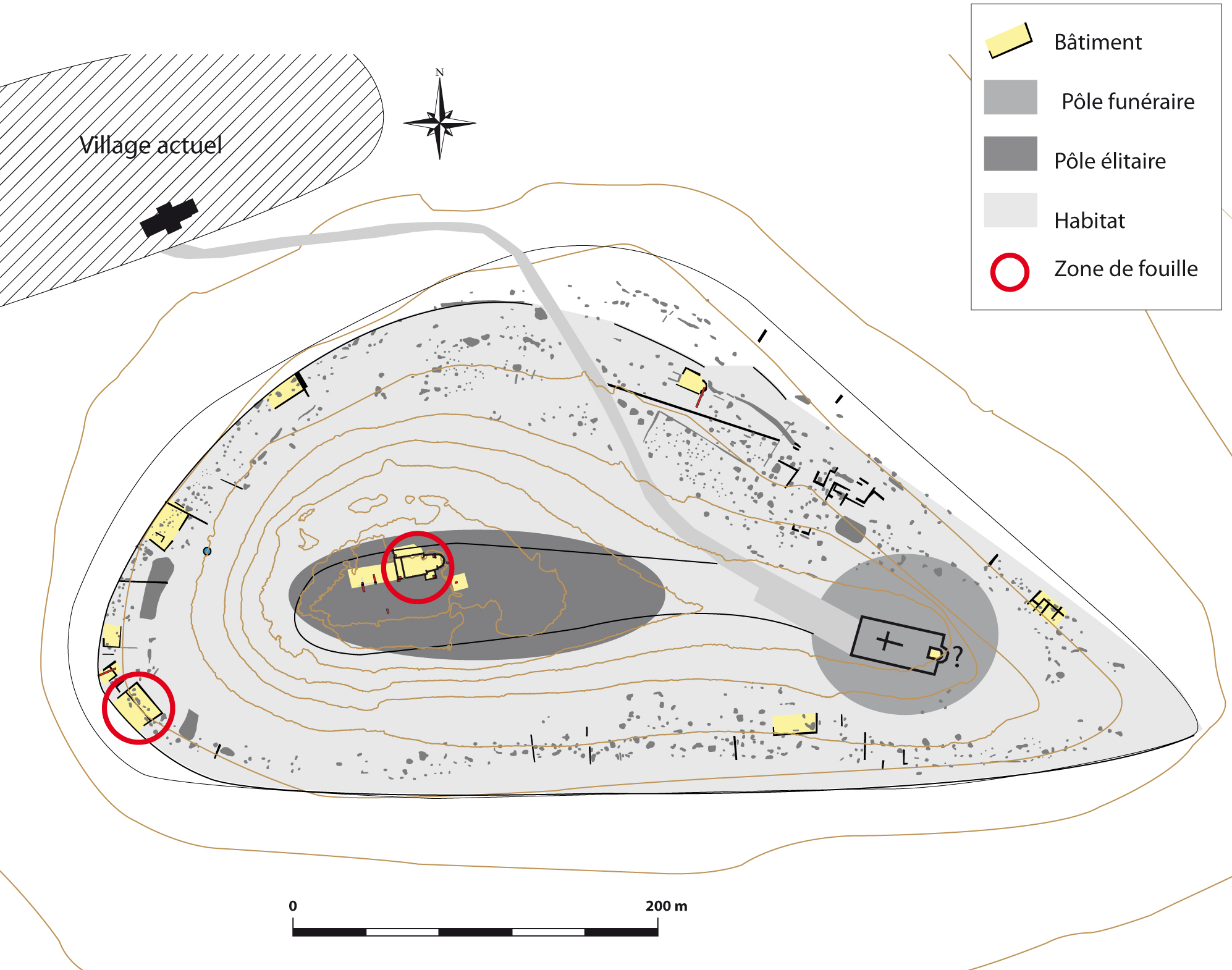


Bilan 2023 de la fouille programmée de la commanderie templière et hospitalière d’Avalleur
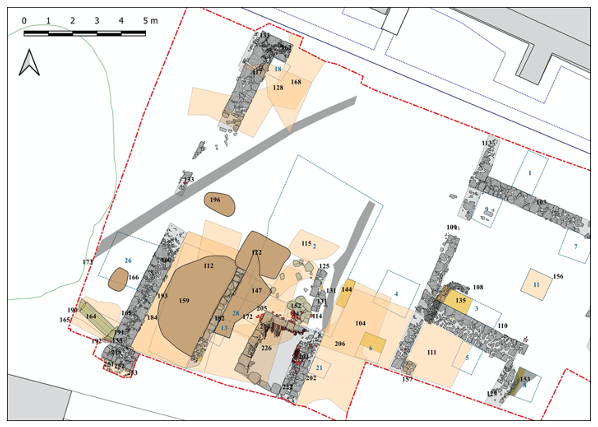
Dans le secteur à l’ouest de la chapelle, des fondations d’une grande largeur, entre 1,70 et 2 m, ont été retrouvées en 2022 et 2023. Leur orientation est divergente par rapport aux bâtiments templiers conservés. Trois maçonneries forment un retour d’angle ; ce sont des murs à double parement avec blocage interne. Les parements sont composés de blocs de calcaire local, parfois d’un très fort module. En 2023, il a été confirmé que ces maçonneries étaient antérieures aux murs de l’aile nord de la fin du 15e s. puisque ses fondations s’appuient en partie sur le mur 174. Nous serions ici face à un bâtiment d’a minima 11,50 m de long sur 8,50 m de large, hors tout. On connait des bâtiments de ce type, entre l’aula et la turris, sur des sites castraux, à l’image du château des comtes de Champagne de Chavot près d’Epernay. Les fondations de l’aile nord de la commanderie ont été retrouvé cette année. Il s’agit de maçonneries moins larges que celle d’époque templière (0,65 à 0,75 m en moyenne). Deux petites pièces ont pu être fouillée, ne livrant qu’un mobilier de leur époque de démolition (fin du 18e s.). La mise en place de cette aile nord remonte en revanche à la fin du 15e s. en lien avec la première extension du corps de logis qui se situe à l’ouest. Au sud de la chapelle, c’est un bâtiment d’origine templière qui a pu être en partie dégagé. Nous avons pu restituer sa longueur complète par la découverte de deux retours d’angle, soit une longueur hors tout de 15 m pour une largeur d’environ 7,85 m, soit une emprise au sol de presque 118 m², 80 m² environ de surface interne. Pour ce qui est de la largeur, nous pouvons en être assurée uniquement côté sud du bâtiment, en revanche sa moitié nord semble avoir été beaucoup plus récupéré puisque aucune maçonnerie, en dehors de l’angle nord-ouest, n’a pu être distinguée. L’emplacement d’un foyer monumental (2,85 x 2 m, soit 5,70 m² au sol) a été fouillé cette année dans l’angle sud-est de cet édifice, nous autorisant à l’identifier selon tout probabilité à la cuisine de la commanderie. La date de construction de ce bâtiment ne peut être déduit du mobilier archéologique retrouvé, puisque seul du mobilier provenant de sa démolition subsiste. En revanche, le fait qu’une canalisation récupérant l’eau de pluie du toit de ce bâtiment ait été mise au jour, puis un fourreau passant dans le mur 218, le tout se dirigeant vers la citerne au centre de la cour, plaide en faveur d’un bâtiment construit sous les Templiers, par analogie avec la chapelle, le corps de logis et l’aile sud, tout cela au sein d’une programme architectural prédéfini, cohérent et donc logiquement d’un même élan chronologiquement parlant ; nous serions face à une construction de la première moitié du 13e s. Ce bâtiment a livré des indices d’un fonctionnement encore a minima jusqu’au début du 15e s. par la présence d’une grande fosse semi-circulaire 184. Celle-ci a livré un abondant mobilier céramique, faunique, métallique, de très nombreuses tuiles et quelques restes de mortier culinaire en pierre. Ces objets sont parfois amalgamés, résultat d’une exposition à un feu intense ; la fosse, organique, noirâtre, est évidemment très charbonneuse. Ce mobilier pourrait donc évoquer une destruction par le feu du bâtiment au début du 15e s.
Fouille programmée de la commanderie templière et hospitalière d’Avalleur (Bar-sur-Seine, Aube)
L’année 2023 marquait la dernière année de la campagne triennale. Deux secteurs ont été à nouveau investigués : à l’ouest de la chapelle et au sud de celle-ci.
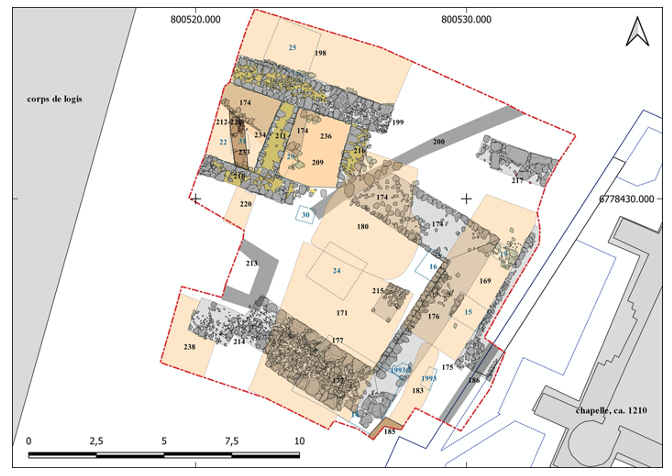
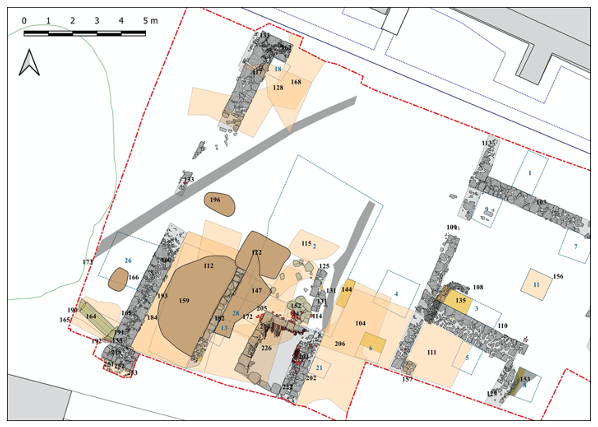
Sondages : Près du tumulus princier de Vix, Fontaine des Abîmes / 2023

Près du tumulus princier de Vix : de nouvelles structures témoignent d’occupations diachroniques autour de la résurgence de la Fontaine des Abîmes Le secteur de la Fontaine des Abîmes présente un fort potentiel géoarchéologique, en raison à la fois de sa situation en plaine alluviale, au croisement de différentes dynamiques hydrosédimentaires, et de la présence de nombreuses structures archéologiques repérées à proximité. Elle se trouve également à moins de 2 km du mont Lassois, soulevant des questions liées aux accès et aux usages de l’eau par les populations. Du 12 au 23 juin 2023, une opération de sondages s’est déroulée à Montliot-et-Courcelles, commune limitrophe de Vix. Sous la responsabilité de Mégane Mignot et dans le cadre de sa thèse de doctorat, ce chantier s’est implanté en rive droite de la Seine en face du tumulus princier en rive gauche, près de la résurgence de la Fontaine des Abîmes. Quatre sondages associés à des problématiques archéologiques et géoarchéologiques ont livré des structures d’époques variées, témoignant d’une fréquentation de la plaine alluviale de la Seine sur le temps long. Notre opération avait pour objectif de vérifier la présence de certaines des structures suspectées, de les caractériser et de les dater. En effet, grâce aux prospections géomagnétiques du Deutsche Archäologische Institut (DAI) réalisées pour le PCR « Vix et son Environnement », une enceinte fossoyée et palissadée ainsi qu’une voie ancienne reliant le site à Châtillon-sur-Seine étaient attendues. De plus, les carottages sédimentaires menés dans le cadre du projet ArcheoGeoVix suggéraient l’existence d’un aménagement permettant de contenir la pièce d’eau associée à la résurgence des Abîmes. Les sondages ont confirmé la présence de ces différentes structures et ont permis de récolter des éléments de mobilier ou du matériel datable par radiocarbone : Ces nouvelles découvertes, inédites dans l’environnement immédiat du mont Lassois, renseignent sur l’évolution de la plaine alluviale et sur les occupations à différentes périodes et pour différents usages autour de la Fontaine des Abîmes. Ces résultats vont aussi permettre de mieux comprendre les conditions d’implantation et de préservation des structures archéologiques dans ce secteur. Cette opération, financée par le SRA Bourgogne-Franche-Comté, s’est déroulé grâce à la collaboration de plusieurs membres du laboratoire : A. Denaire, A. Dumontet, J.-P. Garcia, J. Lauzanne et A. Quiquerez, et grâce la participation de quatre étudiants de L3. Merci à Bruno Chaume et au PCR « Vix et son Environnement » de nous avoir aidé dans l’organisation du chantier. Sondage de l’enceinte : fouille d’un trou de poteau et préparation des photographies du fossé. Sondage du foyer à pierres chauffantes : les nombreuses pierres reposant sur une couche de charbon, comblent la fossé creusée dans les graviers alluviaux du substrat Sondage de la digue : vue du mur qui renforce côté externe la masse d’argiles et de galets. A l’arrière-plan, le sondage de l’enceinte.



L’établissement rural enclos de Villevenard « La Croix Folle » / 2022
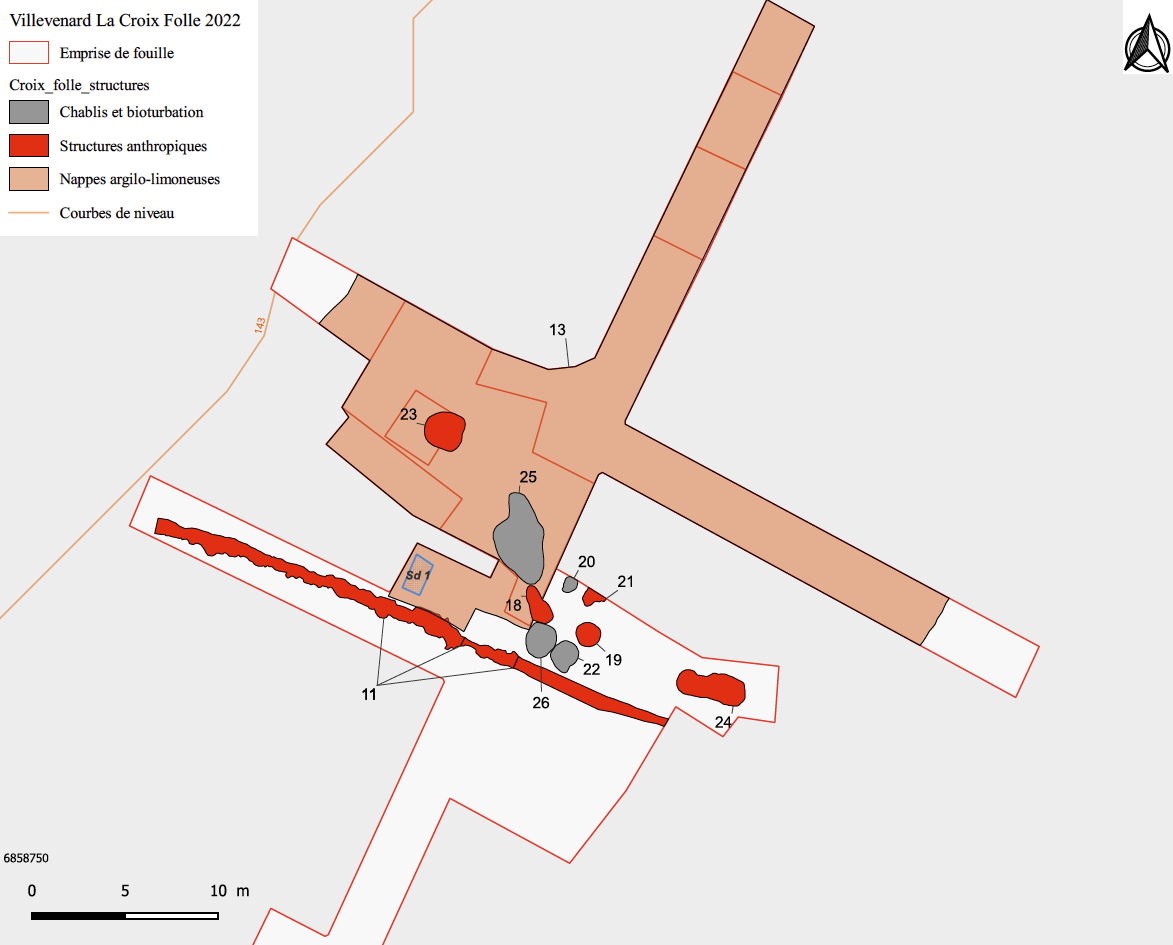
Cette opération de sondage programmé a été menée sur la commune de Villevenard, dans le sud-ouest du département de la Marne dans le cadre du programme collectif de recherche sur les complexes miniers néolithiques des Marais de Saint-Gond (resp. Rémi Martineau) qui porte sur l’occupation du territoire et la détection de sites d’habitat. Dans la partie orientale du décapage, un établissement rural enclos daté entre le Hallstatt final et La Tène ancienne a été mis en évidence. Il borde une couche d’argiles tertiaires (St. 13) riche en mobiliers lithiques et céramiques. L’occupation est délimitée à l’ouest par un fossé rectiligne, d’orientation nord-ouest sud-est, large de 0,80 m et observé sur environ 40 m de longueur (Fig. 1). Elle semble se structurer en deux phases rapprochées, comme le confirment le recouvrement d’une partie des structures par les colluvions argileuses et la fouille manuelle du fossé (St. 11). Dans ce fossé, la première phase livre un profil inconnu mais plutôt profond, bordé par un petit talus composé de l’encaissant extrait. La seconde consiste en un élargissement de la partie supérieure et en un recreusement partiel présentant un fond plat. Le faible écart de temps entre ces deux phases ne permettra peut-être pas de préciser la chronologie. Immédiatement à l’est de l’enclos, cinq fosses ont été fouillées. Un puits St. 19, testé manuellement sur 1,20 m de profondeur (Fig. 2), a livré des céramiques identiques à celles des fosses. Il semble avoir été remployé en fosse détritique dans sa partie supérieure. La fosse St. 24 (Fig. 3) comporte des vestiges détritiques et un comblement organique relevant sans doute de l’exploitation d’un sol anthropisé dans la phase d’occupation de l’enclos. La fosse St. 23, assez profonde et au profil en U, livre un comblement très argileux qui témoigne d’une possible activité artisanale mettant en œuvre un stockage de l’eau ou un travail lié à l’eau. Les mobiliers sont nombreux : céramique, macrolithique, industrie lithique en silex taillé, et dans une moindre mesure, faune et instrumentum métallique. Ceux-ci permettent de considérer d’une part des rejets détritiques d’habitats (céramiques brisées en fond de fosses, outillage domestique…) et des témoins d’activités artisanales probablement liés à de la réduction et/ou du travail du fer. Malheureusement les structures liées à la production métallique n’ont pas été décelées lors de l’opération, bien que la présence de battitures et de scories suggère l’hypothèse d’activités de transformation du minerais de fer. Il faut insister sur le fait que ce site correspondrait alors à la plus ancienne trace d’activité métallurgique du fer connue au niveau régional. L’étude de l’industrie lithique en silex souligne la probabilité d’avoir au moins deux ensembles très distincts : – des silex issus des comblements des structures, qui présentent des caractéristiques expédientes et de l’outillage domestique ubiquiste – des silex de la nappe St. 13 (US 22) qui comportent de nombreux éléments attribuables au Néolithique. Cela conforte en premier lieu qu’il puisse y avoir un débitage et une production d’outils en silex à la fin du 1er âge du Fer. Sur un site où on suspecte par ailleurs une production métallique cela représente un unicum régional. Cette observation apporte aussi un indice chronologique sur la dynamique de mise en place des colluvions argileuses, probablement issues des buttes voisines, et sur la très probable érosion des sols et des sites néolithiques. Le rattachement de l’occupation enclose au Hallstatt final ou à la Tène ancienne s’intègre aux modèles mis en évidence dans la synthèse réalisée sur les nombreux sites de cette période en Champagne, synthèse qui a par ailleurs montré une forte densité des occupations protohistoriques dans la vallée de la Marne. Fig 1 : plan détaillé du nord-est de l’emprise et des structures (J. Desmeulles, F. Langry-François). Fig 2 : vue du fossé d’enclos ST11 (cliché R. Martineau). Fig 3 : vue du site depuis la fosse ST24 (cliché R. Martineau).
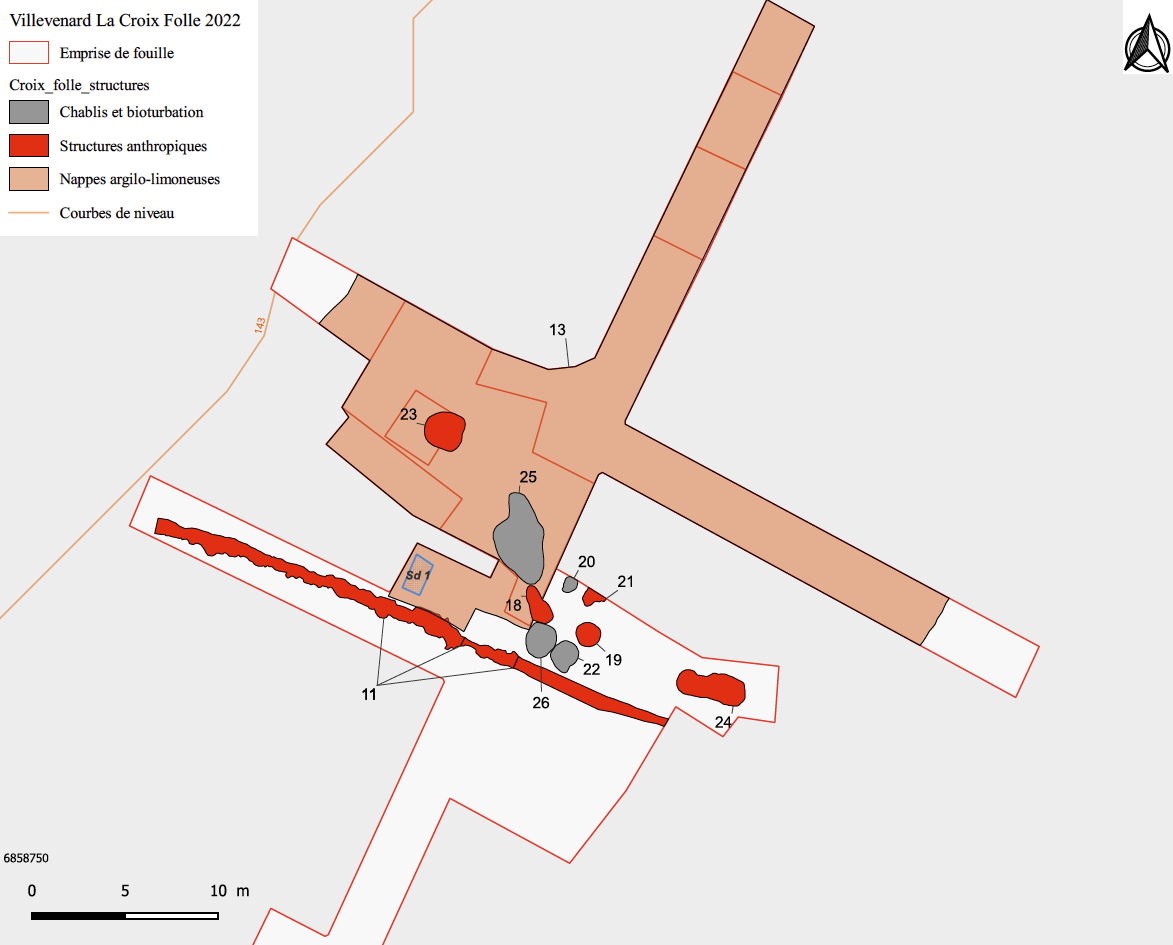


L’évaluation archéologique de Courjeonnet « Les Grands Prés » (Marne) / 2022

La fouille de Courjeonnet « Les Grands Prés » a été réalisée durant l’été 2022, dans le cadre du Programme Collectif de Recherche (PCR) Les complexes miniers néolithiques de la région des Marais de Saint-Gond (Marne), dirigé par Rémi Martineau (CNRS, UMR 6298 ARTEHIS). Son objectif consistait en l’évaluation du potentiel archéologique de cette région du sud-ouest marnais, déjà connue pour la richesse de son patrimoine, notamment néolithique (hypogées, minières de silex, etc.), à travers la réalisation de 49 tranchées (fig. 1 et 2). Le secteur n’a pas été choisi au hasard. Des découvertes anciennes d’Emile Schmit laissaient à penser qu’une occupation néolithique se trouvait à proximité de la zone humide, en bordure nord des marais. Le mobilier découvert à l’époque a fait l’objet d’une étude complète dans le cadre de ce PCR, qui a confirmé les datations supposées. Réalisé sur une surface totale de 4,6 ha, le décapage a livré un faible nombre de structures archéologiques. Malgré les investigations effectuées, aucune n’a pu être rattachée au Néolithique. L’occupation de ce secteur commence réellement à la protohistoire, avec la présence d’un silo, de fosses, de fossés et, possiblement, de trous de poteaux. Ce secteur semble alors être principalement voué à l’agriculture. Des traces d’une activité de taille du silex ont été repérées et confirment que cette pratique a perduré jusqu’à tardivement dans cette région riche en silex. Les données recueillies laissent à penser que l’habitat en lui-même se trouve à proximité de la zone investiguée, probablement au nord, dans un secteur moins sujet aux variations du niveau du marais et à la surface plus régulière. L’occupation gallo-romaine, quant à elle, se limite à un fossé, dont la datation n’est confirmée que par un tesson de céramique. Les périodes médiévale et moderne sont marquées par la présence de quelques fosses d’exploitation de la terrasse et de rejet. Les déchets métallurgiques découverts indiquent qu’un travail du fer a été réalisé à proximité, certainement dans le village de Courjeonnet. La première mention de ce dernier remonte d’ailleurs à 1494. Enfin, la période contemporaine a livré quelques structures indiquant la présence d’une activité d’élevage de bovins dans le secteur avant que les terres ne soient remises en culture. Dans le cadre des analyses paléoenvironnementales mises en place pour comprendre l’évolution du milieu sur le temps long, un bras de marais, encore visible au XIXe siècle, a été recoupé. Il a livré des traces d’écobuage, activité inédite dans la région. Remarquablement bien conservées, ces traces, visibles à travers un niveau de cendre et une couche de terre rubéfiée, révèlent une volonté de la part des populations locales de mettre en culture ce secteur pendant quelques années. Il est possible que cette action soit contemporaine des aménagements protohistoriques, eux-aussi liés à une activité agricole. Qui plus est, le décapage de ce secteur a livré la présence de nombreuses dépressions, terme désignant ici une incision naturelle dans la terrasse weichsélienne pouvant faire plusieurs centaines de mètres carrés et atteindre 1,5 m de profondeur. Outre le fait qu’elles occupent une part notable de la surface sondée, ces dépressions ont livré des niveaux organiques et des colluvions qui ont piégé du mobilier archéologique daté du Néolithique à l’époque moderne. Dans la partie inférieure de deux dépressions, deux paléochenaux ont également été découverts. L’un d’entre eux a d’ailleurs fait l’objet d’une fouille partielle qui a livré du mobilier, notamment protohistorique. Ainsi, l’évaluation archéologique de Courjeonnet « Les Grands Prés » offre un nouvel éclairage sur le paléoenvironnement, les activités et l’habitat en bordure nord des Marais de Saint-Gond. En démontrant l’absence d’occupation au Néolithique et l’aspect irrégulier du terrain, elle permet d’exclure ce secteur des zones habitables pour cette période tout en révélant que des traces d’activités sont visibles dès la protohistoire, et sans doute à partir de la fin du Hallstatt. Les informations recueillies viennent compléter les données de l’évaluation de Villevenard « La Croix Folle », seconde opération du PCR en 2022, réalisée dans un contexte comparable, un kilomètre plus à l’ouest. Anthony Dumontet, Florent Delencre, Rémi Martineau Plan du site de Courjeonnet « Les Grands Prés (DAO : A. Dumontet). Vue aérienne du site de Courjeonnet « Les Grands Prés » (Photo : J. Desmeulles).
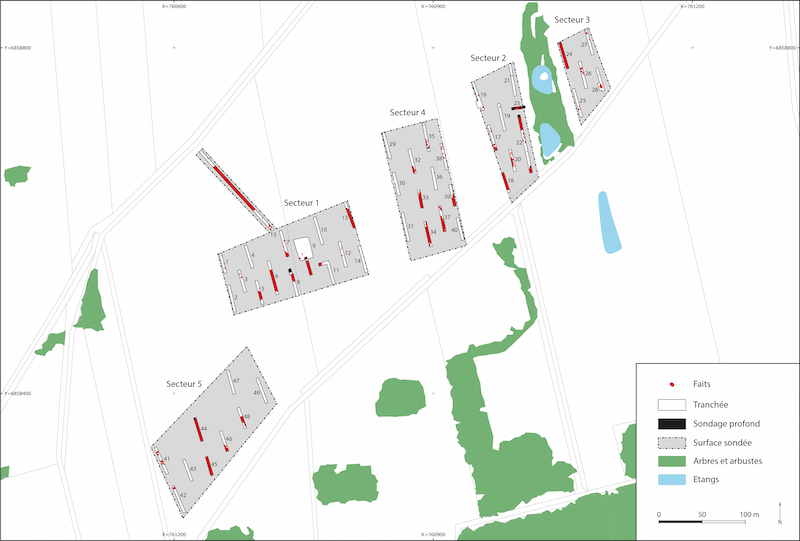

Complexes monastiques et ecclésiaux de l’archipel du Kvarner (Croatie) / 2022

Complexes monastiques et ecclésiaux de l’archipel du Kvarner (Croatie) / campagne 2022 sur le site de Martinšćica (île de Cres) Mission archéologique franco-croate du ministère des Affaires étrangères Responsables : Sébastien Bully (CNRS-UMR ARTEHIS) et Morana Čaušević-Bully (université de Bourgogne Franche-Comté-UMR Chrono-environnement) Participation au chantier : Alex Baqué (masterant UBFC) Dates du chantier : du 6 juin au 1 juillet 2022 1- Vue générale de la baie de Martinšćica et localisation des vestiges (cl. J. Crochat) Résultats La campagne 2022 sur le site de Martinšćica (île de Cres) a permis d’achever la fouille des annexes nord et sud de la grande église paléochrétienne et quasiment mené à terme celle de son vestibule interne. L’annexe bordant le flanc sud du vestibule interne est désormais interprétée comme une tour-porche monumentalisant l’entrée principale dans l’église ; la tour est ouverte au rez-de-chaussée par de larges ouvertures formant un portique qui accueille une tombe maçonnée au-devant du seuil du vestibule. La tour succède à un premier porche formé par deux piliers maçonnés quadrangulaires. Dans un état ultérieur (haut médiéval ?), la tour-porche est tronquée par un étroit couloir longeant les vestibules et menant dans le bras sud du transept en fermant l’annexe sud. Dans son état primitif, cette dernière est un appentis occupé par des banquettes maçonnées le long du parement extérieur de la nef et du bras de transept sud ; dans un second état, des traces de rubéfaction des sols et divers indices plaident en faveur de l’aménagement d’un petit espace artisanal, à moins qu’il ne s’agisse des stigmates d’un incendie. L’annexe est alors traversée par une canalisation provenant de la nef et du vestibule ; ces canalisations évacuent les eaux-vannes résultant d’activités domestiques dans l’ancienne nef et le vestibule, et sont contemporaines de deux grands pots céramiques de stockage enterrés dans le sol du vestibule et de l’annexe nord. Dans son dernier état, alors que les canalisations sont abandonnées, l’annexe sud accueille des inhumations, au-devant du vestibule de la chapelle formé par l’ancien bras du transept sud, datées par C14 des XIIIe-XIVe s. La fouille de cette année a également mise en évidence la fonction funéraire privilégiée du vestibule dans l’Antiquité tardive (dans l’attente de datations C14) avec la découverte de 6 tombes maçonnées, dont 2 en formae au-devant du portail de la nef. Les tombes –pour la plupart perturbées – étaient couvertes d’épaisses dalles monolithes marquetant un sol de mortier strié d’alignement de petits galets, variante d’un opus signinum. 2- L’église paléochrétienne à l’issue de la campagne (cl. S. Bully) Durant cette même campagne, nous avons ouvert un nouveau sondage sur une construction repérée dès 2010 au fond du bras est de la baie, et mené des prospections subaquatiques dans la baie ouest (sur la base de repérages en photographies aériennes) afin de mieux contextualiser le complexe dans son environnement immédiat (à l’instar de l’étude du four à chaux en 2021). À cet égard, les résultats sont éloquents, puisque ces opérations ont confirmé l’existence, dans un rayon de 250 m du complexe villa/église, d’une seconde église, datable des Ve-VIe s., et révélé un tumulus protohistorique liburne, dit de promontoire, aujourd’hui submergé. 1- Fouille d’une tombe maçonnée paléochrétienne dans le vestibule de l’église (cl. S. Bully) En 2022 toujours, un restaurateur professionnel appartenant à l’équipe a achevé la conservation des sols de mosaïques de la nef qu’il avait commencés en 2021 et mené à bien celle des maçonneries des deux cellules de chevet. Publications : ČAUŠEVIĆ-BULLY (M.), BULLY (S.), « Édifices paléochrétiens dans les îles du nord de l’Adriatique », De Corfou à Venise. Adriatique antique, l’Archéologue n°164, décembre 2022-janvier-février 2023, p. 36-40.
ANR MONACORALE (WP 2) / École française de Rome
Antoine Belot (masterant UBFC)
Valentin Chevassu (post-doctorant, UMR Chrono-environnement)
Jessy Crochat (Archeodunum-UMR ARTEHIS)
Anaïs Delliste (UMR ARTEHIS)
Lorenzo Fornaciari (EFR)
Emilie Geoffroy (masterante université Lyon 2)
Léo Gouriten (restaurateur)
Axelle Grzesnik (UMR ARTEHIS)
Marie Lafarge (masterante UBFC)
Damien Martinez (MdC, université Lyon 2-UMR Ciham)
Valentin Metral (doctorant UBFC- UMR Chrono-environnement)
Eugénie Picot (masterante UBFC)
Agnès Stock (UMR Chrono-environnement)
Financements : Ministère des Affaires étrangères français, Ministère de la Culture croate, ANR MONACORALE


Hauteroche (Côte-d’Or) : sondage d’un atelier de potiers gallo-romain – campagne 2021

Des sondages ont eu lieu à Hauteroche du 18 au 27 octobre 2021 sous la responsabilité de Florent Delencre. Dans le cadre du PCR « L’argile et ses usages en Auxois de l’Antiquité à nos jours » coordonné par Fabienne Creuzenet et Florent Delencre Dans le cadre du PCR « L’argile et ses usages en Auxois de l’Antiquité à nos jours » coordonné par Fabienne Creuzenet et Florent Delencre, un recensement a été réalisé pour caractériser l’ensemble des données archéologiques permettant de mettre en évidence des ateliers de potiers et de tuiliers gallo-romains en Auxois. Le site d’Hauteroche « Les Murées d’Hautereilles » avait été sondé en 1972 par Jean Guéritte alors qu’il menait ces fouilles depuis plusieurs années sur l’établissement gallo-romain du « Landran » à Gissey-sous-Flavigny dans la parcelle voisine (Fig. 1). Un atelier de potiers avait de fait été mis au jour, attesté par deux fours présents à une vingtaine de centimètres sous la terre arable (Fig. 2) et des ratés de cuisson conservés au musée d’Alésia. Les monnaies et les ratés de cuisson de vaisselle culinaire permettent de dater de la seconde moitié du IIème et IIIème siècles l’activité dans ce local artisanal, contemporain de la villa de l’autre côté de la voie romaine. En 2019, des mesures magnétiques ont été réalisées sur cette parcelle, afin de définir l’étendue de cet atelier de potier. La prospection magnétique a permis d’identifier l’emplacement exact des vestiges des fours fouillés par J. Guéritte et de confirmer la localisation d’un secteur artisanal. En effet, les résultats suggéraient l’existence de fosses d’extraction, de potentiels foyers et possiblement d’au moins un autre four. L’objectif des sondages a été par conséquent de valider les méthodes géophysiques afin de pouvoir interpréter et définir l’extension et l’organisation des structures associées à l’atelier de potiers. Ils ont été réalisés sous la responsabilité de Florent Delencre (chercheur associé ARTEHIS) et avec le concours de Fabienne Creuzenet (uB, ARTEHIS), Marie-Anaïs Janin (doctorante ARTEHIS), Emma Bardi (université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Alexandre Perrin (bénévole), Georges Thiéry (bénévole) et Anne Guérin (bénévole). Situé sur un plateau, le site s’est avéré de prime abord extrêmement arasé et les structures observées en 1972 ont souffert des pratiques agricoles au cours du temps. Malgré cela, les fours de potiers déjà identifiés ont pu à nouveau être mis au jour (Fig. 3). Par ailleurs, les sondages, implantés dans des secteurs jusqu’alors jamais explorés archéologiquement, ont montré que des structures avaient été conservées sous des niveaux de colluvions ou lorsque elles ont été creusées directement dans le substrat calcaire. Les vestiges d’autres fours de potiers ont ainsi été mis en évidence (Fig. 4), de même qu’un niveau d’occupation gallo-romain centré autour du IIIème siècle sur lequel l’arase d’un mur prend appui. Le site se démarque également par la présence d’une fosse et de trous de poteaux creusés dans le substrat calcaire, dont les comblements ont révélés la présence de mobilier gallo-romain, d’un outil en fer et de la tête d’une statuette en calcaire oolitique (Fig. 5). Cette dernière, découverte remarquable et particulièrement bien conservée faisant écho à la statuaire mises au jour lors des fouilles du « Landran », est en cours d’étude par Pierre-Antoine Lamy (responsable du service recherche et conservation de Bavay, chercheur associé ARTEHIS). Ces résultats nous permettent d’apporter de nouveaux éléments de caractérisation à un site qui s’étend de part et d’autres de la voie romaine menant d’Alésia à Sombernon, dont l’organisation et l’extension semblent plus importantes qu’envisagé jusqu’à encore récemment.Sondages archéologiques sur un atelier de potiers gallo-romain à Hauteroche (21) / 2021
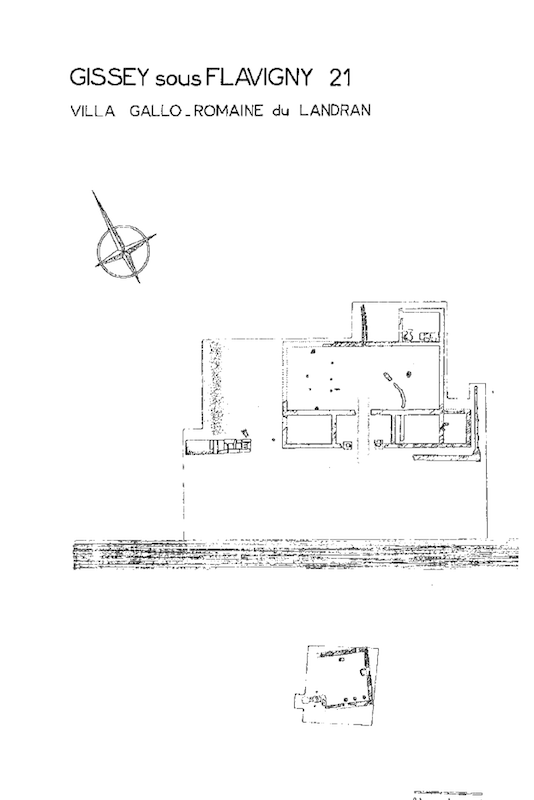




Vix (Côte-d’Or) : Mais où est la paléoseine hallstattienne ? – campagne 2021

Du 7 au 10 septembre, une douzaine de carottages mécaniques a été effectuée conjointement par les équipes d’Artehis et de Chrono-Environnement. L’opération s’est déroulée dans le cadre de la thèse de géoarchéologie de Mégane Mignot, menée sous la direction de J.-P. Garcia et A. Quiquerez. Cette thèse étudie les processus naturels et les occupations humaines ayant permis d’aboutir à la topographie actuelle du site. Elle s’intéresse aussi aux conditions d’implantation et de préservation des structures archéologiques en relation avec les différentes situations géomorphologiques de Vix (plateau, versants, plaine alluviale de la Seine…). L’objectif final étant de proposer des modélisations géoarchéologiques de la dynamique du paysage. Ces travaux sont portés à la fois par le PCR « Vix et son environnement » (Directeur : B. Chaume) et par le projet « ArcheoGeoVix » (Coordinateur : A. Quiquerez) Les carottes ont été réalisées dans le remplissage de paléochenaux. Il s’agit ainsi de restituer les déplacements du lit de la rivière entre la Protohistoire et nos jours, notamment pour savoir où coulait la paléoseine au Hallstatt. À travers une étude paléoenvironnementale et une analyse des séquences sédimentaires des carottes, le but est aussi de reconstituer les paysages passés à l’échelle du territoire de Vix. Les prélèvements issus des forages seront prochainement étudiés en laboratoire : datations radiocarbone, caractérisation chimique par XRF, macro-restes et palynologie…Vix : Mais où est la paléoseine hallstattienne ?



Complexes monastiques et ecclésiaux de l’archipel du Kvarner (Croatie) / campagne 2021

Les complexes monastiques et ecclésiaux de l’archipel du Kvarner (Croatie). Campagne 2021 : le site de Martinšćica (île de Cres) Mission archéologique franco-croate du ministère des Affaires étrangères Fig. 1 – Vue zénithale de l’église et du four à chaux à son chevet (cl. J. Crochat) Fig. 2- Citerne de l’église paléochrétienne partiellement comblée de restes de faunes (cl. J. Crochat) Responsables : Sébastien Bully (CNRS-UMR ARTEHIS) et Morana Čaušević-Bully (université de Bourgogne Franche-Comté-UMR Chrono-environnement) Participation au chantier : Solène Baudin (masterante université de Franche-Comté) Dates du chantier : du 7 juin au 2 juillet 2021 Fig. 3 – Travaux de conservation du sol de mosaïque de la nef (cl. S. Bully) Résultats Fig. 4 – Vue générale des vestiges de l’église depuis le nord (cl. S. Bully) Publications :
ANR MONACORALE (WP 2)


Baptiste Brasleret (masterant université de Franche-Comté)
Thomas Chenal (UMR ARTEHIS)
Valentin Chevassu (UMR Chrono-environnement)
Jessy Crochat (Archeodunum-UMR ARTEHIS)
Anaïs Delliste (UMR Chrono-environnement)
Lucija Dugorepec (aIPAK)
Axelle Grzesnik (UMR ARTEHIS)
Matthieu Le Brech (université de Franche-Comté)
Adrien Lugand (masterant université de Franche-Comté)
Cyprien Mureau (UMR ARTEHIS)
Inès Pactat (UMR IRAMAT)
Eugénie Picod (étudiante université de Franche-Comté)
Agnès Stock (UMR Chrono-environnement)
Anna Tomasinelli (masterante université de Franche-Comté)
Financements : ministère des Affaires étrangères français, Ministère de la Culture croate, ANR MONACORALE
La campagne 2021 a poursuivi la fouille de l’église paléochrétienne de Martinšćica avec la mise au jour d’une citerne sur son flanc nord et de canalisations sud son flanc sud, contemporaine de la transformation de l’église en espace domestique à partir des VIIIe/IXe s. Entre le IXe s. et le XIe s., la citerne nord a été utilisée comme dépotoir pour des restes de préparation et de consommation de faune de la vraisemblable communauté monastique (plus de 7000 restes – étude en cours par Cyprien Mureau/UMR ARTEHIS) ; au sud, une annexe entre le vestibule et le bras du transept a accueilli des inhumations des XIIIe-XIVe s. appartenant à la dernière phase d’occupation du site. La fouille du bras nord du transept a confirmé la présence d’une construction antérieure dont la fonction demeure indéterminée, peut-être liée à la villa maritime antique. Un nouveau secteur funéraire de l’Antiquité tardive a été découvert le long de la grève à l’ouest de l’église, dans ou le long d’une construction (mausolée ?). Au chevet de l’église, le grand four à chaux à l’origine de son dérasement, étudié et sondé par Valentin Chevassu (UMR Chrono-environnement), a pu être daté de l’époque contemporaine. Un travail de conservation des sols de mosaïques de l’église a été mené par un professionnel (Léo Gouriten) et l’inventaire de l’ensemble du verre découvert à l’issue des campagnes de fouilles a été réalisé par Inès Pactat (UMR Iramat Orléans).
Čaušević-Bully, S. Bully, J. Crochat avec la coll. de P. Chevalier, « Quelques considérations sur l’architecture et les installations liturgiques de l’église paléochrétienne de Martinšćica (Punta Križa, île de Cres) », Mens Acris in Corpore Commodo, Zbornik povodom sedamdesetog rođendana Ivana Matejčića / Festschrift in Honour of the 70th Birthday of Ivan Matejčić, ed. by M. Bradanović, M. Jurković, Zagreb-Motovun, 2021, p. 107-125.
Čaušević-Bully, S. Bully, A. Delliste, S. Lefebvre, C. Mureau, « Les sites ecclésiaux et monastiques de l’archipel du Kvarner (Croatie), campagne 2019: Martinšćica (île de Cres), Bulletin archéologique des Écoles françaises à l’étranger, 2021 (https://doi.org/10.4000/baefe.1971)
Pactat, M. Čaušević-Bully, S. Bully, Š. Perović, R. Starac, B. Gratuz, N. Schibille, « Origines et usages du verre issu de quelques sites ecclésiaux et monastiques tardo-antiques et haut médiévaux du littoral nord croate », in A. Coscarella, E. Neri, G. Noyé, Il vetro in transizione (IV-XII secolo). Produzione e commercio in Italia meridionale e nell’adriatico, 2021, p. 289-302.w
Čaušević-Bully, S. Bully, « La mission Kvarner et le programme Complexes monastiques et ecclésiaux de l’archipel du Kvarner du IVe au XIe s. », Catalogue d’exposition, 50 ans d’archéologie Franco-Croate, M. Čaušević-Bully et I. Radman-Livaja, éd., Musée archéologique de Zagreb, 2021, p. 77-93.
Autun (Saône-et-Loire) : géo-archéologie de la Genetoye – campagne 2021

PCR Le complexe monumental de la Genetoye (Autun, Saône-et-Loire) dans son environnement. Approches diachroniques et pluridisciplinaires de la confluence Arroux / Ternin de la préhistoire au Moyen-Age Dates : 5 juillet au 16 juillet 2021 Les résultats de la campagne 2020 ont dessiné les grands traits de l’évolution de la plaine alluviale du Ternin-Arroux à proximité de la Genetoye qui pourraient s’accorder avec les grandes phases climatiques fini-holocènes : dégradation du 1er âge du fer jusqu’au 1er siècle ; optimum romain et médiéval, petit âge glaciaire à partir du XIVe s. Mais ces changements sont aussi en phase avec le creusement et le fonctionnement du grand canal détournant le Ternin en amont du secteur de la Genetoye antique au Ier siècle dont il reste à déterminer la durée de fonctionnement, la date de son abandon et ses relations avec les dépôts agradants ante- et post-antiques mis en évidence sur les secteurs fouillés. La campagne de fouilles de 2021 vise à : Pour réaliser ces objectifs, un ensemble de sondages sédimentaires et de prospections géophysiques ont été réalisées : Ces opérations se poursuivront par un stage de géarchéologie gratifié de 4 mois de master 2- ASA en 2021-2022 Xavier Kelagopian). Les analyses afférentes interviendront en post-fouille : datations 14C, carpologie, sédimentologie, analyse DRX.
Géo-archéologie et structuration du complexe antique (quartier artisanal) de la Genetoye (Autun, Saône-et-Loire) / campagne 2021
Sous la direction de Yannick Labaune
Equipe : 10 étudiants
Responsables : Stéphane Alix (Inrap), avec la collaboration de Jean-Pierre Garcia (Université de Bourgogne Franche-Comté), Marie-Noëlle Pascale (Inrap) et Amélie Quiquérez (Université de Bourgogne Franche-Comté)




Autun (Saône-et-Loire) : Fouille de l’enceinte néolithique des Grands Champs – campagne 2021
PCR Le complexe monumental de la Genetoye (Autun, Saône-et-Loire) dans son environnement. Approches diachroniques et pluridisciplinaires de la confluence Arroux / Ternin de la préhistoire au Moyen-Age Les résultats de la fouille de 2019 mettent en avant la possibilité d’une entrée au nord des zones déjà fouillées, faisant de ce secteur une zone clé dans la compréhension de la structure spatiale de l’enceinte. Toujours dans le même secteur, si l’on en croit le résultat des prospections géophysiques, le tracé des fossés semble s’éloigner de la palissade pour créer un espace important avec la palissade, toujours bien lisible et sans modification de tracé notable. De ces observations découle une possibilité de phasage chronologique de la structuration du site qui voudrait que les fossés aient été réalisés après la palissade, englobant des zones d’extension de l’enceinte originelle, comme c’est peut-être le cas pour le secteur proposé pour la fouille de 2021. Il va sans dire que cette hypothèse ne pourra être levée qu’après fouille et datation des anomalies qui transparaissent sur la cartographie des prospections géophysiques. Un autre intérêt de cette fouille concerne la zone interne à la palissade, qui pourra être explorée dans la périphérie de la gravière moderne. Quelques traces semblant similaire à celles matérialisant les trous de poteaux des bâtiments dans les fouilles de 2017 et de 2018 y apparaissent. La présence de bâtiments à l’intérieur de la palissade a été démontrée pour les fouilles précédentes et reste une question cruciale pour l’analyse spatiale du site. Une zone est également recouverte par les déblais provenant du creusement de la gravière dans le courant des années 50. Un sondage réalisé dans ce secteur jusqu’au substrat géologique permettra de reconnaître la possible conservation d’éléments pédologiques éventuellement préservés sous ces déblais car hors d’atteinte des destructions causées par l’agriculture moderne. La zone proposée à la fouille couvre une surface d’environ 1500 m², sensiblement équivalente à celle fouillée en 2019, mais plus complexe au niveau structurel.Fouille de l’enceinte néolithique des Grands Champs, complexe monumental de la Genetoye (Autun, Saône-et-Loire) (resp. F. Ducreux) / campagne 2021
sous la direction de Yannick Labaune
Campagne 2021 : Fouille de l’enceinte néolithique des Grands Champs (resp. F. Ducreux)
Dates prévisionnelles : 12 juillet au 6 août 2021
Equipe : 19 étudiants
Responsable : Franck Ducreux (Inrap)
Rappel : la campagne de fouille de 2020 a été reportée en 2021
Complexes monastiques et ecclésiaux de l’archipel du Kvarner (Croatie) / campagne 2020

Les complexes monastiques et ecclésiaux de l’archipel du Kvarner (Croatie). Campagne 2020 : le site de Mirine-Fulfinum (île de Krk) Mission archéologique franco-croate du ministère des Affaires étrangères Responsables : Sébastien Bully (CNRS-UMR ARTEHIS) et Morana Čaušević-Bully (université de Bourgogne Franche-Comté-UMR Chrono-environnement) Participation au chantier : Dates du chantier : du 13 au 31 juillet Résultats Les recherches ont porté sur le secteur dit de « l’église à trois absides » (à travers deux fenêtres de fouilles de ± 174 m2 au total). L’objectif principal de la fouille – qui était de caractériser la nature des constructions sur lesquelles est fondé l’église – a été atteint puisque l’ensemble des données recueilli cette année permet désormais de considérer que l’on est en présence de la pars urbana ou de la pars fructuaria d’une villa tardo-antique (IVe s.-VIIe s.). Par ailleurs, un large sondage a confirmé l’extension d’un corps de bâtiment de l’Antiquité tardive en front de mer, formé de plusieurs salles (dont une à hypocauste) ; il pourrait s’agir d’une partie de la pars urbana de la villa. À l’issue de la campagne 2020, nous nous orientons désormais vers l’hypothèse d’une villa érigée dans la deuxième moitié du IVe s. et dont le dominus serait à l’origine de la construction, sur son domaine, du proche « complexe paléochrétien patrimonial » de Mirine. En 2020, Georgie Baudry (UMR ARTEHIS) a également mené une étude exhaustive de l’ensemble de l’instrumentum découvert depuis 2015 sous la forme d’un catalogue. Fig. 1- Vue générale du complexe de Mirine : villa et église haut-médiévale au premier plan ; complexe paléochrétien au second plan (cl. M. Vuković) Fig. 2 – Secteur de fouille à l’issue de la campagne 2020 (cl. M. Vuković)
Lucija Dugorepec (aIPAK)
Adrien Saggese (UMR ARTEHIS)
Agnès Stock (UMR Chrono-environnement)
François Fouriaux (EFR)
Solène Baudin (université de Franche-Comté)
Baptiste Brasleret (université de Franche-Comté)
Lucas Goncalves (université de Franche-Comté)
Camille Albric (université Paris I)
Financements : ministère des Affaires étrangères français, École française de Rome
Sur l’ensemble des activités de terrain du programme portant sur l’archipel du Kvarner, seule l’opération de Mirine a pu être maintenue en 2020 en raison du contexte sanitaire.

Autun (Saône-et-Loire) : le complexe monumental de la Genetoye – campagne 2019
Campagne de fouille 2019 du quartier artisanal Pour continuer d’aborder les problématiques structurelles et artisanales, il a été projeté d’intervenir en 2019 sur la frange orientale du quartier des artisans en limite du sanctuaire, soit à l’opposé des interventions de 2017 et 2018. Le secteur choisi a livré une séquence stratigraphique globalement bien conservée de l’époque augustéenne au milieu du IIIe s. On note, en outre, la présence d’un ensemble assez dense d’infrastructures fossoyées préromaines ne livrant malheureusement qu’assez peu de mobilier dont la datation doit encore être précisée (présence de céramiques modelées de l’Age du Bronze ?). D’autre part, une occupation de la fin du Moyen-Age du début de l’époque moderne (XVe-XVIe s. ?) a été mise en évidence. Les structures médiévales bâties ont relativement peu endommagé la séquence stratigraphique antique. En revanche, dans la partie centrale du décapage, sur environ 200 m², une mise en culture de la même période (maraichage ?) a visiblement conduit à un défonçage important des sols. Pour ce qui concerne l’époque antique, une succession d’unités artisanales a été mise en évidence. Elles sont disposées perpendiculairement à la voie Autun – Bourge à l’intérieur de parcelles étroites et profondes. L’une d’elles, parmi les plus tardives, bien conservée, accueille un atelier de potier du début du IIIe s. recelant l’intégralité des éléments permettant de restituer la chaine opératoire et la nature des productions (bac de décantation, emplacement d’un tour, four, puits, fosses dépotoirs) qui se partagent entre figurines en terre cuite, gobelets en paroi fine engobée et une production plus intimiste de gobelets originaux à décors zoomorphes en relief empruntant à la coroplasthie. Une première impression suggère une production plutôt tournée vers le sanctuaire qui est tout proche. Quant aux unités qui précèdent l’officine de potier, leur production semble essentiellement tournée vers la métallurgie, en particulier des alliages cuivreux. Leur période d’activité semble s’étaler entre le tout début du Ier s. apr. J.-C. (voire la fin du Ier s. av. J.-C. ?) et le IIe s. apr. J.-C. Mais une campagne de fouille complémentaire s’avère nécessaire pour en déterminer précisément les caractéristiques. Une voirie secondaire d’origine augustéenne d’axe nord-sud marque clairement la séparation entre ces unités de productions et un secteur accueillant un ensemble de bâtiments maçonnés de plan stéréotypé, mais de facture soignée. Situés au sein de parcelles plus larges, indépendants les uns des autres, ils sont organisés le long de l’axe reliant le temple dit de Janus et le théâtre du haut du Verger et sont tournés vers le sanctuaire. L’un d’entre eux, en excellent état de conservation, bien visible sur les cartes géophysiques, a été intégralement dégagé. Son plan très canonique est rectangulaire, avec une grande pièce à l’ouest et trois petites pièces à l’est (pavillons). L’occupation pourrait se partager entre production métallurgique (atelier de bronzier puis surtout forge) à l’intérieur de la grande pièce et comptoir de vente le long de l’axe que l’on pourrait avec audace qualifier de « processionnel ». La fouille a permis de mettre au jour un état bâti antérieur (début du Ier s. apr. J.-C. ?), décalé du précédent vers l’ouest, qui n’était curieusement pas du tout visible sur les clichés aériens ou les prospections géophysiques. Il semble qu’il était consacré à des productions en alliage cuivreux. L’architecture, l’organisation spatiale et la position de ces unités les distinguent de la masse des ateliers situés plus à l’ouest, au-delà de la voie secondaire nord-sud évoquée plus haut. Cette distinction trahie-t-elle un statut particulier ? Il pourrait peut-être s’agir d’un ensemble de tabernae (boutiques et ateliers) édifiés dans le but de doter le sanctuaire de la Genetoye de sources de revenus utiles à son fonctionnement.Le complexe monumental de la Genetoye (Autun, Saône-et-Loire) dans son environnement. Approches diachroniques et pluridisciplinaires de la confluence Arroux / Ternin de la préhistoire au Moyen-Age – campagne 2019
Coordination du PCR : Yannick Labaune (service archéologique de la ville d’Autun, UMR 6298 artehis)
Responsable scientifique de la fouille : Stéphane Alix (Inrap, UMR 6249 Chrono-environnement)
Principaux participants : Marie-Noëlle Pascal (Inrap), Co-direction ; Anne Ahü (Inrap, UMR 7041 Arscan), céramologie (vaisselle fine) ; Loïc Androuin (Université de Bourgogne), coroplastie ; François Blondel (docteur, UMR 6298 artehis), dendrochronologie / xylologie ; Laure Cassagnes (Université Panthéon-Sorbonne), instrumentum ; Geneviève Daoulas (Inrap), carpologie ; Jean-Pierre Garcia (Université de Bourgogne, UMR 6298 artehis), géoarchéologie ; Morgane Jal (Université de Bourgogne), lavage, inventaire et conditionnement du mobilier archéologique, acquisitions géophysiques ; Isabelle Jouffroy-Bapicot (UMR 6249 chrono-environnement), palynologie ; Yannick Labaune (service archéologique de la ville d’Autun, UMR 6298 ARTEHIS), encadrement ; Claude Malagoli (docteur, UMR 5138 ArAr Archéologie et Archéométrie Maison de l’Orient et de la Méditerranée), lampes à huiles ; Pierre Mazille (Université de Bourgogne), étude de la métallurgie des alliages cuivreux ; Sylvie Mouton-Venault (Inrap, UMR 7041 Arscan), céramologie (vaisselle commune) ; Amélie Quiquérez (Université de Bourgogne, UMR 6298 ARTEHIS), géoarchéologie
Equipe de fouilles : Loïc Androuin, Claire Antonmattei, Juliette Brange, Léa Chautard, Marion Courcoux, Juliette Garcia, Estelle Humbert, Marie-Anaïs Janin, Wilfried Labarthe, Chloé Linguanotto, Pierre Mazille, Axelle Migeon, Léa Msica, Timothée Ogawa, Klaudia Sala, Aurore Schneider, Markt Van Horn, Lucile Volk, Julia ZimmermannDates du chantier : 1er-19 juillet 2019Financements : DRAC, avec le soutien de Bibracte EPCC, de l’Inrap et de la ville d’Autun.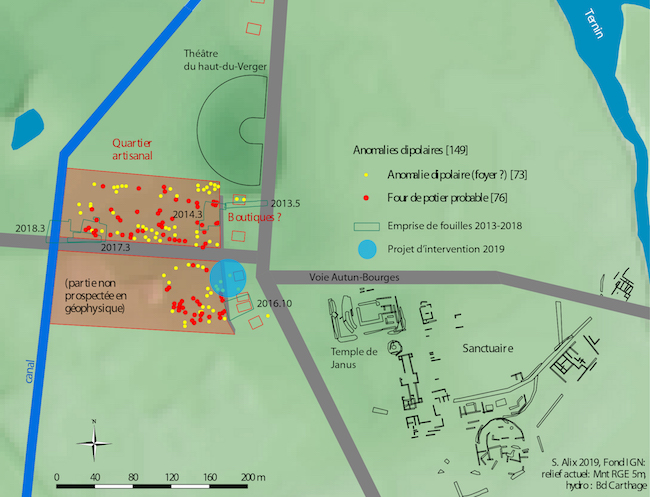

Villevenard (Marne) : « Les Hauts de Congy » – campagne 2019

Responsable : Rémi Martineau Le site de Villevenard « Les Hauts de Congy » a fait l’objet de deux campagnes de fouilles, en 2018 et 2019. Près de 1300 structures ont été relevées sur plan. Cinq bâtiments du Néolithique ancien ont été mis en évidence. Les plans des habitations sont de forme trapézoïdale, ce qui constitue une caractéristique de l’habitat de la culture de Blicquy/Villeneuve-Saint-Germain. La céramique et les bracelets en roches métamorphiques confirment cette attribution culturelle. Douze portions de fosses latérales attenantes à ces maisons ont été fouillées (fig. 1), ainsi qu’une partie des trous de poteaux constituant les tierces. Les plans des maisons de cette culture n’étaient pas connus jusqu’alors en Champagne-Ardenne. La restitution des plans de maisons et de villages constitue un élément essentiel pour la connaissance de l’organisation des communautés du début du Néolithique. Les bâtiments sont orientés est-ouest et mesurent une trentaine de mètres de long. Deux orientations légèrement différentes incitent à penser que le site comporte au moins deux phases chronologiques. Ces différences d’orientation, associées à quelques recoupements entre des trous de poteaux, mais aussi entre certaines fosses latérales de construction, montrent que le village a connu plusieurs phases de construction. Plusieurs fosses comportent des zones de rejets de foyers caractérisés par des concentrations importantes de cendres et de charbons de bois (fig. 2). Ces grandes fosses dépotoirs ont livré des dizaines de milliers de silex taillés, des milliers de tessons de poteries, de la terre cuite provenant sans doute des murs en torchis, du matériel de mouture ou de broyage et des fragments de bracelets. En revanche les ossements ne sont pas conservés. En 2020 la poursuite du décapage permettra de compléter les plans des bâtiments identifiés et de chercher s’il existe de nouvelles maisons.L’habitat du Néolithique ancien de Villevenard « Les Hauts de Congy » (Marne) / campagne 2019
Participation de : Anthony Dumontet et Anthony Denaire
Dates du chantier : 3 juin au 13 juillet 2019
Avec la collaboration de : Anne Augereau (Inrap, UMR 7055 Préhistoire et technologie), Pierre Bodu (CNRS, UMR 7041 Arscan), Jean-Jacques Charpy (Conservateur honoraire du musée d’Epernay), Florent Delencre (chercheur associé UMR 6298 ARTEHIS), Anthony Denaire (Université de Bourgogne, UMR 6298 ARTEHIS), Jonathan Desmeulles (MSH Dijon), Anthony Dumontet (CNRS, UMR 6298 ARTEHIS), Patrick Huard (Inrap), Marie Imbeaux (doctorante, UMR 6298 ARTEHIS), Bernard Lambot, Guillaume Lépine
Equipe de fouille : Julien Bataille, Anysia Belanjon, Cloé Bernier, Jean-Jacques Charpy, Marie Cinqualbre, Iscia Codjo, Ossian Creisson, Lucas Cressini, Aurélien Décaudin,
Florent Delencre, Louise Derbord, Chloé Doideau, Anthony Dumontet, Antoine Farcette, Clément Goupy, Maelle Lafon, Zélie Laurendeau, Guillaume Lépine, Mathilde Mansuy, Rémi Martineau, Yanis Mokri, Lena Morisse, Tiphaine Pabois-Maumené, Hermine Pillet, Marilou Renard, Manon Ricart, Marie Rouppert, Inès Sanfilippo, Louise Ther, Alexandre Toutzevitch, Anaïs Viennot
Financeurs : DRAC, Département de la Marne,Communauté d’Agglomération d’Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne, et Communauté de communes des Paysages de la Champagne) avec le soutien de la MSH de Dijon.
Martinšćica (Croatie) : l’église paléochrétienne – campagne 2019

Mission archéologique franco-croate du ministère des Affaires étrangères Après que 2018 ait été exclusivement consacrée aux travaux de conservation des maçonneries en élévation de l’église paléochrétienne de Martinšćica, la campagne de fouille 2019 a porté : 1- sur la nef ; 2- sur les tombeaux du bras sud du transept ; 3- sur la chapelle latérale sud et son annexe. La fouille des deux tiers de la nef a révélé un sol de mosaïque aux motifs géométriques, assez bien conservé sur les côtés, mais fortement endommagé dans la partie centrale. Des vestiges de structures légères sur poteaux, comme des traces de foyers et des rejets de consommation (qui restent à dater et à déterminer) trahissent un abandon de la fonction originelle de la nef et une réoccupation domestique (sporadique ?). L’une des hypothèses de travail est le transfert de la fonction culturelle de l’église dans sa chapelle latérale sud et sa transformation en une sorte de cour intérieure distribuant les différentes annexes-cellules. L’identification « d’unités domestiques », possiblement monastique, dans certaines annexes latérales de l’église a été renforcée cette année par la découverte d’une nouvelle latrine dotée d’une fosse sceptique. Les datations obtenues jusqu’à présent (OSL et C14) situent la construction de ces « cellules » au VIIIe s. et leur occupation jusqu’au XIe-XIIe s. Cette datation tardive est celle que nous retenons également pour l’installation du dernier dispositif liturgique de la chapelle latérale sud du VIe s. (podium du sanctuaire, autel et barrière de chœur). Mais la découverte majeure en 2019 est celle d’un baptistère, antérieur à la chapelle à abside outrepassée. La salle baptismale, adossée contre l’église paléochrétienne, dans l’angle formé par le bras sud du transept et le chœur, peut être datée du Ve s. ; elle conserve une cuve baptismale et une possible fosse à reliques. Dans un second temps, la salle, de plan quadrangulaire, est augmentée d’une abside semi-circulaire. Les tombes maçonnées de type formae découvertes dans le bras sud du transept en 2017 ont été fouillées cette année ; les datations C14 indiqueront si elles sont contemporaines de la chapelle sud ou du baptistère. La villa maritime connexe à l’église a été incidemment documentée par la découverte d’un fragment d’inscription lapidaire – en remploi dans la chapelle sud – mentionnant un nom (du dominus ?) et une probable dédicace à la déesse Diane. Martinšćica, vue générale de l’église à la fin de la campagne 2019 (cl. Jelena Behaim et Ivor Kranjec) Martinšćica, plan schématique de l’église et de ses annexes, campagne 2019 (cl. JB/IK, plan M. Čaušević-Bully ) Martinšćica, mosaïque de la nef en cours de fouille (cl. S. Bully) Martinšćica, latrine de la « cellule » VIIIb avec sa couverture de dalles (cl. S. Bully)Les complexes monastiques et ecclésiaux de l’archipel du Kvarner (Croatie). Campagne 2019 : l’église paléochrétienne de Martinšćica / campagne 2019
Responsables : Sébastien Bully (UMR ARTEHIS), Morana Čaušević-Bully (université de Bourgogne Franche-Comté-UMR Chrono-environnement)
Participation d’Adrien Saggese (UMR ARTEHIS, étude de la céramique), Jessy Crochat (étude de la sculpture), Lucija Dugorepec (étude anthropologique), Agnès Stock (UMR Chrono-environnement), François Fouriaux (EFR, topographie), Anaïs Deliste (UMR Chrono-environnement, étude anthropologique), Solène Baudin (université de Franche-Comté), Baptiste Brasleret (université de Franche-Comté), Lucas Goncalves (université de Franche-Comté), Lucie Gonçalves (université de Franche-Comté), Camille Albric (université Paris I)
Et les contributions de Pascale Chevalier (UMR ARTEHIS), Ana Konestra (Institut za arheologiju iz Zagreba), Anthony Dumontet (UMR ARTEHIS, compléments infographiques du plan de Martinšćica), Cyprien Mureau (doctorant-allocataire, UMR ARTEHIS, étude préliminaire des restes de faune de Martinšćica), Sabine Lefebvre (UMR ARTEHIS, épigraphie antique), Marine Rousseau (doctorante UBFC, palynologue), Laurent Popovitch (UMR ARTEHIS, numismatique antique), Mario Novak (Institut d’anthropologie de Zagreb), Matthieu Le Brech (UBFC, restitution 3D), Jelena Behaim et Ivor Kranjec (université de Zagreb)
En partenariat avec EFR/aIPAK/APAHJ
Dates de chantiers :
– du 23 au 26 avril et du 7 au 10 juin : accompagnement archéologique et contrôle des travaux de conservation des vestiges de Mirine ;
-du 10 au 29 juin : fouilles programmées de l’église de Martinšćica
Financements : ministère des Affaires étrangères français, ministère de la Culture croate, École française de RomeRésultats




Saint-Dizier (Haute-Marne) : « Les Crassées » – campagnes 2017-2019
Dates de fouilles : du 06 juin au 07 juillet 2017, du 04 juin au 06 juillet 2018 et du 27 mai au 12 juillet 2019 Le contenu des trois campagnes de fouilles qui viennent de s’écouler est dans le prolongement des précédentes, qui ont lieu chaque année depuis 2011. L’exploration se poursuit en deux secteurs distincts. Le premier, au sud, au sommet du versant de la vallée de la Marne, est le plus riche puisqu’il contient à la fois une occupation domestique antique et une occupation funéraire médiévale longue de sept-cents ans. Le second, au nord, au pied du versant, ne contient que l’occupation antique et, pour l’heure, de maigres éléments médiévaux. En revanche l’état de conservation des niveaux d’occupation et d’abandon est bien meilleure grâce à sa position en pied de pente. L’occupation gallo-romaine est donc présente dans les deux secteurs (figure 2). Elle se manifeste par deux bâtiments résidentiels en dur, un dans chaque secteur. Le plus ancien est situé au sud, sur le sommet du versant. La date de sa construction est actuellement située vers le milieu du Ier s. de notre ère. Il est loin d’être intégralement exploré, y compris dans sa partie décapée. Il y a de fortes chances pour qu’il ne subsiste que peu d’éléments d’origine tant l’occupation funéraire postérieure est intrusive à cet endroit. Le bâtiment résidentiel installée plus au nord, au pied du versant, est construit au plus tôt à la fin du IIe s. Il est légèrement désaxé par rapport au précédent. Seule son extrémité sud est actuellement connue (figure 3 et 4), les trois dernières campagnes n’ayant permis de fouiller qu’une partie des strates qui recouvrent les maçonneries des salles balnéaires : elles atteignent 1,60 m en moyenne. Les strates d’occupation sont particulièrement riches en mobilier, notamment dans le praefornium le plus exploré, où des recharges argileuses alternent avec des couches de cendres, le tout formant un feuilleté chronologiquement précis, qui démontre que la chaufferie fonctionne jusqu’à la fin du IVe siècle. Au-delà, cette partie du bâtiment n’est ni occupée ni entretenue : l’effondrement à plat d’un pan entier de mur scelle les niveaux d’occupation. Dans la galerie de façade voisine, les niveaux d’occupation sont recouverts par la toiture de dalles calcaires effondrée, mêlée à l’enduit peint des murs, manifestement tombé au même moment. Les motifs ne sont pour l’heure pas connus, faute de reconstitution. Seul un moucheté rouge sur fond blanc au niveau des plinthes est avéré, surmonté d’une large ligne rouge marquant probablement le début du registre principal. L’occupation du Ve siècle ne se manifeste pour l’heure que par du mobilier détritique dans les niveaux d’abandon. L’aménagement médiéval le plus ancien reste une sépulture aristocratique du début du VIe siècle, fouillée dans la partie sud en 2015. Les campagnes suivantes permettent en revanche de prouver l’existence d’un bâtiment en dur au même endroit, datant au plus tard du VIIe siècle, qui réinvestit une pièce gallo-romaine excavée (figure 5). Toujours en cours de fouille, elle contient pour l’heure au moins deux phases architecturales dont les murs de pierres ne présentent pas de traces de liant. Sur le fond, une aire rectangulaire de 5 m² est davantage décaissée pour armer le sol d’un radier de gros blocs de calcaire. Hélas le contenu de cet espace est intégralement bouleversé par un creusement postérieur à l’occupation funéraire, manifestement destiné à visiter en détail la pièce. Les fragments d’armes et de bijoux mérovingiens rencontrés dans le sédiment laissé par les visiteurs, ainsi que les nombreux restes humains, laisse deviner la nature des dépôts détruits. La sépulture aristocratique conservée appartient donc probablement à un regroupement élitaire dont le reste est détruit. Les inhumations datées avec certitude de la période mérovingienne sont rares dans le reste de la nécropole. Parmi les huit-cents et quelques étudiées à ce jour, elles ne sont qu’une quinzaine. La difficulté réside dans la destruction d’une majorité d’entre elles par les tombes postérieures mais aussi par l’absence de mobilier d’une autre part, à l’image de celles que des datations radiocarbones révèlent de manière inattendue. A l’inverse, les trois dernières campagnes n’apportent qu’une seule inhumation à scramasaxe et à élément de ceinture métallique. Son emplacement est toutefois à retenir : elle est aménagée contre le mur interprété comme le deuxième état de l’édifice mérovingien, du côté extérieur. Les deux inhumations en arme exhumées lors des campagnes antérieures à 2017 sont d’ailleurs elles aussi toutes proches. Les conclusions formulées en 2016 au sujet des deux phases architecturales de l’édifice cultuel du IXe au XIIe s. restent inchangées. Seule la mise en évidence d’un léger désaxage des deux plans est à ajouter. En revanche leur environnement est mieux connu. A l’est, autour du chevet du dernier état, les inhumations côtoient deux ossuaires, des constructions sur poteau et des structures de combustion datées du XIe et XIIe s. Mêmes si ces types d’aménagement peuvent exister au cœur de cimetières paroissiaux, ceux des Crassées annoncent probablement la périphérie du cimetière car plus à l’ouest, elles sont totalement absentes. Au même endroit, la préservation de deux états de sol est également à noter. Le plus récent, daté du XIe au XIIIe s., est exclusivement constitué d’un épandage de centaines de kilogrammes de scories de de fer. Il témoigne de la grande quantité de minerai réduit par les habitants de la paroisse après la période carolingienne. Les défunts du Moyen âge central constituent à ce jour la majorité des individus datés. Sur les quarante-huit datations radiocarbones réalisées, seules huit sont antérieures au XIe s. Les pratiques funéraires de cette période sont très homogènes à l’exception des orientations. En effet plusieurs tombes, toutes situées dans la partie sud du cimetière, présentent une orientation nord/sud totalement atypique pour cette période. Ce phénomène demandera à être éclairci dans les années à venir. La plupart semble inhumée en cercueil de bois chevillé (rarement cloué) mais certains sont déposés dans des sarcophages antérieurs. D’autres, peut-être plus anciens d’après une des datations radiocarbones, sont allongés dans une bille de chêne évidée, donnant une taphonomie particulière au squelette.Saint-Dizier « Les Crassées » (Haute-Marne) : bilan du deuxième programme triennal / campagnes 2017-2019
Responsables : Raphaël Durost (Chargé de recherches, Inrap, UMR 6298 ARTeHIS), Stéphanie Desbrosse-Degobertière (Chargée de recherches, Inrap, UMR 6273 CRAHAM)
Collaborateurs : Mathilde Bolou (Université d’Aix-Marseille), Nicolas Delferrière (Université de Bourgogne-Franche-Comté, UMR 6298 ARTeHIS), Anne Delor-Ahü (Inrap, UMR 7041), Serge Février, Cyril Jourdain (Université de Bourgogne-Franche-Comté), Mikaël Sévère, Pierre Testard (Inrap), Marie-Cécile Truc (Inrap, UMR 6273 CRAHAM)L’occupation gallo-romaine
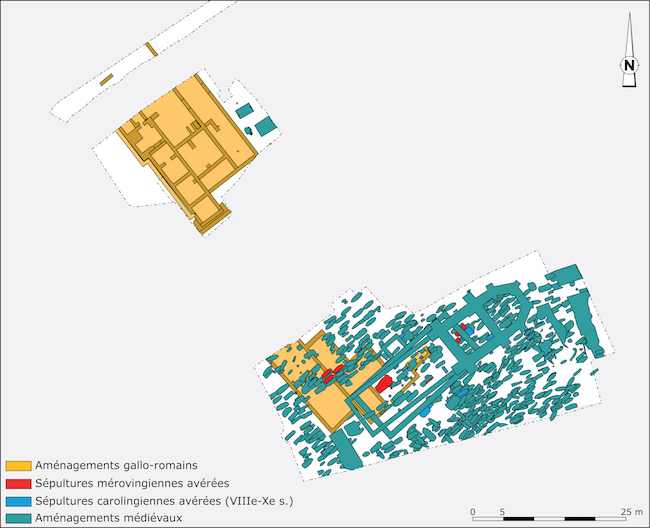
Ces campagnes montrent que les bains de cette phase sont équipés de deux praefornia, chauffant en tout quatre pièces par hypocauste. Dans un second temps, au plus tôt dans le dernier quart du IIIe s., les salles chauffées sont divisées en deux espaces séparés, toujours avec les deux mêmes praefornia. Une entrée est désormais localisée dans la galerie de façade. Large de 3 mètres, elle permet d’accéder aux bains depuis une cour, et fait face à un escalier descendant dans un des praefornia.
L’occupation mérovingienne

L’occupation carolingienne et centro-médiévale
Si l’absence totale de mobilier d’accompagnement est la règle, quelques exceptions singulières sont à signaler : à ce jour, trois individus adultes sont accompagnés d’une clef en fer volontairement déposée, sous les vertèbres cervicales dans un cas, sous les vertèbres lombaires pour le second et sous le tibias pour le dernier. La signification de ce geste rare demeure inconnue et les comparaisons quasi inexistantes.
Autun (Saône-et-Loire) : le complexe monumental de la Genetoye – campagnes 2012-2018

Présentation générale du programme, synthèse des travaux engagés entre 2012 et 2018 Le Programme Collectif de Recherches Autun-Genetoye fédère des équipes pluridisciplinaires autour de trois axes : Deux équipes ont été convoquées en 2013 pour explorer en aire ouverte, dans le cadre de fouilles pluriannuelles, les deux édifices phares de la panoplie monumentale du complexe, à savoir le temple dit de Janus et le théâtre du haut du Verger. Six campagnes de fouilles se sont succédé de manière continue au niveau du temple sous la direction de Martine Joly (professeur des université, Université de Toulouse) permettant l’exploration des abords du monument dans l’emprise de son péribole. L’exploration s’est achevée en 2018 par l’investigation de l’intérieur de la cella du grand temple encore conservé en élévation. Trois campagnes de fouilles sur le théâtre ont quant à elles été réalisées en 2013, 2014 et 2016 sous la direction de Filipe Ferreira (docteur en archéologie, Université de Paris-Sorbonne). Une troisième équipe a été constituée en 2013 dans l’objectif de préciser la chronologie et la fonction des différents espaces reconnus par les prospections géophysiques à l’intérieur du complexe. Six campagnes de fouilles pluriannuelles se sont succédées de manière continue, les quatre premières, entre 2013 et 2016, étant placées sous la direction de Matthieu Thivet (Ingénieur, Université de Franche-Comté). Stéphane Alix (chargé d’études et de recherches, Inrap) lui a succédé en 2017 dans le cadre d’une fouille triannuelle (année probatoire en 2017, première année de la triannuelle en 2018). Dans ce cadre, le secteur artisanal a été exploré en 2014 et 2017, et ces deux campagnes complémentaires ont permis d’envisager à l’échelle du quartier la part importante occupée par les productions en terre cuite (il s’agit principalement de vaisselle, mais aussi de figurines et de lampes) à laquelle s’ajoute, dans une moindre mesure, un ensemble de productions variées (forge, travail des alliages cuivreux, tabletterie, boucherie…). Un ensemble d’édifices d’époque romaine a également pu être exploré à cette occasion entre 2013 et 2016. Les deux premiers, de plan simple et de taille modeste, se situent à l’interface entre le quartier artisanal et le secteur monumental : l’un fouillé exhaustivement en 2016 a été interprété comme une « boutique », l’autre sondé en 2013 comme une « taverne » jouxtant le théâtre du haut du Verger. Le troisième édifice s’élevait quant à lui dans le secteur monumental et il a été interprété comme un complexe thermal suite à son exploration partielle en 2015. Enfin le principal axe viaire traversant le complexe, la voie menant d’Autun à Bourges, a pu bénéficier d’une fenêtre d’intervention en 2018 afin notamment d’en préciser la chronologie. Cette opération a également permis d’appréhender les caractéristiques du canal artificiel limitant l’extension du quartier d’artisans et du système de franchissement de ce canal par la voie précédemment citée, mais aussi de développer un volet paléo-environnemental. Une quatrième et dernière équipe, prévue dès le démarrage du programme, n’a pu être constituée qu’en 2017. Elle s’attache à étudier les modalités d’occupation de ce secteur de confluence à la période préhistorique, en explorant dans un premier temps les vestiges de l’enceinte néolithique des Grands Champs dans le cadre d’une fouille pluriannuelle sous la direction de Franck Ducreux (chargé d’études et de recherches, Inrap). L’année 2017 a été conçue comme une année a vocation probatoire, dont le but était d’évaluer le potentiel archéologique du site, son état de conservation et sa datation, ouvrant sur une fouille programmée d’une durée de trois ans (2018-2020). Les questions principales s’articulent autour de la chronologie et de l’organisation spatiale du site, mais également de son potentiel scientifique dans une région ou ce type d’aménagement reste méconnu.Le complexe monumental de la Genetoye (Autun, Saône-et-Loire) dans son environnement. Approches diachroniques et pluridisciplinaires de la confluence Arroux / Ternin de la préhistoire au Moyen-Age
Coordination du PCR : Yannick Labaune (service archéologique de la ville d’Autun, UMR 6298 artehis)
Responsables scientifiques d’opération en 2018 : Stéphane Alix (Inrap, UMR 6249 Chrono-environnement) Philippe Barral (Université de Franche-Comté, UMR 6249 Chrono-environnement), Franck Ducreux (Inrap, UMR 6298 artehis), Martine Joly (Université de Toulouse, UMR 5608 Traces)
Principaux participants : Stéphane Alix (Inrap, UMR 6249 Chrono-environnement) Philippe Barral (Université de Franche-Comté, UMR 6249 Chrono-environnement), Franck Ducreux (Inrap, UMR 6298 artehis), Filipe Ferreira (IRAA, USR 3155), Mathias Glaus, Martine Joly (Université de Toulouse, UMR 5608 Traces), Yannick Labaune (service archéologique de la ville d’Autun, UMR 6298 artehis), Marie-Noëlle Pascal (Inrap), Matthieu Thivet (Université de Franche-Comté, Université de Franche-Comté, UMR 6249 Chrono-environnement)
Institutions engagées : Universités de Franche-Comté, de Paris-Sorbonne, de Toulouse ; Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, Service Archéologique de la Ville d’Autun
Financements : DRAC, avec le soutien de Bibracte EPCC, de l’Inrap et de la ville d’Autun.



Autun (Saône-et-Loire) : le temple dit de Janus- Campagne 2018
Coordination du PCR : Yannick Labaune (service archéologique de la ville d’Autun, UMR 6298 artehis) L’intervention à l’intérieur de la cella du grand temple, qui constitue le centre géométrique du sanctuaire sur toute la durée de l’occupation a fourni des données très substantielles sur les occupations antérieures au Moyen-âge, notamment celles relevant de l’époque laténienne, compte tenu de l’excellent état de conservation des preistoireantvestiges. Un sondage réalisé à l’extérieur de la tour centrale, bien qu’exigu, complète quant à lui avantageusement notre connaissance des données planimétriques de l’état 2. En revanche, aucun vestige significatif postérieur à la fin du IIIe siècle n’a été détecté sur les deux fenêtres d’intervention, susceptible notamment de préciser les modalités de réoccupation de la tour centrale à la période médiévale. Les données concernant l’occupation laténienne du site (état 0) sont particulièrement importantes. En effet, sur la base des résultats des campagnes précédentes, il était possible d’avancer l’existence d’un lieu de culte gaulois faiblement aménagé, sans structures architecturales conséquentes, illustré par des pratiques de dépôt de micro-vases et de monnaies, en faible nombre, et de quelques rares autres objets (fibules, fragments de bracelets). La campagne 2018 a démontré que cette image était erronée et qu’il existait bien un sanctuaire construit, dont les vestiges enfouis sous la cella du grand temple correspondent à deux bâtiments successifs en architecture de terre et bois, volontairement incendiés. Le fait que les objets manifestement déposés matérialisent une aire de dispersion localisée immédiatement à l’est du mur de la cella du grand temple suggère la possibilité que cette dispersion soit associée à une ouverture des bâtiments située côté est. La datation de ces deux bâtiments reste vague, en l’absence de mobilier datant. Il faudra attendre les résultats de datations archéométriques pour en savoir plus. On peut toutefois préciser que la construction du tronc monétaire de l’état 1, auquel est associé un corpus d’une quarantaine de monnaies, qui se constitue à partir des années 40/30 av. J.-C., fournit un terminus ante quem pour l’abandon du bâtiment le plus tardif. La découverte du tronc monétaire précédemment cité constitue une découverte majeure de la campagne 2018. Il s’agit en effet d’un des très rares exemples en Gaule illustrant ce type de structure, destiné à rassembler des offrandes monétaires de faible valeur. Son mode de construction qui met en œuvre la pierre sèche (non équarrie), le bois, sous forme de madriers, et la terre, l’inscrit pleinement dans la physionomie architecturale de l’état 1, période d’occupation augusto-tibérienne, renseignée par des données très lacunaires lors des campagnes précédentes. Il ne restait aucune trace du bâti associé à ce tronc dans la fenêtre d’intervention, qui est localisé hors emprise de la fouille ou bien arasé entièrement lors de la construction du sanctuaire de l’état 2. La cella du temple de l’état 2 (second tiers du Ier s.) a également été retrouvée sous la cella conservée en élévation. Le sol en parfait état de conservation est constitué d’un béton réalisé à partir de fragments d’amphores dont la surface est rehaussée de rouge. Le tracé du mur occidental de la cella, conservé à l’état de lambeau, a pu être précisé. Le temple est entouré d’un péribole périphérique dont l’angle sud-ouest a été découvert dans le sondage extérieur. L’état 3 (construction vers 70), correspond au sanctuaire à péribole et galerie périphériques associé à la cella du temple encore partiellement en élévation, a pu être subdivisé. Dans un premier temps l’intérieur de la cella comporte un sol pavé de dalles de calcaire de plein pied par rapport à la galerie périphérique. Il n’en reste que le mortier de pose en mortier de tuileau dans lequel se dessinent les négatifs des dalles récupérées dès la période antique. Les soubassements maçonnés d’un dispositif à usage indéterminé particulièrement massif (piédestal ?), déjà repérés au XIXe s. par J.-G. Bulliot lors de ses investigations, ont été découverts. Par la suite, le sol de circulation de la cella est significativement rehaussé, travaux qui s’accompagnent d’une reprise en profondeur du bâti de la tour centrale et de la construction d’un escalier monumental dont les fondations ont été mise en évidence par le passé. Les indices font cependant défaut et l’archéométrie sera convoqué afin de préciser, là aussi, la chronologie. Malheureusement les horizons de l’époque médiévale ont été intégralement écrêtés, peut-être par les investigations de J.-G. Bulliot, voire plus vraisemblablement à date plus ancienne. La datation de l’état médiéval 1, caractérisé par la présence d’un fossé d’enceinte et de structures associées correspondant à un encastellement de la cella du grand temple, actuellement comprise entre le XIe et le XIIIe s. sera difficile à préciser.Le complexe monumental de la Genetoye (Autun, Saône-et-Loire) dans son environnement. Approches diachroniques et pluridisciplinaires de la confluence Arroux / Ternin de la préhistoire au Moyen-Age / Campagne de fouille 2018 du temple dit de Janus
Responsables scientifiques de la fouille : Philippe Barral (Université de Franche-Comté, UMR 6249 Chrono-environnement), Martine Joly (Université de Toulouse, UMR 5608 Traces)
Principaux participants en 2018 : Rafaëlle Algoud (Université de Toulouse, étude céramologique) ; Valentin Chevassu (Université Bourgogne-Franche-Comté), responsable époque médiévale ; Nicolas Delferrière (Université Bourgogne-Franche-Comté), étude des enduits peints ; Matthias Glaus, architecte antique (Archeotec Lausanne), Stéphane Izri (étude des monnaies) ; Matthieu Thivet (UMR 6249 Chrono-environnement, Besançon), prospection radar ; Christelle Sanchez (UMR 6249 Chrono-environnement, Besançon), prospection radar ; Quentin Verriez (EPCC Bibracte, MSHE Ledoux Besançon), couverture photogrammétrique drone.
Dates du chantier : 23 juillet au 17 août 2018
Financements : DRAC, avec le soutien de Bibracte EPCC, de l’Inrap et de la ville d’Autun.
Autun (Saône-et-Loire) : quartier artisanal – campagne 2018

Coordination du PCR : Yannick Labaune (service archéologique de la ville d’Autun, UMR 6298 artehis) L’intervention proposée en 2018 a permis de poursuivre l’analyse du secteur engagée en 2017 en périphérie occidentale du complexe artisanal. Il a été question dans un premier temps d’achever l’étude de la production céramique issue de l’atelier fouillé lors de la campagne précédente. Sur le terrain, l’équipe s’est attelée à fouiller finement la zone stratifiée dans la partie méridionale de la fenêtre de fouille de 2017 afin de dégager les occupations et vestiges artisanaux les plus précoces qui précédent l’atelier de potier du Ier s. apr. J.-C. L’un des puits découverts dans la cour de cet atelier de potier a pu être fouillé mécaniquement et des échantillons sédimentaires ont pu être prélevé à la base du comblement en vue d’analyses paléo environnementales. La fenêtre de fouille a été élargie vers l’ouest afin de dégager les vestiges de la voie menant d’Autun à Bourges, traversant le complexe d’est en ouest. L’état augustéen de la voirie a pu être bien caractérisé. Il est précédé par des éléments de structuration fossoyés de même orientation que l’axe viaire dont la datation est située dans une fourchette large comprise entre la fin de l’époque tardo-laténienne et l’époque augustéenne. L’attestation d’une voie précoce fait écho aux découvertes d’aménagements cultuels tardo-laténiens –antérieurs à la création de la ville – sous le temple dit de Janus. La jonction entre la structure hydraulique ceinturant le complexe d’époque romaine et l’axe viaire a pu être dégagé et la présence d’un système de franchissement en bois a pu être mise en évidence. Un ensemble de bois d’œuvre, conservé dans le comblement inférieur du canal, hydromorphe, a pu être prélevé à des fins d’analyse (technologie de mise en œuvre, dendrochronologie). Une série de prélèvements sédimentaires a pu également être réalisé dans cette couche hydromorphe afin d’être versé au dossier paléo-environnemental (colonne pollinique, macro-restes). Ce canal pourrait être assez précocement installé (début du Ier s. apr. J.-C.). Sa principale fonction semble être de canalisé les eaux du bassin du Ternin, au nord, vers l’Arroux, afin de protéger la zone du sanctuaire. Il est remanié au à la fin du IIe s. apr. J.-C. ou au début du IIIe s. apr. J.-C. par un remblaiement partiel du fond. Un fossé latéral aménagé dans ce remblai permet un écoulement constant sur une largeur réduite. Sur le reste de la largeur du canal, les remblais dont la surface est empierrée permettent un écoulement large en cas de crue, le canal restant suffisamment profond. Le franchissement se fait sans doute par un nouveau système : un pont assis sur des piles installées dans les berges. A la fin du IIIe s. apr. J.-C. ce système, qui s’est ensablé, n’est plus entretenu (présence de grandes fosses dépotoirs). Le passage de la voie vers Bourges se fait par un gué bien empierré, qui descend dans le lit du canal. Ce dernier finit par s’ensabler complètement, de façon plutôt lente, entre la fin de l’Antiquité et l’époque moderne ou une voie passe par-dessus son comblement. Entre les deux, un appui en pierres sèches pour un pont est installé au milieu du chenal à une époque indéterminée (début du Moyen Âge ?).Le complexe monumental de la Genetoye (Autun, Saône-et-Loire) dans son environnement. Approches diachroniques et pluridisciplinaires de la confluence Arroux / Ternin de la préhistoire au Moyen-Age / Campagne de fouille 2018 du quartier artisanal
Responsable scientifique de la fouille : Stéphane Alix (Inrap, UMR 6249 Chrono-environnement)
Principaux participants : Marie-Noëlle Pascal (Inrap), Co-directionLoïc Androuin (Université de Bourgogne) / coroplastieFrançois, Blondel (docteur, UMR 6298 artehis), dendrochronologie / xylologie, Laure Cassagnes (Université Panthéon-Sorbonne)/ instrumentum, Yannick Labaune (service archéologique de la ville d’Autun, UMR 6298 artehis)/ encadrement, Claude Malagoli (docteur, UMR 5138 ArAr : Archéologie et Archéométrie, Maison de l’Orient et de la Méditerranée) / lampes à huiles, Sylvie Mouton-Venault (Inrap, UMR 7041 Arscan) / céramologie
Dates du chantier : 25 juin-13 juillet 2018
Financements : DRAC, avec le soutien de Bibracte EPCC, de l’Inrap et de la ville d’Autun.
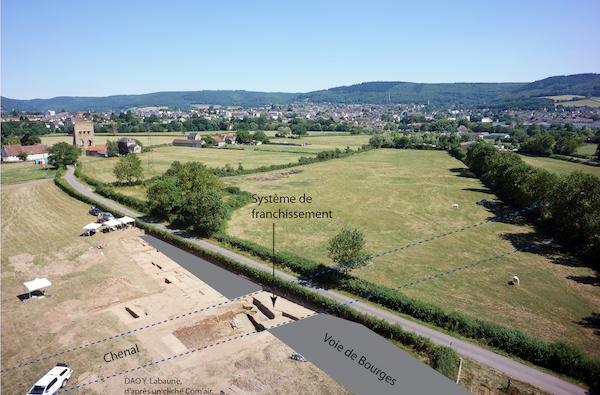


Seveux (Haute-Saône) : le bourg castral du « Pré Bouché » – campagne 2018

Responsables : Adrien Saggese (Chercheur associé, UMR 6298 ArTeHis), Valentin Chevassu (Doctorant, UMR 6249 Chrono-environnement) Cette agglomération antique mentionnée dans l’Itinéraire d’Antonin se développe en bordure de la grande voie Besançon-Langres, au carrefour avec la Saône. Le site est connu depuis le XIXe siècle et semble fonctionner de pair avec la grande villa de Membrey située à environ 600 mètres au nord-ouest. Si la villa a été appréhendée au milieu du XIXe siècle (Matty de Latour 1847), l’agglomération a fait l’objet de nombreuses fouilles de sauvetages entre les années 1970 et 1990 (Faure-Brac 2002) accompagnées d’une reconnaissance de son environnement par une série d’opérations de prospections pédestres (Faure-Brac 2002). Ces dernières auront permis d’identifier un nombre conséquent de sites dans la périphérie de l’agglomération. Ces découvertes font l’objet d’une notice de synthèse dans le cadre du PAS Agglo CENE (Venault et al. à paraître). Le secteur est toujours occupé à l’Antiquité tardive comme le laisse envisager des réaménagements domestiques au sein de l’agglomération et la découverte d’un trésor monétaire du IVe siècle dans la villa. Une inhumation en coffrage de tuile à l’extrémité est de l’agglomération vient conforter l’hypothèse d’une continuité de l’occupation. Le haut Moyen Âge est quand à lui représenté par un espaces funéraire au lieu-dit « Au Village » (Bonvalot 1993). A cela s’ajoute une structure en creux découverte en 2007 à une centaine de mètres et interprétée comme un « fond de cabane » (Gaston 2007). Un large fossé entourant l’actuel château en rive gauche de la Saône a été relevé anciennement en photo aérienne, laissant entrevoir une possible occupation castrale ancienne. Seveux (70), « Pré Bouché », cliché aérien du secteur du château et des différentes anomalies de croissances liées à la basse-cour. Une acquisition photogramétrique large a été effectuée afin de préparer un MNT du secteur à même de servir de support aux projections des différentes acquisitions. Ce MNT vise également à préciser si des anomalies micro-topographiques auraient pu correspondre à celles mises en évidences par la reconnaissance aérienne. Une prospection magnétométrique de plus d’1,9 hectare a ciblé l’espace interprété comme la basse-cour du château médiéval au lieu-dit « Pré Bouché ». De nombreuses anomalies anthropiques ont ainsi été repérées, notamment un carroyage interprété comme un espace de jardin ou de verger, peut-être de la période Moderne. L’enceinte apparaissant en photographie aérienne a pu être délimitée et pourrait être constitué de deux importants massifs maçonnés séparées par un fossé. Une prospection électromagnétique extensive a mis en évidence la présence d’un bras mort de la Saône aux abords ouest de l’enceinte castral. Une anomalie dans la continuité de cette enceinte pourrait indiquer une adaptation de cette dernière pour passer au-dessus de ce bras mort. Des sondages de vérifications sont envisagés en 2010 pour vérifier les anomalies repérées en géophysique. La priorité à l’heure actuelle est une étude de bâti de la tour médiévale toujours en élévation qui pourrait présenter des éléments relatifs XIIe siècle. anomalies magnétiques relevées sur le secteur de la basse-cour du château.Seveux (70), le bourg castral du « Pré Bouché »
Participation de : Matthieu Thivet (UMR 6249 Chrono-environnement), Christelle Sanchez (chercheuse associée, UMR 6249 Chrono-environnement), Thomas Chenal (DPH ville de Besançon, chercheur associé, UMR 6298 ArTeHis), Amélie Berger (Doctorante, EA 2273 laboratoire des Sciences Historiques)
Dates de chantier : Juin 2018
Financement : DRAC
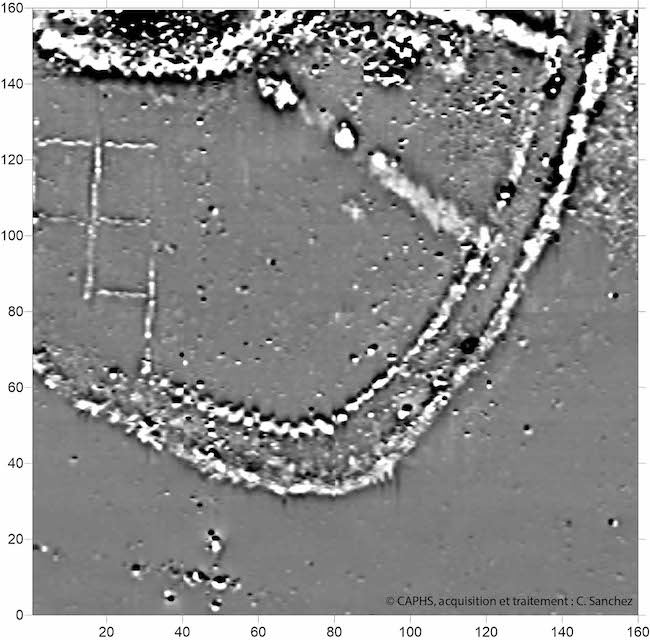
Gigny et Baume-les-Messieurs (Jura) : monastères – campagne 2018
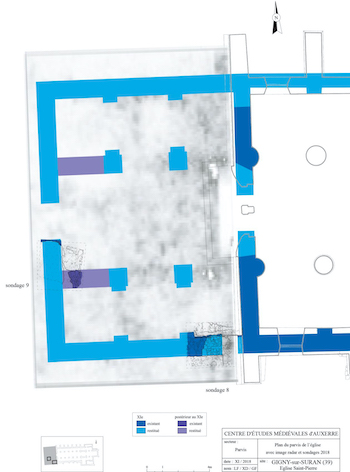
Coordination : Christian Sapin et Sébastien Bully (UMR ARTEHIS) En comparaison avec l’avant-nef de Cluny II, Christian Sapin a depuis longtemps attiré l’attention des chercheurs sur celle disparue de Gigny, localisée par des prospections géophysiques au début des années 2000. Et plus récemment, c’est à Baume-les-Messieurs qu’un massif occidental a également été révélé par la géophysique et confirmé par un premier sondage réalisé en 2011 dans le cadre du PCR « Monastères en Europe occidentale ». Mais dans un cas comme dans l’autre, la datation des deux dispositifs occidentaux, leur état de conservation, leur plan et leur parti architectural nous échappaient encore. À l’image des sondages que nous avions ouverts dans les chœurs de ces deux édifices en 2009, il s’agissait de reproduire des interventions limitées dans l’espace et le temps (deux semaines), mais qui devaient contribuer à la connaissance de ces deux sites importants du monachisme bénédictin et clunisien. Les sondages de Gigny et de Baume devaient permettre d’apprécier la présence de dispositifs occidentaux disparus depuis la fin du Moyen Âge, mais surtout, ils devaient permettre d’en suggérer les partis architecturaux, avec leurs corollaires de questionnements sur leurs origines et leurs fonctions liturgiques constitutives de l’architecture clunisienne ou redevables à d’autres « traditions ». Le choix d’un large sondage (6 x2 m) au-devant du portail de la nef était motivé par les cartes géophysiques qui pouvaient laisser supposer la présence d’une abside occidentée, à l’imitation des westwerks carolingiens ou ottoniens. La fouille a infirmé cette hypothèse, tout en révélant d’autres structures susceptibles d’appartenir à une avant-nef. En premier lieu, le portail gothique succède à un portail antérieur, reconnu à travers un emmarchement et l’amorce des piédroits. Ce dernier, de par sa situation et ses dimensions, appartenait vraisemblablement à une façade interne – transformée en façade externe depuis le XVe s. – entre la nef romane actuelle et l’avant-nef disparue. En outre, l’emmarchement recouvre toute une séquence stratigraphique de niveau de sol de mortier et en terre battue à mettre en relation avec un dispositif occidental antérieur ou appartenant à un premier état de l’avant-nef. Ces sols recouvrent une sépulture en coffre maçonnée datée par C14 entre 900 et 1030 dont on ne sait si elle prend déjà place dans un édifice ou si elle en occupe le parvis extérieur. Au total, ce sont onze sépultures, pour l’essentiel en coffres de pierre, qui ont été fouillées sur la surface du sondage. La plus récente, en pleine terre, est datée par C14 entre 1320 et 1440 ; cette datation conforte l’hypothèse, suggérée par des sources d’archives, d’une démolition de l’avant-nef sous l’abbatiat d’Henri de Salins entre 1431 et 1450. Tout en écartant certaines hypothèses, les résultats du sondage plaident fortement en faveur de la présence d’une avant-nef contemporaine du dernier état de la nef romane (du XIIe s.) ; son plan comme son parti architectural nous échappe, mais il est en revanche assurée que la façade occidentale – jusqu’alors localisée par la géophysique à l’emplacement de ce qui s’est révélé être une ancienne canalisation – doit être repoussée vers l’ouest, formant ainsi une vaste avant-nef à l’image des galilées clunisiennes. Enfin, on retiendra que la stratigraphie et un plan d’inhumation précoce suggèrent l’hypothèse d’un dispositif antérieur, datable des Xe-XIe s. Baume-les-Messieurs, vue générale du sondage au pied de la façade de l’abbatiale (cl. S. Bully) Baume-les-Messieurs, relevés des sondages et proposition de restitution de l’emprise de l’avant-nef (dessin M. Le Brech) En se fondant sur les résultats des deux petits sondages ouverts sur le parvis – dans le prolongement du mur gouttereau sud de la nef et à l’emplacement supposé de la façade de l’avant-nef – croisés avec les cartes géo-radar, il est possible de proposer le plan d’une avant-nef de trois travées de 11,30 m de longueur par 16,50 m de largeur. L’avant-nef serait subdivisée par quatre piliers au centre avec ressaut, et pilastres dans les murs gouttereaux des bas-côtés. Cette structure, et sa maçonnerie proche de la mise en œuvre de l’église elle-même, autour de Mil (sur la base de datations C14), attestent des liens maintenus avec l’abbaye de Cluny, et permettent de compléter la réflexion sur la construction et l’usage du modèle d’avant-nef à usage liturgique initié par Cluny. Gigny, sondage 8, vue générale du sondage et de l’élévation de la façade de la nef (cl. F. Henrion, CEM 2018)
Les avant-nefs clunisiennes du Jura : monastères de Gigny et de Baume-les-Messieurs / campagne 2018
Titulaire de l’autorisation de sondage : Matthieu Le Brech (Baume-les-Messieurs) et Christian Sapin (Gigny)
En partenariat avec : l’APAHJ (Saint-Claude) et le CEM (Auxerre)
Participation de : Georgie Baudry, Mélinda Bizri (UMR ARTEHIS), Sébastien Bully (UMR ARTEHIS), Morana Čaušević-Bully (université de Franche-Comté-UMR Chrono-environnement), Thomas Chenal (UMR ARTEHIS), Anaïs Deliste, Gilles Fevre (CEM), Fabrice Henrion (CEM-UMR ARTEHIS), Adrien Sagesse (UMR ARTEHIS), Christian Sapin (CEM-UMR ARTEHIS)
Dates des opérations : Baume-les-Messieurs, du 29 juin au 6 juillet 2018 ; Gigny, du 13 au 20 septembre 2018
Financements : Ministère de la Culture-DRAC Franche-Comté, Conseil départemental du Jura, Communes de Gigny et de Baume-les-MessieursObjectifs et résultats :
Baume-les-Messieurs

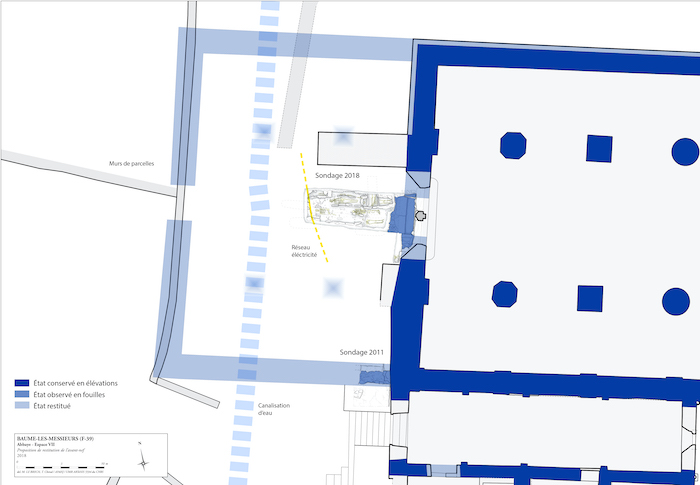
Gigny

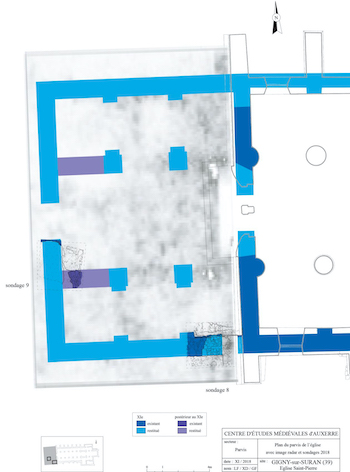
Port-sur-Saône (Haute-Saône): le castrum de l’Antiquité tardive – campagne 2018

Responsable : Adrien Saggese (Chercheur associé, UMR 6298 ArTeHis), Valentin Chevassu (Doctorant, UMR 6249 Chrono-environnement) Identifié par la Noticia Galliarum comme le chef-lieu du Pagus Portuensis, Port-sur-Saône est principalement reconnue pour la grande villa du Magny implantée sur la rive droite de la Saône et fouillée au XIXe siècle par Auguste Galaire. Ce site colossal de 15,4 ha (Ferdière et al. 2010) entouré de nombreux établissements ruraux antiques semble à lui seul générer l’activité du secteur (Faure-Brac 2002). La nomination du site comme chef-lieu de Pagus apparaît vraisemblablement durant l’Antiquité tardive, au moment où semble péricliter l’occupation de la grande villa (Gaston 2006). La présence d’une fortification maçonnée attribuable à l’Antiquité tardive sur la rive gauche de la Saône et la mention d’un ancien castrum à Port-sur-Saône en 1050 (Faure-Brac 2002) semble indiquer un transfert du pôle aristocratique à cette période. Cette création pourrait justifier la nomination du Portus Abuccinus à la tête du Pagus. L’occupation médiévale est quant à elle marquée par deux espaces funéraires à sarcophage, un premier situé à environ 150 m au nord du castrum, et le second sous la chapelle Saint-Valère sur la rive droite. Il semble donc particulièrement important de comprendre les modalités d’évolutions de la grande villa du Magny et du castrum et de comparer la chronologie de ces deux sites afin de préciser, ou pas, une articulation entre les deux. La bipartition du site entre la partie haute du castrum et la partie basse de Saint-Valère présente un schéma d’occupation original qui mériterait d’être précisé. Résultats : Pour se faire, nous avons dans un premier temps dépouillé la documentation ancienne, notamment les plans, relevés et illustrations des travaux des érudits du XIXe siècle et en particulier l’exceptionnel album Galaire Ce dernier a effectué de nombreuses fouilles sur le territoire de la commune dans le courant du XIXe siècle et à consigné ces recherches dans un magnifique album aquarellé. La partie texte a disparu dans un incendie, il n’en reste aujourd’hui que les plans et illustrations du mobilier. La qualité de ces relevés et de ces peintures en fait un document de choix, c’est pourquoi une identification systématique du mobilier représenté sur ces planches a été entreprise. Elle a permis d’apporter des arguments important quand à une occupation tardive de la partie résidentielle de la grande villa « du Magny ». Extrait d’une planche de mobilier de l’album Galaire La totalité des opérations de terrain 2018 ont ciblé le supposé castrum de l’Antiquité tardive. Une reconnaissance large du secteur par un drone équipé d’un capteur LiDAR a permis la création d’un Modèle Numérique de Terrain (MNT) et la délimitation du rempart. Une prospection géophysique magnétométrique a été effectuée sur une surface de plus de 2500 m² au sein de l’espace enceint. synthèse des opérations effectuées en 2018 sur le secteur du castrum de Port-sur-Saône (70). De nombreuses anomalies d’origine vraisemblablement anthropique ont été repérées mais présentant une orientation divergente de celle de la fortification. Des sondages devraient être effectués au cours des missions suivantes afin de préciser la nature de ces anomalies. Pour conclure cette campagne, un nettoyage d’une section de rempart percée par un chemin communal a permis de mettre au jour une section de 6,50 m de large pour une hauteur maximum conservée de 10 assises, le tout intégralement maçonné. Le massif de fondation à livré les négatifs d’une ossature interne formée de poutres entrecoisées. La largeur exceptionnelle de cette section invite à l’interpréter comme la coupe d’une tour en saillie ou d’un système de porterie. Le mobilier collecté va dans le sens d’une construction du IVe siècle de notre ère. Section de rempart dégagée en juillet 2018 Les investigations devraient se poursuivre de 2019 à 2021 à travers le dépôt d’un projet de PCR. Elles débuteront en 2019 par un sondage de vérification à 300 m au nord du site, afin de localiser les fouilles effectuées par Galaire au XIXe siècle. Ce dernier avait alors dégagé un bâtiment quadrangulaire d’une vingtaine de mètres de côté et au moins 4 sarcophages du haut Moyen Âge. Il sera alors également possible de tenter de restituer la stratigraphie de ce secteur.
Port-sur-Saône (70), le castrum de l’Antiquité tardive
Participation de : Matthieu Thivet (UMR 6249 Chrono-environnement), Christelle Sanchez (chercheuse associée, UMR 6249 Chrono-environnement), Axelle Grzesznik (Master, UFC), Amélie Berger (Doctorante, EA 2273 laboratoire des Sciences Historiques)
Dates de chantier : février, 2-13 juillet 2018
Financement : DRAC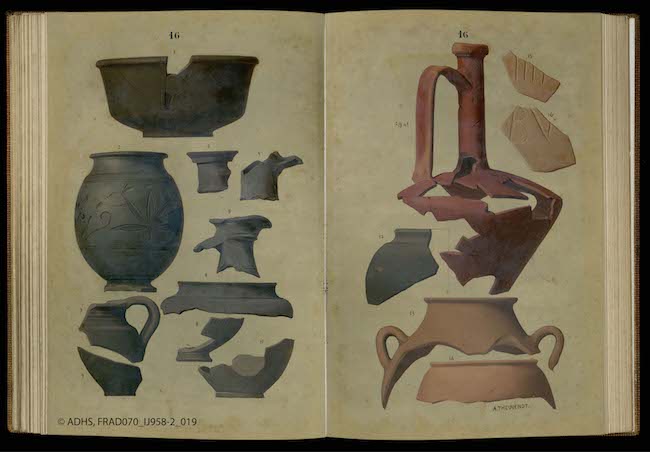
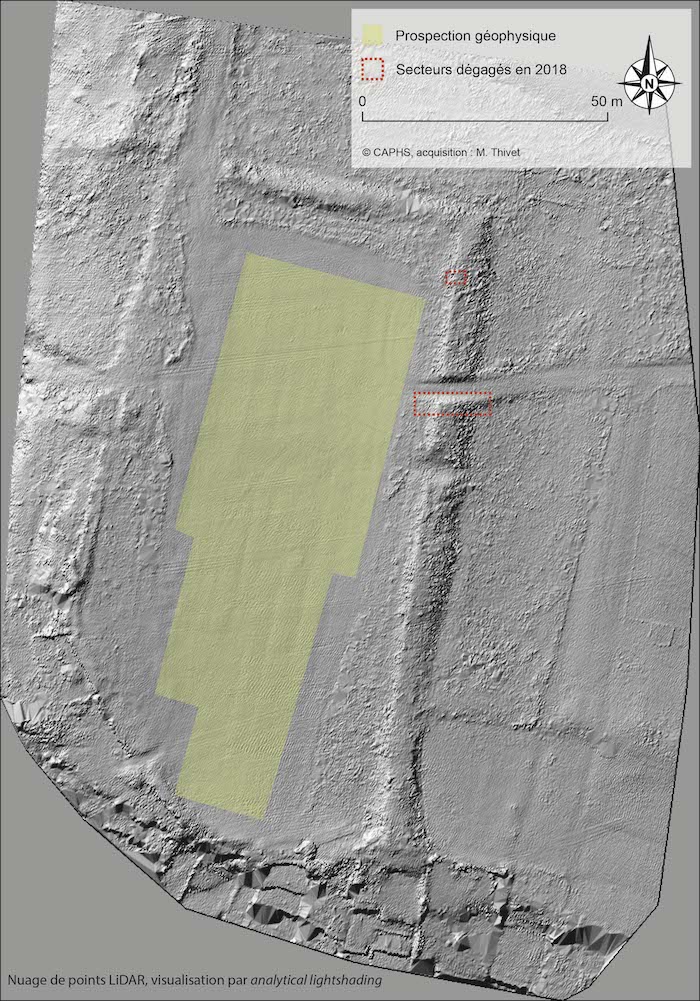

Autun (Saône-et-Loire) : enceinte néolithique des Grands champs – campagne 2018

Coordination du PCR : Yannick Labaune (service archéologique de la ville d’Autun, UMR 6298 artehis) Le premier d’entre eux s’est intéressé à étendre la fenêtre de fouille ouverte en 2017 en périphérie orientale de l’enceinte, en direction du nord-ouest, et ce sur une superficie sensiblement équivalente à l’ouverture de l’année précédente (environ 750 m²). La poursuite des dispositifs de fossés et palissades périphériques a été reconnue. A l’instar de la campagne précédente, les vestiges d’un bâti sur poteaux plantés à l’intérieur de l’enceinte ont pu être observé à proximité de la palissade. On notera que les constructions dégagées à l’intérieur de l’enceinte lors des deux campagnes de fouilles respectent l’orientation du tronçon de palissade contre lequel ils sont implantés, suggérant ainsi leur contemporanéité. Cela permet de palier à l’absence de mobilier à l’intérieur du comblement des trous de poteaux. Le mobilier piégé dans les structures fossoyées périphériques est similaire à celui récolté l’année précédente. Dans l’état actuel du dossier documentaire les structures, notamment la palissade et les différents fossés, mais aussi les aménagements intérieurs de l’enceinte, paraissent contemporaines et renvoient toujours à la culture chasséenne. Le second volet a permis l’ouverture d’un sondage limité à une centaine de mètres carrés sur le tracé d’une des grandes structures longilignes et renflées à l’une de leurs extrémités, reconnues dans le périmètre de l’enceinte par les clichés aériens et la prospection géophysique. L’objectif de l’intervention était d’en préciser la nature, la chronologie et l’état de conservation de ces vestiges parfois assimilées à des structures funéraires de type « Passy ». La fouille a permis d’écarter de manière définitive cette hypothèse et montrer qu’il s’agissait plutôt de gravières, peut-être tardo-laténiennes ou antiques (augustéennes ?). Vue aérienne localisant les différentes fenêtres de fouille ouvertes dans le cadre du programme de recherches en 2018. DAO Y. Labaune, d’après cliché aérien de Q. Verriez, Université de Franche-Comté Campagne de fouille menée en 2018 sur l’enceinte des Grands Champs, au premier plan les trous d’installation des poteaux de la palissade. Cliché A. Maillier, Bibracte EPCC Vue arienne de la fenêtre de fouille ouverte en 2018 sur l’enceinte des Grands Champs en fin d’opération. Cliché aérien de Q. Verriez, Université de Franche-Comté
Le complexe monumental de la Genetoye (Autun, S&L) dans son environnement. Approches diachroniques et pluridisciplinaires de la confluence Arroux-Ternin de la préhistoire au Moyen-Age / Campagne de fouille 2018 de l’enceinte néolithique des Grands champs
Responsable scientifique de la fouille : Franck Ducreux (Inrap, UMR 6298 artehis)
Principaux participants : A. Girot (Université de Bourgogne) ; A. Goutelard (Inrap) A.Tisserand (Service archéologique de la ville d’Autun).
Dates du chantier : 09-27 juillet 2018
Financements : DRAC, avec le soutien de Bibracte EPCC, de l’Inrap et de la ville d’AutunLa campagne de 2018 comporte deux volets.



Jonvelle (Haute-Saône) : réévaluation du potentiel archéologique de la commune – campagne 2018

Responsable : Adrien Saggese (Chercheur associé, UMR 6298 ArTeHis), Valentin Chevassu (Doctorant, UMR 6249 Chrono-environnement), Thomas Chenal (DPH ville de Besançon, chercheur associé, UMR 6298 ArTeHis) Le site de Jonvelle est principalement connu pour son complexe thermal antique lié à un établissement rural de type « villa ». Elle fut fouillée à partir de la fin des années 1960 par l’abbé Descouvrières puis à partir de 1986 avec la collaboration de Nathalie Bonvalot et est aujourd’hui classée au titre des Monuments Historiques. Ces fouilles auront permis de mettre en évidence deux voies autour de la pars urbana de la villa ainsi qu’une petite occupation sur poteau datée de l’Antiquité tardive au nord-est de la zone de fouille. L’occupation du site est suggérée jusqu’au VIIIe siècle de par la découverte d’une canalisation réemployant des fragments de sarcophages mais l’espace thermal est réaménagé dès l’Antiquité tardive, vraisemblablement pour une fonction domestique. À environ 600 mètres en contrebas de la villa, un atelier de tuiliers/potiers a été fouillé par Fabrice Charlier et Nathalie Bonvalot. La dernière fournée de tuile a été datée par archéomagnétisme des années 190. La production potière quant à elle pourrait perdurer plus longtemps, peut-être jusqu’au début du IVe siècle d’après la description des cruches qui y sont produites. Une motte castrale domine le village actuel et est coiffée des ruines de la seigneurie de Jonvelle. Finalement, le village actuel est doté d’une église prieurale et paroissiale dépendant de l’abbaye de Luxeuil-lès-Bains au moins au XIIe siècle. La découverte d’un sarcophage en plâtre au niveau du bas-côté nord laisserait supposer une construction plus précoce et le développement d’un bourg en parallèle de celui d’un bourg castral dans un méandre de la Saône barré par la motte au nord-est du village actuel. Cette configuration originale amène à plusieurs interrogations. A t’on un déplacement de l’occupation de la villa antique jusqu’au site castral et au village actuel ? Quels sont les modalités et la chronologie d’apparition de ces occupations sur les différents secteurs de la commune ? Pour y répondre, plusieurs opérations de différentes natures ont été menées. Afin de topographier au mieux les vestiges conservés de la villa des « Jourdaines », une acquisition photogramétrique des vestiges conservés a été effectuée. Au-delà de l’intérêt topographique de cette acquisition, cette dernière a été offerte à l’association « Le Foyer » (https://sites.google.com/site/museejonvelle/home), propriétaire du site, afin de servir de support de médiation. Avec l’aval de ces derniers, un inventaire synthétique du mobilier céramique issu des fouilles anciennes de la villa a été effectué et a abouti à des résultats de premier ordre ; une remarquable diversité d’importations céramiques de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge a ainsi pu être mise en évidence, témoignant d’une occupation en continu du site entre le Ier siècle avant J.-C. et les IXe-Xe siècle. À 600 m à l’ouest de la villa, une parcelle dont le toponyme « Les Cuves », aurait pu correspondre à un espace funéraire mérovingien a été prospectée systématiquement. Les murgers environnants ont également été inspectés mais n’ont livré aucune trace d’une occupation ancienne. Une dernière opération de prospection urbaine a été menée afin de référencer tous les bâtiments du bourg ancien réemployant des éléments architecturaux médiévaux et modernes, permettant de localiser l’emprise du bourg médiéval et les remplois issus du démantèlement du château. acquisition photogramétrique du secteur des thermes de la villa « des Jourdaines » Dans le cadre du PCR débutant en 2019, les investigations vont se poursuivre. L’étude du mobilier métallique et numismatique conservé au musée de site de la villa sera effectuée afin de compléter l’étude céramologique. Un relevé topographique des vestiges de la forteresse médiévale sera entreprise afin de permettre l’étude de son organisation. En parallèle, des prospections subaquatiques vont être effectuées dans le méandre de la petite Saône délimitant le bourg médiéval, par l’équipe d’Annie Dumont (UMR 6298 ARTEHiIS) dans le cadre de son PCR « Les cours d’eau en Bourgogne-Franche-Comté, patrimoine immergé et évolution des hydrosystèmes sur la longue durée ».
Jonvelle (70), réévaluation du potentiel archéologique de la commune
Participation de : Axelle Grzesznik (Master, UFC), Amélie Berger (Doctorante, EA 2273 laboratoire des Sciences Historiques)
Dates de chantier : 16-20 juillet 2018
Financement : DRAC
Saint-Pierre d’Osor (Croatie) : sites ecclésiaux insulaires – campagne 2018
Mission archéologique franco-croate du ministère des Affaires étrangères La campagne 2018 a marqué une étape importante dans la progression des recherches menées sur le monastère Saint-Pierre d’Osor (depuis 2006). En effet, au terme des 12 campagnes qui ont permis de fouiller la totalité de l’église Saint-Pierre, son environnement immédiat et près de 550 sépultures, nous avons fait le choix de suspendre les recherches sur le terrain afin de nous consacrer au traitement d’une importante documentation, en prévision de la publication monographique des riches résultats. L’organisation d’un colloque à Osor au début du mois de juin – placé sous l’égide des Journées internationales d’études monastiques –, a permis d’aborder un grand nombre de points intéressant directement la préparation de la publication monographique. À ce stade de l’avancée de nos recherches sur Saint-Pierre d’Osor, il nous avait semblé opportun et nécessaire de contextualiser le site par une approche élargie du monachisme bénédictin dans l’Adriatique, tout en soumettant nos réflexions à un aréopage de spécialistes de la question, archéologues, mais également historiens. En effet, le constat énoncé depuis plusieurs années de l’indigence des sources historiques – sinon de leur crédibilité – concernant les origines de la fondation, nécessitait de solliciter des historiens des sources écrites afin d’engager une véritable révision historiographique. Le second volet de la mission sur les complexes monastiques et ecclésiaux de l’archipel (depuis 2010) a principalement porté sur la poursuite de la fouille du secteur dit de « l’église à trois absides » de Mirine-Fulfinum, sur l’île de Krk. Engagé en 2016, le chantier-école 2018 du petit complexe suburbain – « villa antique» remplacée par une église des IXe-XIe s. (fouillée dans les années 2000) – a permis l’achèvement de la fouille de l’Espace 4.1d et la poursuite de la fouille de la cour sud (esp. 4.1h). Cette dernière a révélé un aménagement de pressoir à huile et de cuves. L’étude en cours d’un abondant mobilier céramique, appartenant à des ensembles clos formant une remarquable stratigraphie pour la région, plaide fortement en faveur d’une construction ex-nihilo et d’une occupation que l’en situe désormais entre la fin IVe-début Ve s. et le milieu du VIe s. Ces datations sont largement confirmées par le monnayage. La prise en compte de l’instrumentum, dont le peigne liturgique paléochrétien – découvert en 2017 et désormais restauré – ainsi que des fibules cruciformes, témoigne assurément d’une occupation élitaire. Aussi, et contrairement à nos toutes premières hypothèses de travail, nous pourrions être en présence d’une « résidence ecclésiale » – faute de ne pouvoir parler, à ce stade des recherches, de domus ecclesia – en lien avec la proche basilique paléochrétienne de Mirine. L’étude du mobilier céramique a été complétée par celle des amphores provenant de la fouille des mausolées de l’Antiquité tardive (fouilles 2012 à 2014) découverts au chevet de la basilique paléochrétienne. La sculpture provenant du site (tous secteurs confondus) a été cataloguée avant d’être étudiée. Après les trois campagnes de fouilles sur l’église de Martinšćica menées entre 2015 et 2017, nous avons convenu de consacrer l’année 2018, d’une part, à la mise à jour de la documentation (infographie du plan pierre à pierre, catalogue de la sculpture, étude de faune, datation archéométrique etc.) et d’autre part, à la poursuite des travaux de conservation des maçonneries encore en élévation. Ces travaux, résultant d’une obligation légale demandée par le ministère de la Culture croate, étaient en outre nécessaires pour la poursuite des fouilles dans la nef de bonnes conditions de sécurité (murs en élévations ruinés). Lien ČAUŠEVIĆ-BULLY (M.), BULLY (S.), SAGGESE (A.) et CROCHAT (J.), Les sites ecclésiaux et monastiques de l’archipel du Kvarner (Croatie), campagne 2018 : Mirine-Fulfinum (Omišalj, île de Krk), Chronique des activités archéologiques de l’École française de Rome, 2018 http://journals.openedition.org/cefr/3654
Saint-Pierre d’Osor et les monastères et sites ecclésiaux insulaires dans l’archipel du Kvarner (Croatie) / Campagne 2018
Responsables : Sébastien Bully (UMR ARTEHIS), Morana Čaušević-Bully (université de Bourgogne Franche-Comté-UMR Chrono-environnement)
Participation de : Thomas Chenal (UMR ARTEHIS), Adrien Saggese (UMR ARTEHIS, étude du mobilier amphorique), Mélinda Bizri (UMR ARTEHIS), Jessy Crochat, Lucija Dugorepec, Valentin Chevassu (UBFC-UMR Chrono-environnement), Matthieu Le Brech (UBFC), Agnès Stock (UMR Chrono-environnement), Georgie Baudry (UBFC), Maxime Bolard (UBFC) et les contributions de Pascale Chevalier (UMR ARTEHIS), Mia Rizner, Miroslav Vuković, Stéphane Gioanni (professeur, Université Lyon 2-UMR HISOMA), Konestra Ana (Institut za arheologiju iz Zagreba), Laurent Popovitch (Mdc, UBFC-UMR ARTEHIS, numismatique antique), Anthony Dumontet (UMR ARTEHIS, compléments infographiques du plan de Martinšćica), Cyprien Mureau (doctorant-allocataire, UMR ARTEHIS, étude préliminaire des restes de faune de Martinšćica)
En partenariat avec : aIPAK/APAHJ
Dates de chantiers :
– du 9 au 20 avril : fouilles programmées-chantier-école de Mirine-Fulfinum dans le cadre du volet « Monachisme insulaire » et du projet de parc archéologique de la commune d’Omišalj ;
– du 1er au 3 juin : organisation à Osor des 7ème journées internationales d’étude monastiques « Saint-Pierre d’Osor (île de Cres) et le monachisme bénédictin dans l’espace Adriatique » ;
– du 16 au 20 juillet : accompagnement archéologique et contrôle des travaux de conservation des vestiges de l’église de Martinšćica
Financements : ministère des Affaires étrangères français, ministère de la Culture croate, École française de Rome, Commune d’Omišalj, Région de Primosko-Goranska, Caritas veritatis foundationRésultats

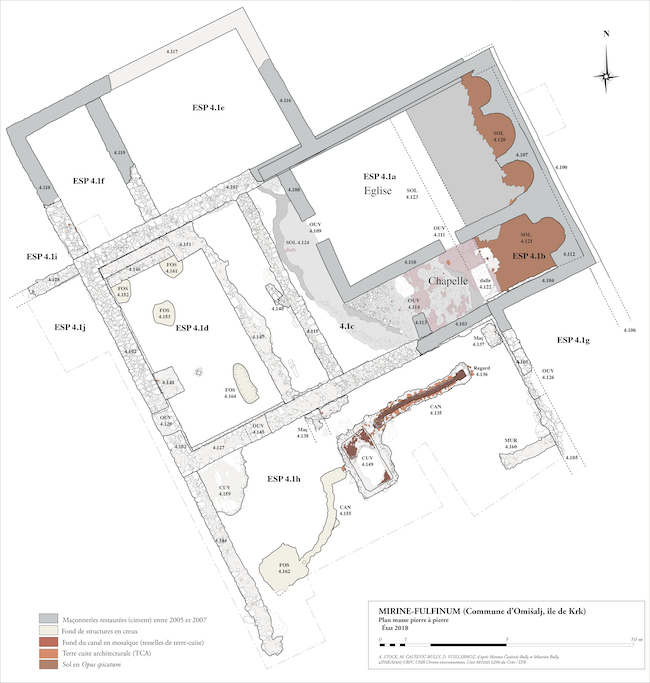

Saint-Pierre d’Osor (Croatie) : monastères et sites ecclésiaux / campagne 2017

Mission archéologique franco-croate du ministère des Affaires étrangères Martinšćica, vue générale de l’église à l’achèvement de la campagne 2017 (cl. M. Vuković) Osor, flanc nord-ouest de l’église romane, fouille en cours de structures artisanales de l’Antiquité tardive/haut Moyen Âge (cl. S. Bully) Osor, achèvement de la fouille du vestibule de l’église romane (cl. S. Bully) La campagne 2017 sur Saint-Pierre d’Osor a permis l’achèvement de la fouille du vestibule de l’église du XIe s. (Esp. V) et de son flanc nord-ouest (Esp VI). Antérieurement à un espace funéraire médiéval, le secteur VI était occupé par une construction de l’Antiquité tardive ou du haut Moyen Âge, à fonction artisanale, partiellement conservée dans le monastère roman. Martinšćica, chapelle sud en cours de fouille (cl. S. Bully) Martinšćica, automne 2017, engagement des travaux de conservation de l’église (cl. S. Bully) À Martinšćica (île de Cres), la troisième campagne de fouille sur la grande église paléochrétienne a porté plus particulièrement sur sa chapelle postérieure sud – à abside outrepassée –, révélant un état antérieur au VIe s., et sur le bras sud du transept qui a livré un ensemble inattendu de tombes privilégiées en formae. Le flanc sud de l’église a révélé une nouvelle annexe du type « cellule ». Le chantier-école à Mirine-Fulfinum (île de Krk) a poursuivi la fouille des secteurs IV.1d et IV.1.h, confirmant une occupation de l’Antiquité tardive pour une petite « résidence », antérieure à l’église des IXe-XIe s., à mettre en lien, désormais, avec le complexe paléochrétien de Mirine. Mirine-Fulfinum, secteur de « l’église à trois absides » et de la résidence ecclésiastique présumée au premier-plan ; complexe de la basilique paléochrétienne en arrière-plan (cl. M. Vuković) Mirine-Fulfinum, secteur de la villa-résidence ecclésiastique en cours de fouille (cl. S. Bully) Cette année, nous avons testé pour la première fois la méthode de datation des mortiers par luminescence optiquement stimulée (OSL) sur Saint-Pierre d’Osor (première phase de l’église) et Martinšćica (dernière phase de construction : « cellule » orientale VIIIa). Les manipulations (prélèvements et installations de dosimètres) ont été réalisées par Petra Urbanova, archéomètre en post-doctorat à l’UMR IRAMAT de Bordeaux. Outre l’avancée de la connaissance des sites par la mise au jour de structures, la campagne 2017 a été marquée par la découverte de petits mobiliers remarquables. Ainsi, à Osor ont été mises au jour dans une même tombe romane deux nouvelles monnaies en or byzantines du XIIe s., ainsi qu’une plaque de pierre gravée de graffitis représentant des scènes possiblement bibliques. À Martinšćica, c’est un sceau notarial byzantin du début du VIIIe s. qui a été découvert sur la grève à proximité de la grande église. Mais surtout, la fouille de la présumée résidence ecclésiastique antique tardive de Mirine a livré un exceptionnel peigne liturgique en ivoire paléochrétien décoré de scènes néo-testamentaires. Mirine-Fulfinum, canalisation et cuve d’un pressoir (à huile ?) antique de la villa (cl. S. Bully) Mirine-Fulfinum, cliché de détail du peigne paléochrétien : scène de l’hémorroïsse (cl. D. Doračić) Lien : ČAUŠEVIĆ-BULLY (M.), BULLY (S.), Les sites ecclésiaux et monastiques de l’archipel du Kvarner (Croatie) : campagne 2017, Chronique des activités archéologiques de l’École française de Rome, 2016, https://cefr.revues.orgÀ paraître BULLY (S.), JURKOVIĆ (M.), MARIĆ (I.) et ČAUŠEVIĆ-BULLY (M.), « Monastère Saint-Pierre d’Osor (Croatie, île de Cres). Bilan de la mission franco-croate 2017 », Chronique des activités archéologiques de l’École française de Rome, https://cefr.revues.org
Saint-Pierre d’Osor et les monastères et sites ecclésiaux insulaires dans l’archipel du Kvarner (Croatie)/ Campagne 2017
Responsables : Sébastien Bully (UMR ARTEHIS), Morana Čaušević-Bully (université de Bourgogne Franche-Comté-UMR Chrono-environnement), Miljenko Jurković (université de Zagreb-centre IRCLAMA) et Iva Marić (centre IRCLAMA)
Participation de : Thomas Chenal (UMR ARTEHIS), Adrien Saggese (UMR ARTEHIS), Mélinda Bizri (UMR ARTEHIS), Ivan Valent, Jessy Crochat, Lucija Dugorepec, Valentin Chevassu (UBFC-UMR Chrono-environnement), Matthieu Le Brech (UBFC),Agnès Stock (UBFC-UMR Chrono-environnement), Georgie Baudry (UBFC), Maxime Bolard (UBFC), Anaïs Deliste (Univ. Aix-Marseille)et les contributions de Pascale Chevalier (UMR ARTEHIS), Inès Pactat (UBFC-UMR Chrono-environnement), Mia Rizner, Miroslav Vuković, Trninić Goran, Petra Urbanova (UMR IRAMAT), Bernard Gratuze (UMR IRAMAT) et Vivien Prigent (UMR Orient et Méditerranée).
En partenariat avec aIPAK/APAHJ
Dates de chantiers : du 18 au 29 avril, du 29 mai au 18 juin, du 19 juin au 7 juillet et du 11 au 16 septembre.
Financements : ministère des Affaires étrangères français, ministère de la Culture croate, École française de Rome, Commune d’Omišalj, Région de Primosko-Goranska, Caritas veritatis foundation.


Résultats






Bretenière (21) : grandmontain d’Époisses / campagne 2017

Responsable : Ronan Steinmann Le prieuré d’Époisses, celle de l’Ordre de Grandmont fondée en 1189 à une dizaine de kilomètres au sud de Dijon, devenue prieuré en 1317, est un site largement méconnu. Grâce aux donations d’abord, celles du duc Hugues III en premier lieu, mais aussi grâce à une politique d’achat active, les religieux grandmontains ont réussi à constituer un petit patrimoine foncier varié, entre plaine de Saône, coteaux viticoles et ville. Suite à la disparition de l’Ordre avant la Révolution française, et la vente des Biens Nationaux, le prieuré perd sa vocation initiale et connaît de multiples remaniements en fonction des propriétaires successifs. Il accueille aujourd’hui un centre de recherches expérimentales de l’INRA. Les projets de restructuration du site, envisagés par l’INRA, offrent l’opportunité d’une enquête combinant à la fois les outils de prospection géophysiques à l’étude de bâti des quelques éléments bâti restant. Ces vestiges médiévaux, correspondant a priori à la salle capitulaire, sont en effet intégrés à un ensemble bâti suffisamment éparse pour envisager une campagne de prospection sur l’ensemble de l’espace supposé de l’église prieurale et des bâtiments conventuels primitifs. Cette opération s’inscrit dans les enseignements dispensés au sein du Master AGES associé au laboratoire. Pauline Lasson, étudiante en master I, participe à cette étude dans le cadre de son TER et doit être initiée aux méthodes, techniques et problématiques de la prospection géophysique dans un milieu bâti complexe. L’étude des éléments bâtis et l’inventaire d’éventuels éléments médiévaux remployés s’intègrent enfin dans le cadre d’une vaste enquête sur la pierre à bâtir bourguignonne. Le prieuré d’Époisses viendrait apporter des données relatives à l’importation de pierres sur les sites médiévaux de la plaine de Saône. En fonction des premiers résultats de l’étude et surtout du projet architectural final que l’INRA mettra en œuvre en 2017-2018, les investigations seront éventuellement complétées de sondages ou fouilles dans le cadre de l’archéologie préventive.
Prieuré grandmontain d’Époisses – commune de Bretenière (21) / campagne 2017
Participation de membres d’ARTEHIS : Marion Foucher, Melinda Bizri
Dates de chantier : avril-mai 2017Le site

Objectifs et résultats
Perspectives
Sermesse (71) : Paléoméandre de la Morte / campagne 2017
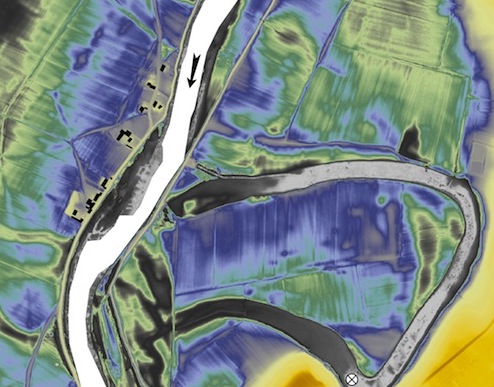
Responsable : Ronan Steinmann Le paléoméandre de la Morte est le seul bras mort visible en bordure du Doubs atuel dans sa partie aval (après le pont de Navilly). Déjà indiqué comme abandonné sur la Carte des Cassini levée ici entre 1750 et 1760, il avait fait l’objet d’un premier carottage en 2009. Ce premier test, d’une profondeur de trois mètres, n’avait pas permis d’atteindre le début du remplissage argileux qui marque l’abandon du bras par le courant. L’âge radiocarbone réalisé au bout de la carotte prélevée montre que le bras se comble depuis au moins les années 901-1036 ap. J.-C. à 95,4 % d’intervalle de confiance. Cet ancien chenal montre, encore aujourd’hui, une forme très marquée dans le paysage, comme on peut le voir sur le modèle numérique de terrain LiDAR. La sédimentation a été particulièrement rapide dans ce méandre abandonné qui est devenu une mare se comblant petit à petit d’argiles. De tels enregistrements peuvent être très intéressants pour étudier le régime des crues du Doubs ou l’évolution de la végétation, l’absence d’oxygène favorisant la préservation de la matière organique et donc des pollens et organismes anciens. Du point de vue archéologique, de tels comblements sont également susceptibles de contenir des vestiges qui ne sont le plus souvent pas conservés (tissus, cuirs, vanneries, etc.). Les dimensions importantes du méandre laissent penser à une forme ancienne, réactivée avant d’être abandonnée puis comblée d’argiles au moins à partir du Xe siècle de notre ère. Une autorisation de prospection a été demandée afin de reconstituer l’histoire de ce bras mort et d’en déterminer le potentiel archéologique. Un étudiant de Master 1 AGES, Corentin Martinez, a choisi de travailler sur cette question pour son mémoire de recherche. Il a débuté l’étude par l’analyse des plans anciens, de la bibliographie archéologique et des données LiDAR, préalable indispensable aux opérations de terrain. Il s’agira tout d’abord de décrire la géométrie générale du comblement par le biais de coupes de la résistivité apparente du sous-sol. Selon la lithologie, la porosité et la teneur en eau sous la surface, la résistivité présente des valeurs très différentes qui peuvent correspondre à des changements dans la sédimentation du comblement du bras abandonné. En fonction des résultats obtenus sur ces coupes, des carottages ciblés sur des points problématiques seront réalisés pour décrire finement le remplissage de ce bras. Les carottes seront prélevées pour d’éventuelles analyses postérieures (granulométrie fine, détermination de macro-restes, palynologie, mesure de la susceptibilité magnétique, prélèvements pour datations radiocarbone). La corrélation des différents forages et des coupes de résistivité doit permettre de reconstituer les différentes étapes de formation et de comblement de cet ancien bras, seul paléotracé en aval de Navilly. Ce travail sera d’abord mené dans le cadre du mémoire de Master AGES de Corentin Martinez, puis fera l’objet d’un rapport déposé au SRA. À terme, ce travail pourrait enrichir les travaux géoarchéologiques menés sur le Doubs aval depuis 2008 et faire l’objet de publications dans des revues scientifiques de rangs national et international.
Paléoméandre de la Morte – commune de Sermesse (71) / Campagne 2017
Dates de chantier : avril-juillet 2017Le site
Objectifs et résultats
Perspectives
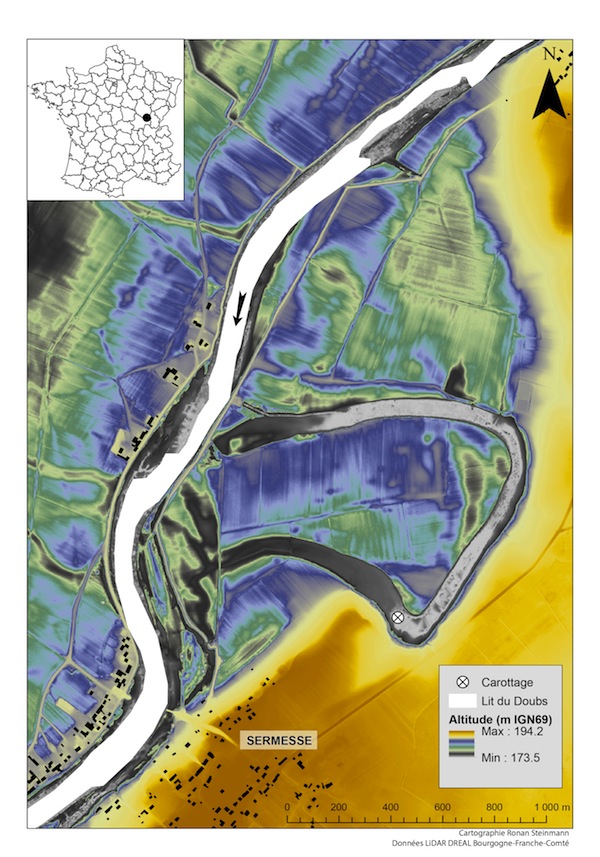
Vert-Toulon (Vert-la-Gravelle) : « La Crayère » (Marne, France) / campagne 2017

Responsable : Rémi Martineau (CR CNRS) Situé dans la région archéologiquement riche des marais de Saint-Gond (Marne), le site de Vert-la-Gravelle « La Crayère » fait l’objet d’une fouille depuis 2013 sous la responsabilité de Rémi Martineau. Localisé sur une très forte pente, il présente la particularité de réunir dans un lieu unique une minière de silex du Néolithique moyen II (4300-4000 avant notre ère) et une nécropole d’hypogées attribuée au Néolithique récent (3500-3000 avant notre ère). Outre la présence de différentes structures d’extraction (fosses, tranchées, puits) qui apportent de nombreux renseignements sur les méthodes employées, la plus grande particularité du site réside dans le fait que les couloirs d’hypogées ont été creusés dans les comblements d’une tranchée d’exploitation de silex. Ces comblements, qui peuvent atteindre plus d’1,2 m de hauteur, ont livré une grande quantité de mobilier (bois de cervidé, silex taillé). Les couloirs des hypogées ont livré un mobilier plus rare, tandis que les chambres funéraires, fouillées au XIXe siècle par J. de Baye, contenaient des poteries, des gaines de haches en bois de cerf, des poinçons en os, des outils en silex, des armatures de flèches. – Comprendre la succession chronologique des creusements et des comblements La campagne de 2017 clôturera la fouille du site de « La Crayère ». Les résultats de cette année permettront de connaître avec précision les creusements des différents aménagements du site et d’assurer leur enregistrement en trois dimensions (dessins en coupe et en plan, prises de vue photographiques, photogrammétrie). Des informations sur les méthodes de comblement employées au Néolithique complèteront notre connaissance des processus de remblaiement des structures minières. Des sondages seront effectués en haut et en bas de la pente afin de définir l’extension du site et de chercher des aménagements ou des aires d’activité domestiques ou artisanales (taille du silex). Le site de Vert-la-Gravelle « La Crayère » fait actuellement l’objet d’une étude concernant son éventuel futur aménagement pour permettre l’accessibilité au public. Par ailleurs le site s’inscrit dans un programme d’étude plus large sur le Néolithique dans les marais de Saint-Gond, dont l’un des sujets d’étude principal concerne les sites d’habitat, encore inconnus dans la région. A partir des nombreuses prospections effectuées depuis 2011, des sondages seront réalisés en 2017 et en 2018 sur le territoire de plusieurs communes limitrophes.
Minière de silex et nécropole d’hypogées néolithiques de Vert-Toulon (Vert-la-Gravelle) « La Crayère » (Marne, France) / campagne 2017
Participation de membres d’ARTEHIS : Anthony Dumontet (AI CNRS)
Dates de chantier : Du 28 Mai au 8 Juillet 2017
Financement : Ministère de la Culture, Communauté d’agglomération d’EpernayLe site :

Objectifs de la campagne 2017 :
– Fouiller, relever et enregistrer les couloirs des hypogées et les structures de la minièreRésultats :
Perspectives :
Meaux (77): sanctuaire de « La Bauve / Arpent Videron » / campagne 2017

Responsable : Thibault LE COZANET (Université de Bourgogne Franche-Comté / UMR 6298 ARTEHIS) et co-responsable Elisabeth GOUSSARD (ENS-EPHE / UMR 8546 AOROC) (Lat. : 48.9627881; Long. : 2.882646) ; Sanctuaire antique monumental avec une occupation « rituelle » protohistorique qui demande à être précisée. Préciser la chronologie (par la typologie, mais aussi des analyses C14), préciser les relations stratigraphiques entretenues entre le sanctuaire « protohistorique » et le sanctuaire antique, définir les pratiques dépositionnelles réalisées, analyser la structuration des vestiges pour comprendre l’organisation de l’occupation protohistorique et enfin compléter la documentation des opérations précédentes par des investigations ponctuelles ciblées.
Meaux : Sanctuaire de « La Bauve / Arpent Videron » / campagne 2017
Participation de membres d’ARTEHIS : oui
Dates de chantier : 5/06/17 au 7/07/17
Financement : SRA Île-de-FranceSite :

Objectifs et résultats :
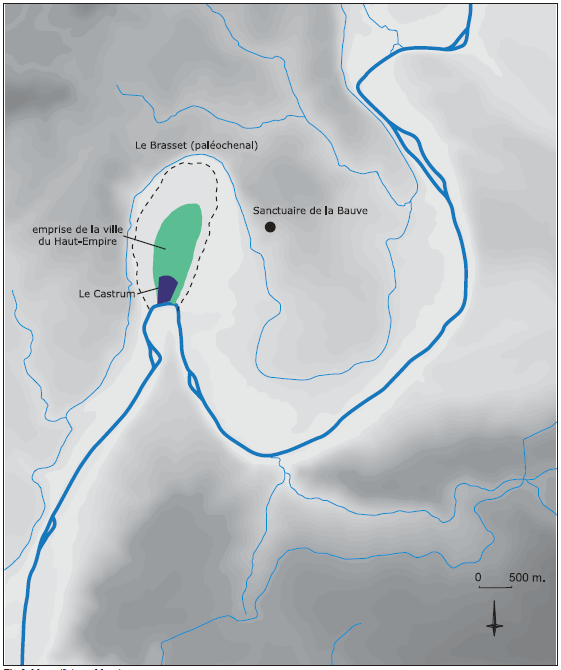
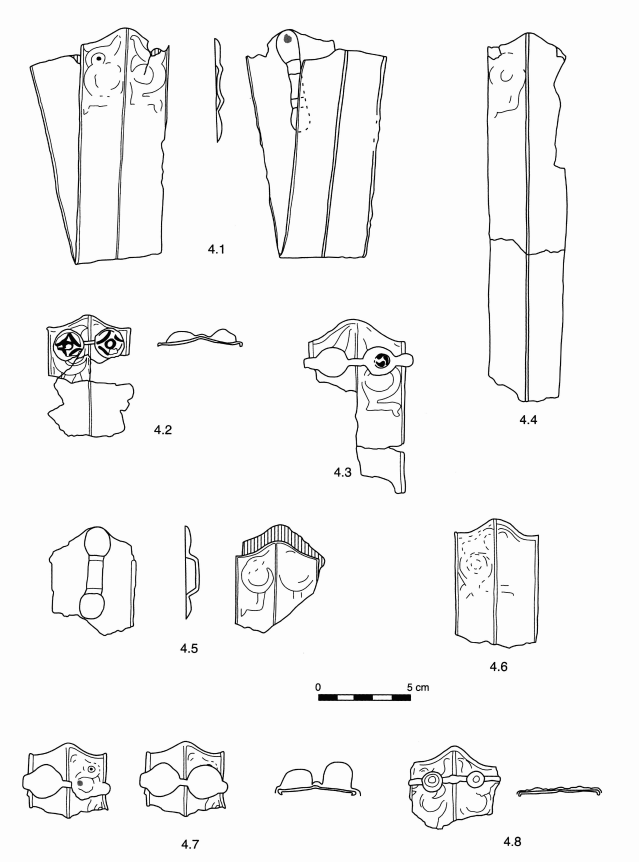
Sermesse (71) : fouilles subaquatiques du moulin / campagne 2017
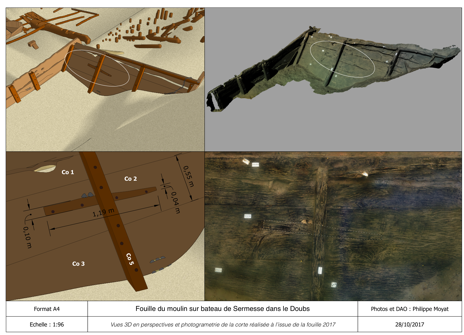
Cette opération est placée sous la responsabilité d’A. Dumont, co-financée par le SRA Bourgogne, le DRASSM, et la Région Bourgogne-Franche-Comté. Le DRASSM a également mis à disposition des moyens humains (temps de travail d’A. Dumont pour les phases terrain et rédaction du rapport) et logistiques (matériel de plongée, bateau). Le projet associe divers collaborateurs : P. Moyat (ETSMC et UMR ARTEHIS), M. Cayre (Evéha), D. Le Cornu (étudiant Univ. Rennes), C. Bonnot-Diconne (Laboratoire 2CRC, traitement et étude des cuirs et matières végétales), Noureddine Kefi (étude de mobilier), Luc Jaccottey (Inrap, UMR 6249, étude des meules), Pierre Mille (Inrap, étude des bois), M. Treffort (bénévle, dessin), laboratoire le CREAM (traitement objets métalliques) et laboratoire Nucleart (traitement objets bois). En 2017, la fouille du grand bateau, appelé la corte, a débuté et a permis un dégagement des premiers bordés et de l’intérieur de la proue. Une chaîne, encore enroulée autour d’un bordé à l’angle avant tribord, part dans la berge, montrant que le moulin était amarré et en position de fonctionnement au moment de son naufrage. Plusieurs réparations sont visibles, témoignant de l’usure de cette embarcation. Réparation visible sur la proue de la corte dégagée au cours de la campagne 2017. Infographie P. Moyat. Dans le même temps, un travail de décapage et d’étude de la benne, dispositif implanté en amont du moulin, destiné à diriger l’eau sur la roue, et constitué de deux alignements de pieux disposés en V a été réalisé. La fouille a permis de découvrir deux serpettes en très bon état, perdues au cours d’une opération de réparation et de mise en place de bois de renfort, ce type d’installation nécessitant un entretien permanent. Les pieux ont été systématiquement échantillonnés sur deux carrés. Ces prélèvements sont destinés à la détermination des essences (en cours, Fr. Blondel) afin de mieux connaître les modalités d’exploitation de la forêt au début de l’époque moderne. On verra ainsi si une essence a été privilégiée ou si plusieurs types de bois ont été utilisés. On a également procédé au dégagement de la partie externe de la proue du petit bateau, ce qui a permis de découvrir un plancher effondré dont la fonction précise reste à déterminer. Dans l’état actuel des recherches, on pense à un probable espace de circulation permettant d’accéder aux proues des deux bateaux et à la roue. Les digues faisant également office de piège à poissons, il peut s’agir d’un espace de travail dédié à cette activité de capture. Figure 8. Plan et photogrammétrie du dispositif de plancher découvert en amont du forain au cours de la campagne 2017. Infographie P. Moyat.
Fouilles subaquatiques du moulin de Sermesse (71) dans le Doubs / 2017
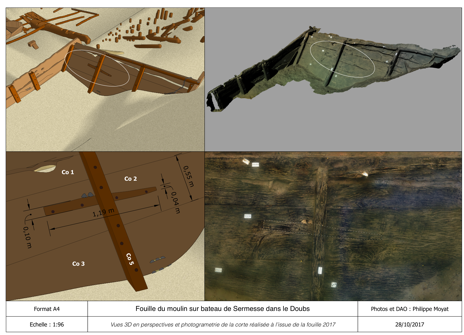

Saint-Satur (Cher) : fouilles de l’épave / campagne 2017

Cette opération est placée sous la responsabilité d’A. Dumont, co-financée par le SRA Centre, le DRASSM, et la Région Centre Val de Loire, via l’Association ARCHEA. Le DRASSM a également mis à disposition des moyens humains (temps de travail d’A. Dumont pour les phases terrain et rédaction du rapport) et logistiques (matériel de plongée). Découverte en 2011, sondée en 2015, l’épave de Saint-Satur représente un potentiel inédit pour la connaissance de l’architecture navale du bassin de la Loire à la fin du Moyen Age, pour l’histoire de la circulation des matériaux sur le fleuve et la vie quotidienne des mariniers de cette époque. Pour cette raison, il a été décidé de la fouiller entièrement au cours d’une campagne qui a eu lieu en août 2017. Fouille de l’intérieur de la coque du bateau de Saint-Satur. Cliché P. Moyat. Pour arriver à réaliser le relevé complet de la coque afin d’en faire une étude architecturale, les blocs qui constituent la cargaison ont été enlevés un par un à l’aide d’une pelle mécanique. Ils ont été déposés sur la plage pour les étudier, avant de les remettre en place lorsque le relevé de la coque a été achevé. Des échantillons de pierre ont été prélevés pour détermination, ainsi que des ardoises, et des morceaux de bois pour analyse dendrochronologique. Ces études sont en cours et les résultats seront disponibles début 2018. Marion Foucher et Alexandre Polinski étudient la cargaison de blocs déposée sur la plage après avoir été sortie de l’épave de Saint-Saur. Cliché P. Moyat. A l’issue de la campagne de fouille 2017, on peut d’ores et déjà revenir sur l’hypothèse formulée en 2015 : les ardoises originaires de l’Anjou, présentes avec la cargaison de blocs, nous avaient laissé supposer que ce bateau remontait le courant de la Loire puisqu’il n’existe pas de gisement d’ardoise en amont. L’analyse pétrographique effectuée sur un échantillon de la pierre transportée désigne les calcaires bathoniens et calloviens (Jurassique moyen) du Nivernais. Ces calcaires, qui affleurent essentiellement dans les environs d’Apremont-sur-Allier dans le Cher, et de Nevers dans la Nièvre, ont été exploités respectivement sous les noms de « pierre d’Apremont » et « pierre de Nevers ». Ces deux matériaux présentent des caractéristiques lithologiques assez proches et peuvent donc facilement être confondus, aussi, une analyse complémentaire est en cours. Quel qu’en soit le résultat, il apparaît évident que l’épave descendait la Loire avec des blocs extraits en amont, et des ardoises issues d’un stock déposé dans un port en bord de fleuve ou d’un autre chantier. Une fois les blocs enlevés, une partie du plancher qui protégeait la coque du poids des pierres, a été démontée. Constitué de fines planches en chêne comprenant un nombre parfois importants de cernes, il a été prélevé et échantillonné sur place par C. Lavier. Les quelques planchettes extraites en 2015 de l’épave avaient révélé que les bois avaient probablement été coupés à la charnière entre le XVe et le XVIe siècle. La date 14C effectuée en 2012 donnait, en âge calibré, une fourchette comprise entre 1319 et 1435 ap. J.-C., soit entre le début XIVe et le début XVe siècle. Elle est donc plus ancienne que la date obtenue après la première analyse dendrochronologique. Il est probable que ce décalage de près d’un siècle soit lié au fait que l’échantillon pour l’analyse radiocarbone a été prélevé sur une extrémité de membrure érodée qui émergeait du sable en 2011. Si cette membrure a été taillée dans un chêne centenaire, ce qui est tout à fait possible, et que le prélèvement a concerné le cœur de l’arbre, la date 14C serait plus proche du début de la croissance de l’arbre que de celle de son abattage. Les planchettes analysées en dendrochronologie font partie d’un plancher rapporté sur le fond de l’épave, mais ce fait ne permet en aucun cas d’expliquer un décalage de 100 ans car la durée de vie des embarcations fluviale est beaucoup plus courte, et, dans de bonnes conditions, n’excèdent pas trente années. La suite de l’étude des bois permettra sans doute de préciser la date de coupe des arbres. Catherine Lavier, dendrochronologue, découpe sur place des échantillons du plancher de l’épave pour analyse. Cliché P. moyat. Une fois le plancher enlevé, la structure de la coque était alors visible et a pu être dessinée et photographiée. On a pu ainsi observer des réparations, le rythme des renforts transversaux, ainsi que les techniques d’assemblage employées par les constructeurs.Si l’on se réfère aux connaissances disponibles, le bateau de Saint-Satur possède les caractéristiques des embarcations traditionnellement rencontrées sur la Loire aux époques médiévales et modernes : bateau à fond plat, aux flancs assemblés à clin. Sa fouille complète a permis de vérifier qu’il était muni d’une emplanture de mât, même si celle-ci se trouve sur l’une des pièces de bois les plus dégradées ; en revanche, les deux extrémités étant inaccessibles (l’une est détruite, l’autre est enfouie sous la berge) aucun dispositif de gouvernail n’a pu être observé. Nous avons découvert cinq nouvelles chaussures en cuir, deux fragments de cuir et un fragment de textile. Les chaussures viennent compléter la série découverte il y a deux ans ; leur traitement pour conservation a été effectué par Céline Bonnot-Diconne (laboratoire 2CRC à Moirans), et l’étude complète est prévue pour 2018. L’épave contenait également un maillet de charpentier en bois (conservé avec le manche), et un couteau avec lame en fer (très corrodée) et manche en bois conservé, ainsi que quelques clous. Ces objets seront stabilisés dans les laboratoires Nucleart à Grenoble (bois gorgé d’eau) et au CREAM à Vienne (métal) et seront ensuite étudiés, leur manipulation étant très délicate tant qu’ils ne sont pas traités. Les deux objets métalliques découverts en 2015, une gouge et un fer de bâton de quartier, viennent de sortir du traitement de stabilisation (CREAM). Ces découvertes restent exceptionnelles car il est très rare que ce type d’éléments soit préservé dans le sable de la Loire. Ils se trouvaient au fond de la coque, sous les blocs, et près du flanc conservé, soit dans les zones qui ont été le moins soumises à l’érosion. Un film de 13’ réalisé par l’Association La tête dans la rivière, Web-TV spécialisée dans la vulgarisation scientifique sera disponible dans le courant de l’année 2018. Une chaussure en cuir au moment de sa découverte dans l’épave de Saint-Satur. Cliché P. Moyat.
Fouilles de l’épave de Saint-Satur dans le lit de la Loire (département du Cher, région Centre) / campagne 2017
Le projet associe divers collaborateurs : M. Foucher (UMR ARTEHIS, étude de la cargaison), P. Moyat (ETSMC et UMR ARTEHIS, fouille et restitution 3D de l’épave), Alexandre Polinski (UMR6566 – CReAAH), Gérard Mazzochi (archéologue bénévole), Christophe Fraudin (cadreur, réalisateur), Association La Tête dans la Rivière, Céline Bonnot-Diconne (2CRC – traitement et étude des cuirs et matières végétales), Catherine Lavier (UMR8220, UPMC, LAMS), étude dendrochronologique.



Joux-la-Ville (Yonne) : Fouille de la grange cistercienne / campagne 2015-2017

Responsable : Sylvain Aumard, Associé ARTEHIS L’établissement d’Oudun est mentionné comme grangia dès 1164 dans le temporel de l’abbaye de Reigny et conserve aujourd’hui un bâtiment du XIIe siècle destiné à l’hébergement des convers. L’accompagnement archéologique des restaurations entreprises depuis 2011 a permis d’appréhender le site sur la longue durée (XIIe-XIXe s.). La fouille des abords du bâtiment médiéval a confirmé l’emprise de celui-ci et a permis d’en préciser le contrebutement en grande partie disparu, tout en mettant en évidence son articulation avec d’autres constructions mitoyennes partiellement reconnues au cours des campagnes suivantes : un oratoire à l’est (2012 et 2014), deux autres corps de bâtiment abritant au nord une cuisine et un cellier (2013 et 2015). En 2016, a été confirmée l’interprétation du logis des convers disposant d’un réfectoire au rez-de-chaussée et d’un dortoir à l’étage. Des hypothèses ont pu être formulées sur l’organisation interne du réfectoire équipé d’un passe-plat communiquant avec la cuisine et d’emmarchements et estrades recevant le mobilier destinés à la prise des repas. L’objectif de la campagne 2017 consistait à revenir sur les abords pour approfondir la compréhension des autres bâtiments dont l’emprise avait été confortée par la prospection géo-radar de l’hiver 2016. Presque intégralement fouillé, l’oratoire a ainsi été confirmé dans ses fonctions (présence d’un autel), son architecture (chevet plat à épaulement) et sa chronologie, malgré les perturbations, modifications et reconstructions successives. Son origine alto médiévale, indiquée par Victor Petit au XIXe siècle, n’a pu être vérifiée mais les premières assises de ses maçonneries pourraient remonter aux XIIe-XIIIe siècle à l’instar des sols de mosaïques en terre cuite aux motifs floraux (analyses en cours). Une série de sondages a également permis de préciser l’emprise des autres bâtiments : corps en équerre abritant la cuisine, le cellier et son accès. En revanche, l’hypothèse d’un bâtiment sanitaire avec latrines en bout dortoir n’a pu être étayée. L’année 2018 sera consacrée à la finalisation des études (céramique, métallurgie) et à la préparation d’un manuscrit en vue d’une publication monographique. Les observations menées à Oudun comptent parmi les très rares recherches entreprises sur les établissements monastiques à vocation économique dont on connaît fort mal les infrastructures, tant dans leur organisation, leur fonction ou leur évolution. D’une manière générale, le cadre de vie des convers est mal documenté et les analyses conjointes du sol et du bâti entreprises durant ces sept années constituent ainsi un apport nouveau à ce volet de la connaissance du monde monastique au delà de l’enceinte de l’abbaye. Le bâtiment médiéval en cours de restauration (cl. S. Aumard – CEM, 2013). Le bâtiment médiéval en cours de restauration (cl. S. Aumard – CEM, 2013). Le bâtiment médiéval en cours de restauration (cl. S. Aumard – CEM, 2013).
Fouille de la grange cistercienne d’Oudun à Joux-la-Ville (Yonne) – dernière campagne programmée (2015-2017)
Participation de : Fabrice Henrion, associé ARTEHIS et Stéphane Büttner, associé ARTEHIS
Dates de chantier : 3-28 juillet 2017
Financements : DRAC et commune de Joux-la-VilleLe site, les objectifs et résultats, les perspectives



L’occupation rurale antique et alto-médiévale des Crassées à Saint-Dizier (Haute-Marne) / 2017

Responsables : Raphaël Durost et Stéphanie Desbrosse-Degobertière. Les résultats obtenus lors des six campagnes déjà réalisées, de 2011 à 2016, documentent les douze premiers siècles historiques sur un millier et demi de mètres carrés. Ils démontrent l’attraction suscitée par ce versant de la vallée de la Marne dès le tournant d’ère, en contexte rural, à mi-chemin entre les agglomérations de Perthes et de Gourzon (Bayard-sur-Marne). Le secteur ne perd son rang qu’au XIIe siècle, lorsque l’agglomération de Saint-Dizier est créée sur l’autre rive par les seigneurs de Moëslains. Cette désertion permet de disposer de 1200 ans de vestiges archéologiques sans recouvrement urbain, illustrant de manière très fournie les différentes étapes d’un phénomène typique de cette période, à savoir la transformation d’un domaine gallo-romain en un point de peuplement alto-médiéval. Les 1690 m² explorés ont déjà livré des témoignages matériels de chacun des douze premiers siècles historiques. Le bâtiment résidentiel du domaine gallo-romain est connu en deux secteurs présentant trois phases successives dont deux concernent les salles balnéaires, au moins utilisées jusqu’au milieu du IVe siècle. Si aucun aménagement n’est encore daté avec certitude du Ve siècle, l’emprise du bâtiment est occupée sans ambiguïté au siècle suivant puisqu’un aristocrate y est inhumé en chambre avec le mobilier caractéristique des tombes mérovingiennes dites « de chef ». Cette position au sein du bâtiment antique, à l’écart des trois tombes contemporaines de même rang de « La Tuilerie », est singulière. Elle demande une interprétation qu’il n’est pas encore possible d’apporter. Sa datation du VIe siècle est actuellement la plus ancienne de la nécropole et suggère qu’il s’agisse de la sépulture fédératrice, suffisamment fédératrice pour donner naissance à une paroisse carolingienne dont les fondations conservées de l’église enserrent la tombe. Les habitations des défunts carolingiens sont connues par les fouilles préventives voisines du « Chêne Saint-Amand ». La compréhension de l’habitat de l’Antiquité tardive et mérovingien demande à ce que la fenêtre d’exploration soit étendue. Dans les années à venir, deux secteurs sont prioritaires : celui situé entre les deux aires de fouilles actuelles d’une part et celui entourant les salles balnéaires d’autre part. D’un point de vue topographique, il s’agit de la pente et du pied de la pente. Le premier secteur permettra d’étudier le lien entre ce qui semble être actuellement deux bâtiments résidentiels antiques successifs. Le décalage de leur orientation le laisse penser mais il pourrait s’agir également d’une adaptation au relief pentu. Par ailleurs ce secteur promet davantage de sépultures mérovingiennes conservées. Les pentes sont réputées attractives à cette époque et son écart du lieu de culte doit l’épargner des perturbations antérieures. Il sera très instructif de disposer de la superposition des deux phases d’occupation, de manière à observer comment les sépultures tiennent compte du bâtiment antique. L’exploration du second secteur en bas de la pente, autour des salles balnéaires, est destinée à disposer de la puissance stratigraphique la plus importante possible. La conservation de sols antiques et de niveaux d’abandon a été constatée par les travaux des années 1960 de Louis Lepage et confirmée par nos campagnes de 2012 et 2013. Il s’agit donc du secteur le plus propice à la conservation d’aménagements aux fondations légères qui caractérisent les occupations domestiques mérovingiennes. Ici, il s’agira donc d’étudier les modalités d’abandon du bâtiment résidentiel créé au Haut Empire, et de sa succession. A cet égard, la recherche d’habitations mérovingiennes susceptibles d’appartenir à l’élite inhumée aux Crassées et à La Tuilerie est la priorité. L’objectif de ce second programme triennal est donc de poursuivre les enquêtes historiques en cours afin de présenter un modèle exceptionnellement bien fourni de l’évolution d’un territoire rural durant les douze premiers siècles historiques, de la base de sa hiérarchie sociale jusqu’au sommet.
Dates de chantier : Du 06 juin au 07 juillet 2017.
Financement : Ville de Saint-Dizier, Inrap et Ministère de la Culture (DRAC Grand-Est)Description, objectifs :








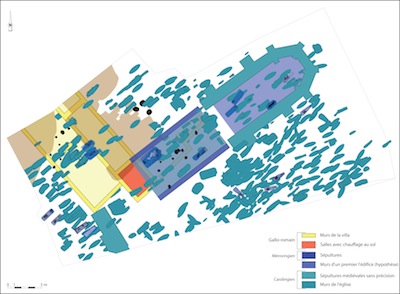

Archipel du Kvarner (Croatie) / campagne 2016

Mission archéologique du ministère des Affaires étrangères (second volet) Mirine-Fulfinum, secteur de « l’église à trois absides », vue générale de la villa à l’issue de la campagne 2016 (cl. S. Bully) Le programme de prospection-inventaire des sites ecclésiaux insulaires engagé en 2010 est structuré autour de trois axes majeurs : – Identification des sites monastiques potentiels à partir des sources écrites, des données archéologiques, architecturales et topographiques ; – Conditions et modalités de l’installation et de la diffusion du monachisme insulaire dans le Kvarner, entre le ve et le xie siècle : occupation du sol et voies maritimes, construction de l’espace ; – Topographie monastique et architecture cultuelle : héritages et influences, cénobitisme et érémitisme. L’exécution de ce programme passe un dépouillement bibliographique, des sondages archéologiques, des études de bâti, des relevés topographiques, la constitution d’une documentation graphique et photographique, des prospections pédestres et géophysiques. Mirine-Fulfinum, secteur de « l’église à trois absides », détail d’une canalisation antique à fond de tesselles en terre cuite (cl. S. Bully) En 2016, la fouille du secteur de la petite église nord du complexe de Mirine-Fulfinum (île de Krk) est menée dans le cadre d’un chantier-école de l’université de Franche-Comté et de l’aménagement d’un parc archéologique. Elle a permis de mieux circonscrire l’établissement antique – probable villa suburbaine – dans lequel elle fut édifiée, tout en doutant désormais d’une fonction monastique pour privilégier l’hypothèse d’une église votive (des IXe-XIe s.), sans lien direct avec la villa, vraisemblablement abandonnée dès le VIe s. La basilique chrétienne du Ve s. de Mirine a fait l’objet d’un relevé intégral par orthophotographie en préalable d’une révision de son étude architecturale et archéologique du bâti. Concernant le complexe ecclésial de Martinšćica, la seconde campagne de fouille sur la grande église paléochrétienne nous a permis de documenter des installations liturgiques élaborées (bema, fosse d’autel) et de recenser un mobilier liturgique de qualité, nous interpellant sur le statut de l’édifice, avec, plus particulièrement, la découverte d’un monogramme sur un fragment de mensa en marbre. La fouille a également révélé deux sacristies sur le flanc nord de l’église. L’une d’elle conserve un magnifique pavement de mosaïques géométriques, scellé par un niveau d’occupation (foyer) induisant un très probable changement de fonction. Et c’est également une occupation domestique que l’on tend à attribuer à une annexe greffée contre l’abside centrale. Dans le dessein d’une appréhension plus large des sites étudiés, nous avons également engagé cette année de premiers forages destinés aux analyses paléoenvironnementales des îles de Krk et Cres. Mirine-Fulfinum, plan général du secteur de fouille, état 2016 (plan et dessin, M. Čaušević-Bully et Th. chenal) Martinšćica, vue générale de l’église à l’achèvement de la fouille 2016 (cl. M. Vuković) ČAUŠEVIĆ-BULLY (M.), BULLY (S.), Kvarner (Croatie). Prospection-inventaire des sites ecclésiaux et monastiques : campagne 2016, Chronique des activités archéologiques de l’École française de Rome, https://cefr.revues.org Martinšćica, cliché des sacristies nord (cl. S. Bully)
Les monastères et sites ecclésiaux insulaires dans l’archipel du Kvarner (Croatie). Campagne 2016
Responsables : Morana Čaušević-Bully (université de Bourgogne Franche-Comté-UMR Chrono-environnement), Sébastien Bully (UMR ARTeHIS)
Participation d’Ivan Valent, Thomas Chenal (UMR ArTeHiS), Adrien Saggese (UMR ArTeHiS), Jessy Crochat, Lucija Dugorepec, Valentin Chevassu (UBFC-UMR Chrono-environnement), Hervé Richard (UBFC-UMR Chrono-environnement), Emilie Gauthier (UBFC-UMR Chrono-environnement), Vincent Bichet (UBFC-UMR Chrono-environnement), Mathieu Thivet (UBFC-UMR Chrono-environnement), Agnès Stock (UBFC-UMR Chrono-environnement), David Vuillermoz (APAHJ) et les contributions de Pascale Chevalier (UMR ARTEHiS), Inès Pactat (UBFC-UMR Chrono-environnement), Mia Rizner, Miro Vuković.en partenariat avec aIPAK/APAHJ
Dates de chantier : du 11 au 22 avril, du 27 juin au 14 juillet.
Financements : ministère des Affaires étrangères français, ministère de la Culture croate, École française de Rome, Commune d’Omišalj, Commune de Mali Losinj, Région de Primosko-Goranska, Caritas veritatis foundation
Objectifs

Résultats
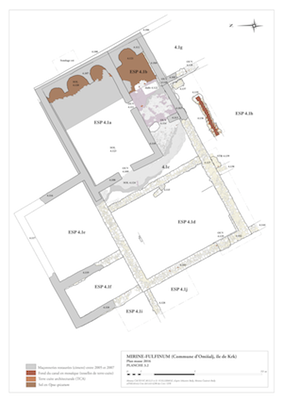

Lien

Franche-Comté et Bourgogne : Monastères (Ve–Xe siècles)

Coordination : Sébastien Bully et Christian Sapin (UMR ARTeHIS) en partenariat avec l’UMR Chrono-environnement, l’UMR METIS – université Pierre et Marie Curie Paris VI-Jussieu, le Centre d’études médiévales d’Auxerre, l’APAHJ (Saint-Claude) Mont Saint-Martin de Faucogney, découverte d’une structure sur poteaux (cl. S. Bully) Fontaine-les-Luxeuil, maçonneries de l’église Saint-Martin et sarcophages (cl. M. Bolard) Pour la dernière année du PCR, nous avons décliné nos activités autour de huit actions de recherches et de diffusion de la recherche : 1- Autour du « monachisme luxovien » (Axe 1): • Sondages archéologiques sur le site du Mont Saint-Martin de Faucogney (Haute-Saône) ; Résultats : caractérisation d’une occupation de l’Antiquité tardive par la découverte de structure(s) sur poteaux et de mobiliers. • Sondages archéologiques sur le site du monastère et de l’ancienne église Saint-Martin de Fontaine (Haute-Saône) (Responsable M. Bolard) ; Résultats : découvertes de vestiges du haut Moyen Âge (maçonneries et sarcophages) et gothiques (élévation enchâssée dans l’ancienne cure) de l’église Saint-Martin ; localisation, par sondage, de l’église romane du monastère. 2- Poursuite des prospections géophysiques en Franche-Comté et en Bourgogne : Seconde campagne à Faverney, Château-sur-Salins, Saint-Père-sous-Vézelay, Moutiers- Saint-Jean (Responsables Colas Finck, Mélanie Grenot, Hugo Parent, Philippe Beyney, Christian Sapin) ; 3- Poursuite de l’étude de l’abbaye de Baume-les-Messieurs (Axe 3): • Études archéologiques des élévations des bâtiments claustraux (Responsable M. Le Brech) ; 4- Poursuite de l’étude du prieuré de Marast (Axe 3) : • Récolement de la documentation ; • Études archéologiques des élévations des bâtiments claustraux (Responsable O. Salvi) ; Prieuré de Marast, étude d’archéologie du bâti des élévations médiévales (relevé O. Salvi) 5- Abbaye de Faverney (Haute-Saône) (Responsable M. Grenot) (Axe 4) • Récolement de la documentation ; • Études archéologiques des élévations de l’église ; 6- Crypte de l’église prieurale Saint-Maurice de Jougne (Responsable S. Bully) (Axes 2 et 4) • Études archéologiques des élévations ; Résultats : détermination du parti architectural de la crypte et proposition de datation du monument de la fin du XIe s. Relevé 3D par orthophotogrammétrie https://skfb.ly/XFvA Crypte Saint-Maurice de Jougne, extrait de la modélisation en 3D (Th. Chenal) 7- Travail éditorial : • Publication en ligne (BUCEMA) des actes des 4eme journée d’études monastiques de septembre 2014 à Baume-les-Messieurs, Hors-série n° 10 | 2016 BULLY (S.), SAPIN (Ch.), (dir.), L’origine des sites monastiques : confrontation entre la terminologie des sources textuelles et les données archéologiques 8- Organisation des 5eme journée d’études monastiques, 1-2 septembre 2016 à Auxerre • Thème : « De la clôture à la fortification des monastères », sous la direction de S. Bully et Ch. Sapin Moutiers-Saint-Jean, prospections géophysiques (cl. Ch. Sapin)
Projet collectif de recherche Monastères en Europe occidentale (Ve–Xe siècles). Topographie et structures des premiers établissements en Franche-Comté et Bourgogne (Septième année)
Participation de Morana Čaušević-Bully (université de Franche-Comté-UMR Chrono-environnement), Thomas Chenal (UMR ARTeHIS), Adrien Sagesse (UMR ARTeHIS), Aurélia Bully (UMR ARTeHIS), Chistian Camerlynck (UMR Metis- université Pierre et Marie Curie Paris VI-Jussieu) Xavier D’aire (CEM), David Vuillermoz, Hugo Parent, Valentin Chevassu, Matthieu Le Brech, Ornella Salvi, Colas Finck, Mélanie Grenot, Maxime Bolard, Philippe Beyney.
Dates des opérations : entre avril et novembre
Financements : Ministère de la Culture-DRAC Franche-Comté,
Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Conseil départemental de Haute-Saône, Conseil départemental du Jura, Caritas veritatis foundation.


Objectifs et résultats :
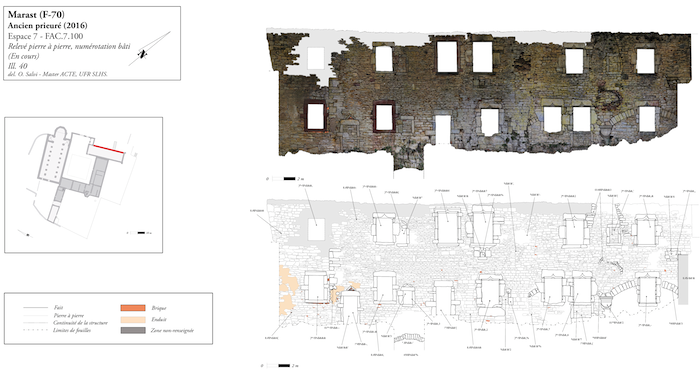


Saint-Pierre d’Osor (Croatie) : monastère / Campagne 2016

Mission archéologique du ministère des Affaires étrangères (premier volet) ; Collaboration croato-française vue générale du vestibule en cours de fouille (cl. S. Bully) Le monastère bénédictin Saint-Pierre d’Osor, sur l’île de Cres, aurait été fondé au début du XIe s. par saint Gaudentius, évêque de la cité. Engagée depuis 2006, la fouille programmée répond à plusieurs objectifs : il s’agit de comprendre les modalités de l’installation du monastère dans un contexte urbain – d’origine protohistorique et antique – et d’étudier une topographie monastique qui doit tenir compte à la fois des contraintes urbaines, mais également de constructions antérieures, déjà religieuses pour certaines. L’analyse archéologique des vestiges de l’ancienne abbatiale Saint-Pierre complète les études d’histoire de l’art afin de préciser la datation d’un édifice considéré comme insigne pour l’architecture romane dans la région et révélateur des échanges et influences avec la côte adriatique occidentale. Les méthodes employées sont celles de l’archéologie du sous-sol, du bâti et les prospections géophysiques. Vue générale à l’achèvement de la fouille 2016 (cl. M. Vuković) Vue générale à l’achèvement de la fouille 2016 (cl. M. Vuković) La campagne 2016 a porté sur le vestibule de l’église du XIe s. (Esp. V) et sur son flanc nord-ouest (Esp VI). La fouille a été riche en découvertes, avec, en particulier, la mise au jour d’un énigmatique pot « de stockage » dans le tiers nord du vestibule. On constate une évidente partition de l’espace du vestibule, marquée à la fois dans son architecture par des travées, et par la nature de son occupation (sépultures privilégiées dans son segment central, sépultures d’enfants dans le tiers sud). Pour l’espace VI, la fouille a porté essentiellement sur les nombreuses tombes médiévales présentes dans ce secteur. L’ensemble des sépultures a été fouillé et démonté – à l’exception des caveaux bordant le vestibule – et nous nous sommes arrêtés sur des niveaux de l’Antiquité tardive ou du haut Moyen Âge présentant plusieurs structures, peut-être artisanales. Deux nouvelles tombes de l’Âge du fer ont été découvertes sous des tombes maçonnées médiévales en façade du vestibule. pot déposé dans le niveau de préparation du sol de la travée nord du vestibule du (cl. S. Bully) Vue générale, depuis l’ouest, de la fouille de l’Espace VI (cl. S. Bully) ČAUŠEVIĆ-BULLY (M.), MARIĆ (I.), BULLY (S.) et JURKOVIĆ (M.) avec une contribution de DUGOREPEC (L.) et BLEČIĆ KAVUR (M.), « Le monastère Saint-Pierre d’Osor (île de Cres) : onzième campagne d’études archéologiques », Hortus artium medievalium 23, Zagreb, à paraître. BULLY (S.), JURKOVIĆ (M.), MARIĆ (I.) et ČAUŠEVIĆ-BULLY (M.), « Monastère Saint-Pierre d’Osor (Croatie, île de Cres). Bilan de la mission franco-croate 2016 », Chronique des activités archéologiques de l’École française de Rome, https://cefr.revues.org
Monastère Saint-Pierre d’Osor / Campagne 2016
Responsables : Sébastien Bully (UMR ARTeHIS), Miljenko Jurković (université de Zagreb-centre IRCLAMA), Morana Čaušević-Bully (Université Bourgogne Franche-Comté-UMR Chrono-environnement), Iva Marić (université de Zagreb-centre IRCLAMA)
Participation d’Ivan Valent, Thomas Chenal (UMR ArTeHiS), Adrien Sagesse (UMR ArTeHiS), Jelena Behaim, Brunilda Bregu, Matthieu Le Brech, Jessy Crochat, Lucija Dugorepec, Valentin Chevassu (UBFC-UMR Chrono-environnement), Ornella Salvi, Hugo Parent, Mélanie Grenot, Anaïs Deliste et Eva Žile.
En partenariat avec aIPAK/APAHJ
Dates de chantier : 30 mai au 24 juin 2014
Financements : ministère des Affaires étrangères français, ministère de la Culture croate, ministère des Sciences croate, École française de Rome, Commune de Mali Losinj, Caritas veritatis foundation.
Objectifs


Résultats


Liens
A paraître
Sermesse (71) Fouilles subaquatiques du moulin / 2016
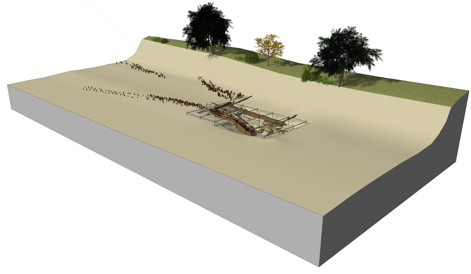
Cette opération est placée sous la responsabilité d’A. Dumont, co-financée par le SRA Bourgogne, le DRASSM, et la coopérative Bourgogne du Sud. Le DRASSM a également mis à disposition des moyens humains (temps de travail d’A. Dumont pour les phases terrain et rédaction du rapport) et logistiques (matériel de plongée, bateau). Le projet associe divers collaborateurs : P. Moyat (ETSMC et UMR ARTEHIS), M. Cayre (Evéha), D. Le Cornu (étudiant Univ. Rennes), C. Vélien (étude céramique), C. Bonnot-Diconne (Laboratoire 2CRC, traitement et étude des cuirs et matières végétales), Luc Jaccottey (Inrap, UMR 6249, étude des meules), Pierre Mille (Inrap, étude des bois), M. Treffort (bénévole, dessin), laboratoire le CREAM (traitement objets métalliques) et Laboratoire Nucleart (traitement objets bois) Figure 1. Vue restituée des vestiges du moulin sur bateaux de Sermesse, dans le Doubs, contre la rive gauche. Infographie P. Moyat. La fouille de la moitié du site de Sermesse sur trois campagnes, de 2014 à 2016, confirme la richesse de cet ensemble qui constitue un des rares vestiges archéologiques de moulin sur bateaux connu en Europe et relativement facilement accessible. Sa datation dans l’époque moderne pré-industrielle (fin XVIe ou début XVIIe siècle), et le bon état de conservation des bateaux et objets associés en font un sujet d’étude de premier ordre pour la connaissance des techniques de meunerie, de batellerie et de pêche, les trois activités étant regroupées sur une seule structure. Lame de couteau portant le prénom Marcelin découvertes sur le moulin de Sermesse (71), après restauration. Clichés M. Treffort. La troisième campagne de fouille a permis d’achever complètement le dégagement du plus petit des deux bateaux, le forain. Il restait le dernier compartiment situé entre un renfort transversal et le tableau arrière. On y a découvert une chaîne à 36 gros maillons enroulée autour du renfort. Le nettoyage du tableau arrière a permis d’observer les assemblages de bois ainsi que des réparations. La fouille a également concerné l’espace entre les deux coques, où se trouvait conservé un assemblage de bois correspondant à de probables éléments de pales de la roue (en cours de traitement). Une petite partie de l’extérieur de la coque de la corte (le plus grand bateau) a pu être dégagée, au niveau de l’avant. Elle est en assez mauvais état de conservation mais on peut voir un assemblage complexe de bois, ainsi qu’un nombre considérable d’appes de calfatage, dont certaines sont sur des réparations. Lame de couteau portant le prénom Marcelin découvertes sur le moulin de Sermesse (71), après restauration. Clichés M. Treffort. Le suivi des objets découverts sur ce site se poursuit ; plusieurs objets ont été récupérés en 2016 auprès des laboratoires. Les restaurations font ressortir des éléments qui n’étaient pas du tout visibles avant traitement. C’est le cas par exemple de deux lames de couteaux sur lesquelles on voit des noms gravés, Marcellin et Jean-Fra.(nçois). Le pichet en étain, après nettoyage, a révélé un nom, Juenon, gravé sur le fond. Il pourrait s’agir du meunier, et ce patronyme est très répandu dans la région de Verdun-sur-le-Doubs encore actuellement. Tous les outils comportent des marques d’artisans qui feront l’objet d’une étude spécifique lorsque tout le lot sera restauré.
Fouilles subaquatiques du moulin de Sermesse (71) dans le Doubs / 2016
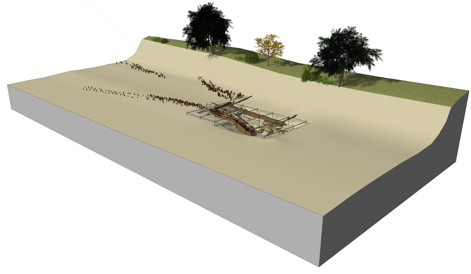
Campagne de la fouille tri-annuelle du moulin sur bateaux de Sermesse (Saône-et-Loire)

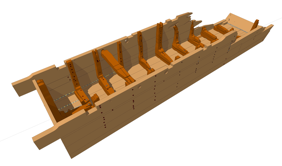
Les habitats désertés des forêts du Haut Val Suzon et leur environnement / 2011-2016

Coordination : Corinne Beck, laboratoire Calhiste /Université de Valenciennes À 25 km au nord-ouest de Dijon, entre Val-Suzon et Saint-Seine-l’Abbaye, la fouille de l’habitat médiéval déserté repéré dans les « Bois de Cestres », sur la commune de Saint-Martin du Mont, a été conduite entre 2003 et 2011 aussi exhaustivement que possible. Il s’agit d’un hameau composé de deux fermes, d’une grange et d’un four à pain, complété par un appentis, un puits et trois carrières, disposés à une distance d’au plus 350 mètres au long de deux chemins traversant le massif forestier. L’établissement, spécialisé dans l’élevage ovin, est occupé au cours du XIVe siècle. Il s’agit sans doute des Bordes Gaudot qui, dans les documents écrits, apparaissent en 1323 comme dépendantes de l’Abbaye bénédictine de Saint-Seine et qui sont déclarées désertées au début du XVe siècle. Cette création tardive est réalisée dans des marges forestières jusqu’alors inhabitées. Il représente un bel exemple de ces établissements fondés ex nihilo aux marges des finages anciens entre le XIe et le début du XIVe siècle, pendant la période dite de « l’optimum démographique » où l’on assiste aux « grands défrichements ». Installés dans des milieux peu favorables, ils sont facilement déstabilisés par la tourmente des « malheurs des temps » de la fin des années 1340 et des décennies suivantes (Grande famine, peste Noire et guerre de Cent Ans). Certains, et c’est n’est pas ici le seul cas, sont définitivement abandonnés au moment de la reconstruction des campagnes au siècle suivant. Cet établissement n’est en effet pas un cas isolé dans les massifs boisés des plateaux dominant le cours du haut Val-Suzon : sur les communes actuelles de Saint-Martin-du-Mont, Saint-Seine-l’Abbaye et Val-Suzon au Nord, Pasques et Panges au Sud, 19 sites désertés sont aujourd’hui localisés par les prospections au sol et l’analyse des données issues d’un laser aéroporté (données LiDAR acquises et fournies par l’ONF – Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon). Au total, 13 de ces sites sont aujourd’hui explorés et huit sont contemporains, issus du même processus de création remontant au XIVe siècle : aux lieux-dits Bois de Cestre et Combe d’Eté (Commune de Saint Martin du Mont), Les Epitiaux Brosse (commune de Val Suzon), Les Grands Charmeaux, La Mare des Bordes, Les Cermandets, Les IssartsBarodet, En Champ Bas, (commune de Pasques). Un autre leur est contemporain mais a une durée de vie plus longue : la grange du Haut de Neuilly, dépendante de l’abbaye de Cîteaux, est active dès le XIIe siècle et n’est détruite qu’au XVIe. Quatre des sites explorés sont antérieurs. Celui de Château Hurpot est datédes XIe/XIIe siècles (mobilier céramique et datation 14C). Les vestiges repérés et sondés en Buisson Rond révèlent une occupation de datation identique par la céramique (XIe/XIIe siècles) mais aussi plus ancienne par la datation radiocarbone d’un four (VIIe/VIIIe siècles). Enfin, deux sites sont datés de l’antiquité : Les Issarts et Lisière de Citeau. Le massif forestier où l’enquête est conduite offre donc des sites archéologiques de chronologie variée mais le cœur de la recherche (à ce jour 2/3 des installations) reste bien l’identification d’habitats créés et désertés au XIVe en lien étroit avec une production lainière que les documents écrits, systématiquement explorés, évoquent à maintes reprises. L’enquête, pour tenter de restituer le territoire en lien avec ces établissements, ne se limite pas aux documents écrits et aux vestiges monumentaux : elle est aussi très active dans quatre autres domaines : la restitution archéogéographique des articulations paysagères produites par la mise en valeur des sols et la structure de peuplement, l’analyse des composants chimiques des sols et des cortèges végétaux pour tenter d’identifier les traces des usages générés par les établissements désertés, enfin l’étude des ressources en eau. Pour les Bordes des Bois de Cestres, elle a agrégé les compétences de chercheurs de l’Inra-Champenoux (Etienne DAMBRINE, Jean-Luc DUPOUEY) et d’Artéhis (Jean-Pierre GARCIA et Marion FOUCHER) ; elle poursuit l’enquête en forêt de Pasques avec le laboratoire Biogéosciences de Dijon (Olivier MATHIEU) et deux phytosociologues : Jean-Marie ROYER (Société botanique de France) et Bernard DIDIER (Société des Sciences naturelles et d’Archéologie de Haute-Marne). L’enquête archéogéographique, un exemple : confection de la carte compilée de la voirie dans le Haut Val Suzon (HVS). Faire une « carte compilée » consiste à reporter sur un même fond de plan l’ensemble des données planimétriques que l’on peut rassembler à partir de différents documents. La carte compilée est constituée d’un fond de plan ou carte de référence de données thématiques : ici, les cheminements. L’espace géométrique de ou des cartes de référence, en l’occurrence le LIDAR et le SCAN 25, est utilisé pour redresser, recaler, l’ensemble des données fournies par d’autres documents, le plus souvent ponctuels. Le report sur un même fond de plan de données planimétriques d’échelles variables semble être la meilleure solution technique pour synthétiser l’information. Au total ce sont 1865 tronçons qui ont été relevés. Chaque tronçon vectorisé correspond à un cheminement non interrompu par un autre cheminement c’est-à-dire à un croisement. Ce choix est dû à ce que sur un même tracé, chaque tronçon constitutif de celui-ci, ont pu avoir une histoire distincte : abandon, déclassement, pérennisation, reprise. Ce choix de vectoriser tronçon par tronçon est assez long mais il permet de construire une carte compilant, dans leur diversité, l’ensemble des informations disponibles sur le thème du réseau viaire. La carte ainsi compilée constitue un graphe complet, non orienté, où les tronçons sont des arêtes (= vecteurs) et les croisements des sommets, définis comme les points d’un graphe d’où partent et où arrivent une ou plusieurs arêtes. Il est alors possible de traiter le graphe de manière mathématique pour en extraire des motifs à partir de la mise au point d’algorithmes particulier : de déterminer entre autre le degré d’un sommet, c’est-à-dire le nombre d’arêtes liées à un sommet (hypothèse d’attractivité du lieu), ou de déterminer les tracés les plus courts en lien avec le degré d’un sommet. Chaque tronçon ou « arête », a été renseigné, constituant ainsi une base de données gérée par le logiciel SIG « ArcGIS ». La base de données est structurée en « champs », qui correspondent à autant de thème. Par exemple le champ « STATUT_SCA » traite du thème de la morphologie du tracé actuel des cheminements tel que définit par la carte IGN au 1/25000e. Le thème est décliné en « Valeurs » qui correspondent à autant d’états morphologiques actuel, par exemple la valeur « G » correspond à une voirie goudronnée, « MT » à une voirie repérable seulement par la microtopographie, etc. …). Par la suite, et en fonction des questions posées ces tronçons apparaîtront seuls ou combinés à d’autres valeurs d’autres champs (3 champs au maximum). De ce point de vue chaque tronçon possède sa propre histoire qui n’est pas nécessairement celle de l’ensemble du tracé auquel il appartient. Depuis plusieurs années, une méthode de télédétection est de plus en plus utilisée en archéologie : le LiDAR (light detection and ranging), en français « altimétrie laser aéroportée ». Cette technique permet d’enregistrer les reliefs du sol au centimètre près (planimétrie), en occultant la couverture végétale. Un scanner embarqué dans un aéronef envoie des impulsions laser vers le sol et enregistre chaque écho réfléchi : ceux-ci décrivent la surface du sol, à travers branches et végétation. Un traitement informatique abouti à la création d’un Modèle Numérique de Terrain (ou MNT) sur lequel on discerne toutes les anomalies micro-topographiques permettant ainsi le repérage de vestiges archéologiques masqués par la forêt (murées, tertres, chemins, bâtiments, mines, etc.). Le contrôle au sol de ces irrégularités de terrain reste toutefois indispensable afin de vérifier leur origine anthropique et leur ancienneté. Moins efficace en terrain cultivé, le LiDAR permet cependant de repérer d’anciennes limites parcellaires ou des méthodes agricoles révolues (champs bombés en lanières). L’acquisition des données LiDAR des « Bois de Cestres » obtenue dans le cadre du CPER (projet UB UMR/MCC), date de 2006. C’est une des toutes premières expériences à vocation archéologique sur le sol français avec celle de la forêt de Haye en Lorraine. Une nouvelle acquisition de l’ONF, en 2013, dans le cadre de la réserve naturelle régionale du Val Suzon (sur un territoire bien plus étendu 128km²) a révélé de nouveaux habitats désertés. Afin d’optimiser la lecture des anomalies (naturelles ou anthropiques) issues du MNT plusieurs «indices» (représentation imagée) doivent être réalisés. Pour les vestiges archéologiques étudiés dans le cadre de notre recherche, où les constructions sont encore en élévation avec parfois des murs d’une hauteur de près de deux mètres, nous avons privilégié l’indice du « Sky View Factor » qui permet une bonne lisibilité de l’organisation interne d’un hameau. À titre d’exemple, pour visualiser les anomalies, le secteur présenté infra est localisé sur la comme de Pasques en milieu boisé. Cet habitat médiéval déserté dit des «Grands Charmeaux » a été exploré en 2014. C’est un exemple représentatif du mouvement soutenu de conquête de nouveaux espaces pastoraux sur la forêt de la Montagne dijonnaise au XIVe siècle. Les images sont au même endroit et à la même échelle. Elles offrent une lecture différente des anomalies qui sont plus ou moins perceptibles (notamment les chemins) en fonction des « indices ». L’analyse des sols et de la couverture végétale : l’exemple des Bordes des Bois de Cestres.Travaux d’Etienne DAMBRINE et de Jean-luc DUPOUEY (INRA-Champenoux) La concentration des solutions du sol en P2O5 est généralement très faible et les valeurs fortes, suggérant un apport organique et donc une activité humaine, doivent attirer l’attention. C’est ainsi qu’une carte de la distribution du phosphore a été établie pour l’ensemble de la parcelle forestière 15 comprenant l’habitat des Bordes des Bois de Cestres occupée au XIVe siècle. Elle a montré un chapelet de concentrations de phosphore soulignant bien évidemment la zone de l’habitat mais aussi le chemin qui le rattachait au réseau de peuplement dans lequel il s’inscrivait. Les valeurs sont particulièrement élevées immédiatement au nord de l’habitat, au point 11.7, où a été localisé et sondé un four à chaux daté de l’an Mil : ce signal pourrait donc tout aussi bien témoigner pour une occupation de l’an Mil ne se limitant pas un four à chaux. Quant aux plantes nitrophiles présentes sur et autour des vestiges de ces vestiges, ils simulent une clairière étroite centrée sur le principal groupe de bâtiments du XIVe siècle: nulle trace dans la couverture végétale comme dans les sols d’un ager développé. Les sols ont bien été nourris de matières organiques mais les concentrations ne dessinent pas des « champs », des emblavures : la couverture boisée n’a été ouverte que sur l’habitat et le long de l’axe de circulation. Au terme de la campagne 2016, six sites restent à explorer (voir fig.1) et l’analyse environnementale est à finaliser. Parmi les sites archéologiques, deux en forêt de Pasques (Bas de la Vigne, Combe au Fourneau) et trois dans les bois dominant au nord Val-Suzon ( Source aux Fées, Epitiaux Casquette et Epitiaux-Dessus), présentent en surface les caractéristiques des huit établissements déjà datés du bas Moyen-Âge. Les Grognots en revanche montrent en surface des reliefs très émoussés, des aménagements moins complexes et étendus : ce site pourrait être antérieur. Il est de toute façon nécessaire de tous les explorer pour parachever l’enquête : pour montrer la pleine dimension du mouvement de colonisation des massifs forestiers qui a commencé sans doute classiquement au XIIe siècle avec les granges monastiques et qui se développe toujours au XIVe siècle malgré les crises, en liaison avec le grand commerce international et spéculatif de la laine. Mais l’année 2017 marquera une pose dans ces activités archéologiques pour finaliser la publication des fouilles 2003-2012 des Bordes des Bois de Cestres (commune de Saint-Martin-du-Mont). Toutes les données archéologiques sont étudiées, prêtes ; il reste à compléter le dossier historique et il convient de prendre le temps et le recul nécessaire à son achèvement. L’enquête ne cessera pas pour autant : les analyses des sols et du couvert végétal, bien lancées en 2016, ne doivent pas être arrêtées et les activités de terrain leur seront entièrement consacrées en 2017. Il est ainsi prévu en forêt de Pasques d’évaluer non seulement la distribution spatiale du phosphore mais aussi de l’azote et du carbone, dans le but de qualifier les alentours des sites et d’en préciser leur fonction. Cette caractérisation chimique s’accompagnera de celle des cortèges végétaux visant à évaluer l’ancienneté de ces formations et en particulier celle des clairières intra forestières qui ne sont pas nécessairement « naturelles ». Ces études seront appuyées sur les informations issues des archives, notamment sur les plans de gestion et les descriptions des usages, dont la vaine pâture. Pour achever l’enquête et en préparer la publication, les derniers sites archéologiques devraient être sondés en 2018 et 2019. 2007.1 – J.L. MAIGROT et alii, « Le projet Saint Martin. La mémoire du sol : restitution d’un paysage ancien par mesure de l’impact de l’occupation et de pratiques agraires anciennes sur le fonctionnement actuel du milieu biophysique » La mémoire des forêts, Actes du colloque Forêt, Archéologie et Environnement, INRA-Nancy, 14-16 décembre 2004, Nancy, 2007, p. 245-253. 2007.2 – J.L. MAIGROT et alii, « La mémoire du sol. Les Bordes désertées du Bois de Cestres et leur finage (commune de Saint Martin du Mont – Côte d’or) », Forum Medieval Europe, session d’Archéogéographie, 6-7 septembre 2007, Paris, publication en ligne, 11 pages. 2008.1 – F.FAUCHER, « Premiers résultats de l’exploitation du LIDAR réalisée dans le cadre de l’opération archéologique du hameau médiéval déserté des « Bois de Cestres » en Côte d’Or », La technique du LIDAR au service de l’Archéologie, échanges sur les pratiques et les expériences, Strasbourg, 6 février 2008, table ronde du Réseau Information Spatiale et Archéologie (ISA) 2008.2 – P.CURMI et alii., « Nitrogen isotopic studies (delta 15N) reveal past agricultural activities in soils from a 14th century archaeological site », Eurosoil 2008, Journée d’Etude organisée par Winfried H. Blum, Martin H. Gerzabek & Manfred Vodrazka, University of Natural Resources and Applied Sciences (BOKU), Vienna, Austria), 4 août 2008. 2009 – P.BECK, F.FAUCHER, J.L.MAIGROT, L’habitat médiéval des Bois de Cestres à Saint-Martin du Mont (Côte d’Or), Service Régional de l’Archéologie (Archéologie en Bourgogne n° 15), Dijon, 2009, 16 pages 2013. 1 – P.BECK, P.CHOPELAIN, F.FAUCHER, J-P. GARCIA, M.FOUCHER & J.L. MAIGROT, Les habitats médiévaux désertés des plateaux du haut Val Suzon (Côte d’Or), Archéologie en Bourgogne n° 31, publication de la DRAC Bourgogne – Service régional de l’Archéologie, Dijon, 2013, 24 pages 2013.2 – P.BECK, M.FOUCHER, J.P.GARCIA, « Construire dans les campagnes bourguignonnes au XIVe siècle : approche géo-archéologique des savoirs et savoir-faire des maçons dans la seigneurie de l’abbaye de Saint-Seine », (IIIe Colloque international d’histoire de la Construction : Architecture et techniques constructives, 18 et 19 octobre 2012 – Universidade do Minho, Braga – Portugal), Braga, 2013, p.153-178. 2013. 3 – P.BECK, F.FAUCHER. JL.MAIGROT, « Défrichements et lisières mobiles en pays de Saint-Seine (Bourgogne – XIIe-XXe siècles), Colloque de l’Association d’Histoire des Sociétés Rurales et partenariat avec l’Université de Valenciennes et du Conseil Général du Nord – Liessies – 22/23 sept. 2011, Etudes réunies par C.Beck, F.Guizard, B.Bodinier, Revue du Nord, Hors-série. Collection Art et Archéologie n° 18, 2013, p.15-24. 2014 – F.FAUCHER et alii, « Recherches sur les habitats médiévaux désertés aux portes de Dijon, haut Val-Suzon, Côte d’Or », poster présenté aux Rencontres internationales du TRAIL 2014, Formation et recherche pour l’interprétation archéologique des données Lidar, Frasnes, 24-28 mars 2014. 2015 – C.BECK, P.BECK, E.DAMBRINE, J.L.DUPOUEY, F.FAUCHER, JL.MAIGROT. « Analyse des sols et restitution des paysages autour des habitats désertés médiévaux du haut Val Suzon (Côte d’Or) », Sols en mouvement – Actes des 14e Rencontres Internationales de Liessies – 24-25 sept 2014, (C.Beck, F.Guizard, J.Heude dir.), Revue du Nord, Hors série (collection Art et Archéologie) n° 23, 2015, p. 95-103. Les deux monographies publiées dans la collection « Archéologie en Bourgogne » (2009 et 2013.1), sont téléchargeables à partir du site de la DRAC Bourgogne Franche-Comté : ou sur hal.archives-ouvertes.fr : 2009 <halshs-01374353> ; 2013. <hal-01416150> A paraître BECK, F.FAUCHER, J.L.MAIGROT (dir.), Un habitat médiéval et son territoire. Les Bordes des Bois de Cestres – Saint-Martin du Mont (Côte d’Or)
Responsable de la recherche archéologique : Patrice Beck, laboratoire Irhis /Université de Lille 3
Collaboration du laboratoire ARTEHIS : Frank Faucher, coordonnateur pour les prospections, la géomatique, Lidar, DAO, Jean Louis Maigrot, coordonnateur pour l’archéogéographie et les sciences du sol, JP Garcia et M. Foucher en 2011-2013 pour l’expertise géo-pédologique, S. Mouton en 2016 pour la céramique antique
Autres collaborations : Inra-Champenoux (Etienne DAMBRINE, Jean-Luc DUPOUEY) ; laboratoire Biogéosciences de Dijon (Olivier MATHIEU) ; Société botanique de France (Jean-Marie ROYER ) et Société des Sciences naturelles et d’Archéologie de Haute-Marne (Bernard DIDIER)
Dès l’origine du projet, en 2003 avec la fouille du site déserté des « Bois de Cestres » sur la commune de Saint-Martin-du-Mont, une part conséquente de la recherche est consacrée à comprendre la structuration, l’organisation et le fonctionnement du territoire lié à cet établissement médiéval. Cette même démarche se poursuit dans le cadre de l’enquête actuelle qui, depuis 2012-2013, est élargie à l’ensemble des territoires de la haute vallée du Suzon dans les forêts desquels 18 autres sites désertés ont été localisés. Cette recherche, volontairement pluridisciplinaire, associe les compétences d’historiens et d’archéologues, de géomaticiens et de géographes, de géologues, de pédologues et de phytosociologues, à l’échelle non seulement des sites archéologiques mais aussi des finages dans lesquels ils s’insèrent.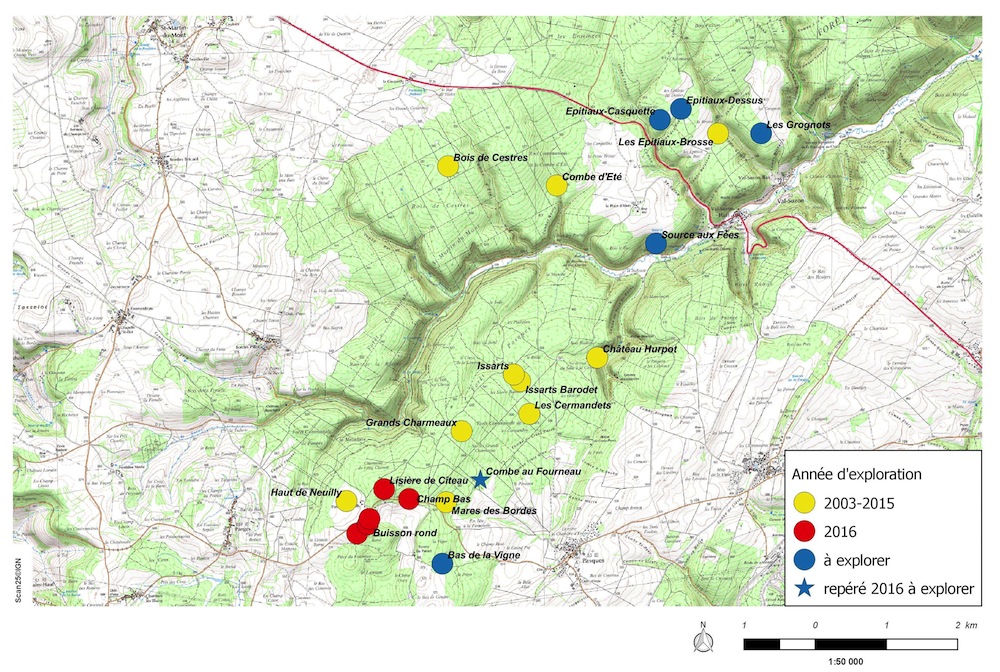
Des bois de Cestres…

… Aux forêts du haut Val Suzon.
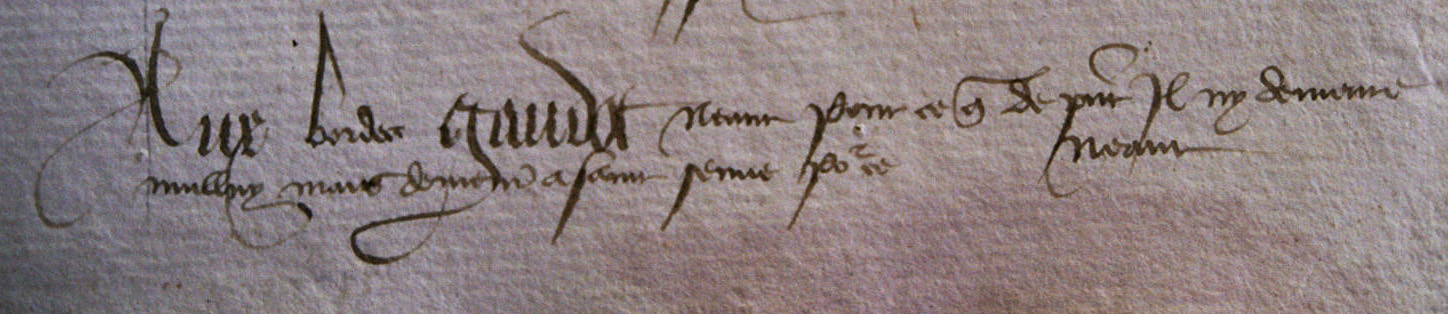
Une enquête pluridisciplinaire…
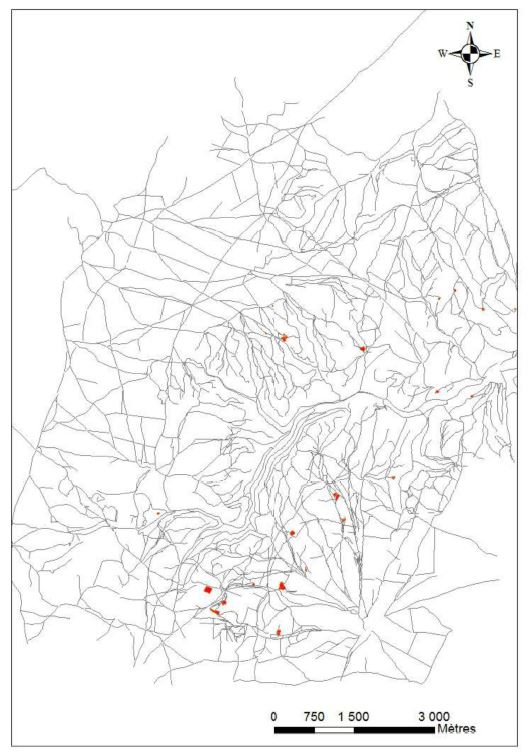
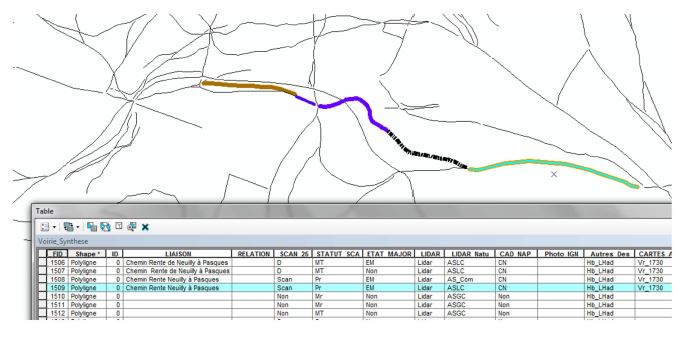
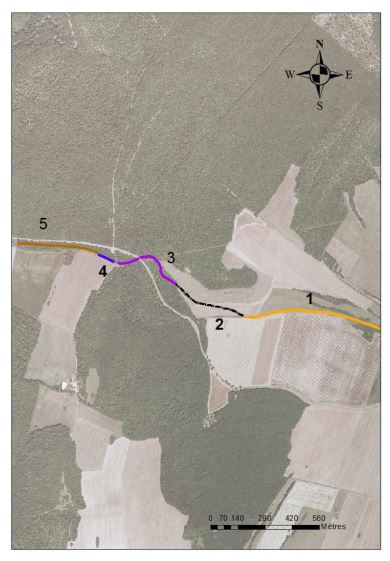
Le Lidar… un exemple : Le site médiéval des Grands Charmeaux (exploré en 2014)

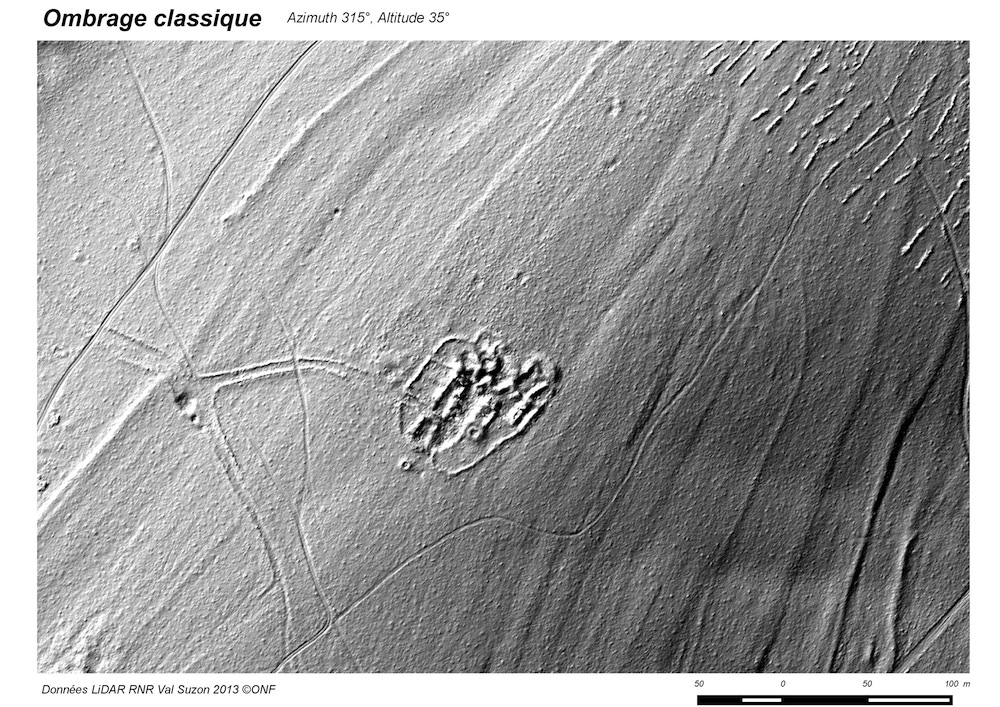
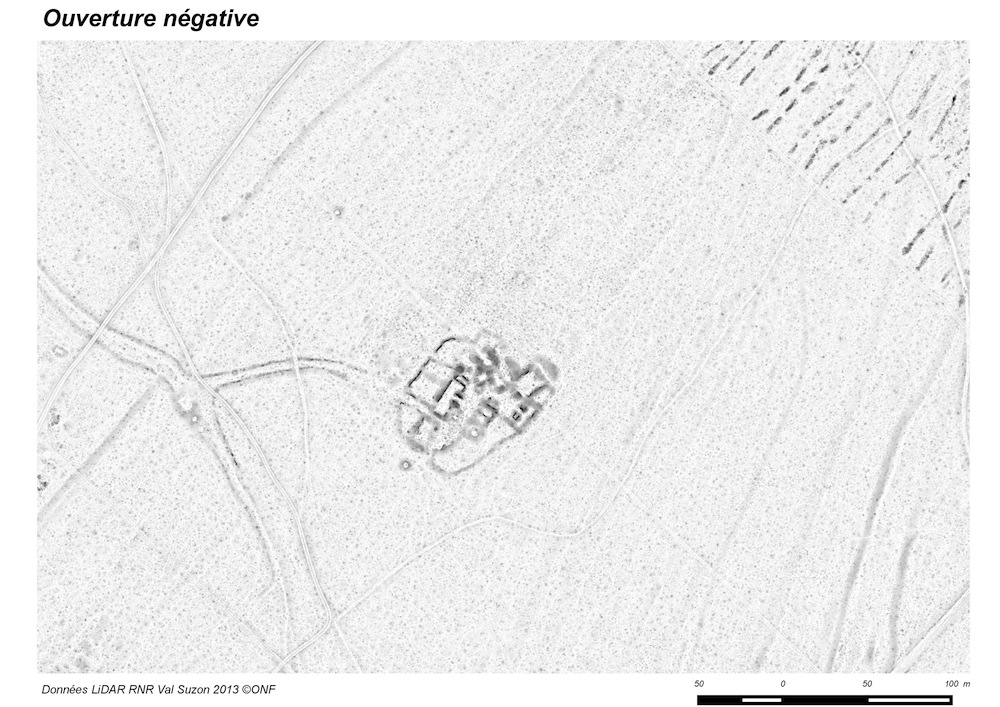
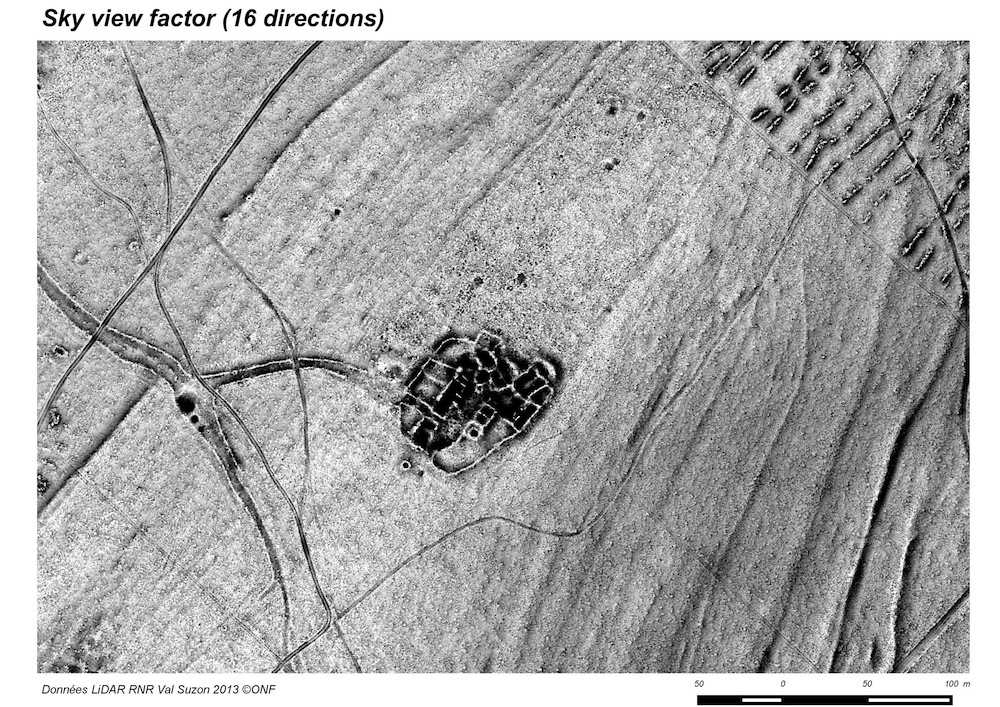
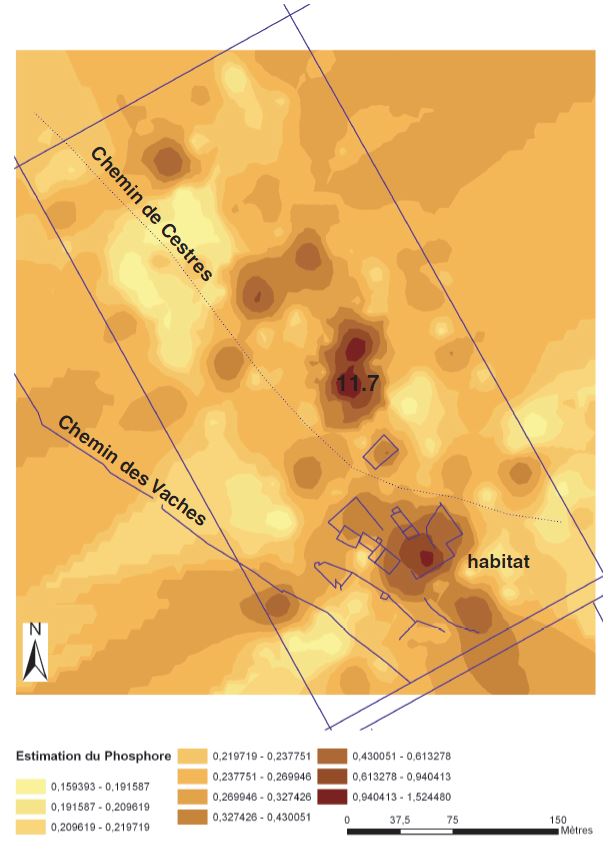
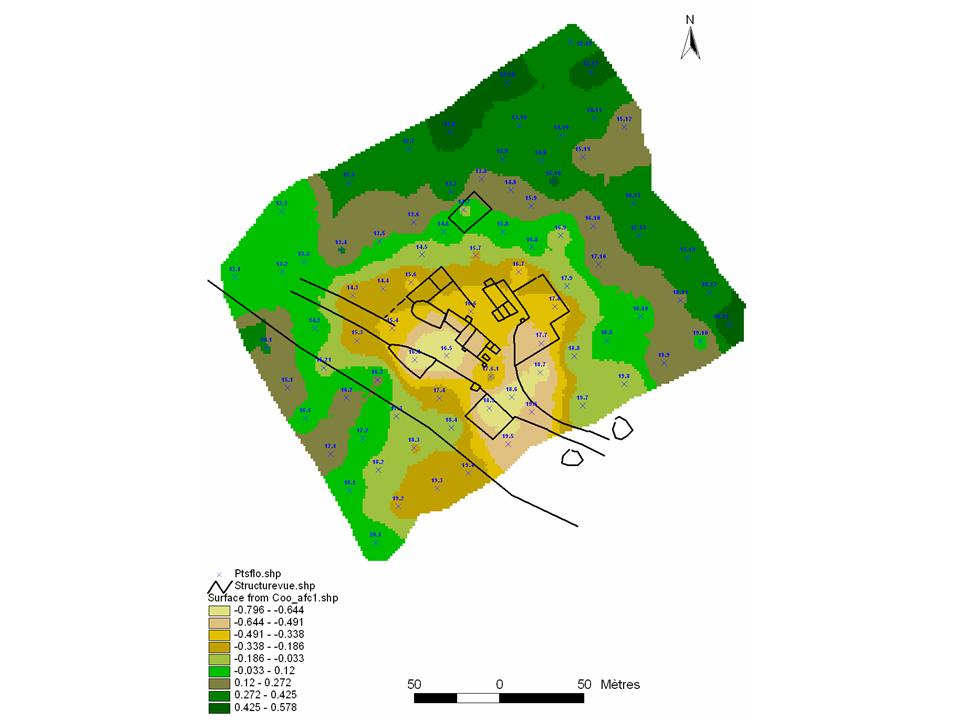
Poursuite de l’enquête :
Bibliographie de l’enquête 2003 – 2016
Kvarner (Croatie) : monastères et sites ecclésiaux insulaires / campagne 2015

Responsables : Morana Čaušević-Bully (université de Bourgogne Franche-Comté-UMR Chrono-environnement), Sébastien Bully (UMR ARTEHIS)Retour ligne automatique Mission archéologique du ministère des Affaires étrangères (second volet) Dates de chantier : du 29 juin au 18 juillet, du 19 au 30 octobre. Participation : Ivan Valent, Thomas Chenal (UMR ArTeHiS), Adrien Saggese (UMR ArTeHiS), Jessy Crochat, Lucija Dugorepec, et les contributions de Pascale Chevalier (UMR ArTeHiS), Inès Pactat, Mia Rizner et Miro Vuković En partenariat avec aIPAK/APAHJ Financements : ministère des Affaires étrangères français, ministère de la Culture croate, École française de Rome, Commune d’Omišalj, Commune de Mali Losinj, Région de Primosko-Goranska, Caritas veritatis foundation Le programme de prospection-inventaire des sites ecclésiaux insulaires engagé en 2010 est structuré autour de trois axes majeurs : Le programme de prospection-inventaire initié en 2010 est entré dans une nouvelle phase en 2015 avec le démarrage de la fouille programmée de la grande église paléochrétienne du complexe de Martinšćica (île de Cres). Dans le même temps, la poursuite des prospections a été à l’origine de la découverte d’une nouvelle église (paléochrétienne ou haut-médiévale) sur l’îlot désert de Mali Ćutin. Le troisième volet du programme a porté sur le site de Mirine-Fulfinum (île de Krk) avec la préparation du chantier de fouille dans le secteur dit de « l’église à trois absides », édifice daté des IXe-XIe s., construit sur un complexe antique suburbain (villa ?). Lien
Les monastères et sites ecclésiaux insulaires dans l’archipel du Kvarner (Croatie) / Campagne 2015


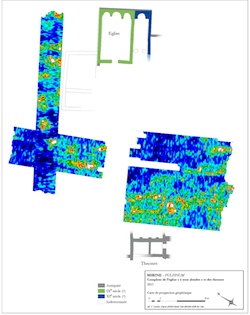
Les sites



Objectifs et résultats
Les principaux résultats des recherches menées à travers les programmes « Monastères et sites ecclésiaux insulaires » et « Monastère Saint-Pierre d’Osor » ont été présentés lors de l’exposition « Aquileia-Salona-Apollonia. Un itinéraire adriatique du IIe s. av. J.C. au début du Moyen Âge », qui s’est tenue aux musées de Mali Lošinj et de Zagreb durant l’année 2015.
Du 15 au 21 juin, un atelier doctoral sur le thème « Les sources pour l’histoire de l’Adriatique orientale (IVe-XVe siècle). Textes, archives et archéologie » a été organisé en collaboration avec l’Ecole française de Rome. La rencontre, en partie financée par la commune d’Omišalj, s’est déroulée dans le vestibule de l’église paléochrétienne de Mirine.
L’ensemble des résultats des différentes opérations est publié en ligne dans le cadre des chroniques archéologiques de l’Ecole française de Rome.
ČAUŠEVIĆ-BULLY (M.), BULLY (S.), Kvarner (Croatie). Prospection-inventaire des sites ecclésiaux et monastiques : campagne 2015, Chronique des activités archéologiques de l’École française de Rome, https://cefr.revues.org/1578


Saint-Mont (88) : fouilles archéologiques, relevés topographiques / campagne 2015

Projet collectif de recherche Monastères en Europe occidentale (Ve–Xe siècles Topographie et structures des premiers établissements en Franche-Comté et Bourgogne) Responsable : Thomas Chenal (UMR ARTEHIS – Chercheur associé),Retour ligne automatique En partenariat avec EA HISCANT-MA – Université de Nancy 2, UMR SISYPHE – Université Pierre et Marie Curie Paris VI-Jussieu,MSH Dijon-USR CNRS-UB 3516, MSHE Ledoux Besançon -USR 3124, APAHJ, FLA, TerraeGenesys. Photo de l’équipe de nettoyage au travail Le Saint-Mont (commune de Saint-Amé, Vosges) est réputé pour être l’emplacement du premier monastère d’Austrasie, fondé au début du VIIe s. par saint Amé, moine de Saint-Maurice d’Agaune puis de Luxeuil, et par saint Romaric, leude austrasien. Le site du Monasterium Habendum a fait l’objet de plusieurs campagnes de fouilles entre 1964 et 1991 par Michel Rouillon puis par Charles Kraemer. Les recherches ont permis la découverte de nombreuses structures et de mobilier s’inscrivant pour l’essentiel dans une large fourchette chronologique comprise entre l’Antiquité tardive et l’époque moderne. Les vestiges s’étagent entre le sommet du mont et deux terrasses sur son flanc sud, soit une surface estimée actuellement à 3 hectares. En tenant compte des résultats anciens, nous avons engagé une nouvelle série de relevés topographiques et de prospections géophysiques ; une révision de fouille a été menée sur des vestiges anciennement dégagés afin de mieux comprendre l’évolution topographique d’un site monastique qui s’implanterait, d’après le récit hagiographique des fondateurs, sur une probable villa mérovingienne, puis sur un castrum tardo-antique.La reprise desfouilles archéologiques est l’occasion de mieux comprendre l’espace funéraire du Monasterium Habendum mais aussi d’étudier un lot unique de tombes en formae. Pour cette nouvelle campagne, nous avons : 1- Fouillé 60% de la nef de la basilique funéraire du haut Moyen Âge recouverte par la chapelle médiévale Sainte-Claire. À cette occasion, plus de 60 formae, rares structures funéraires datées généralement du haut Moyen Âge, y ont été découvertes, faisant de ce corpus le plus important d’Europe. Le plan et le phasage de cet espace funéraire nous permettent pour l’heure de restituer un bâtiment funéraire vaste de 22 mètres de long pour 8 de large, la façade du bâtiment venant d’être découverte. 2- Diagnostiqué une fosse de vidange secondaire correspondant au dépôt d’un ossuaire servant au curage des formae au fil des réinhumations dans la basilique funéraire. D’accès difficile, puisque déversé dans les pentes abruptes du Saint-Mont, en limite de plateforme, l’étude de cet ossuaire a permis le comptage de 99 individus, dont le recrutement se compose d’hommes et de femmes, et d’un nombre non négligeable de juvéniles. 3- Traité la prospection radar qui avait été menée sur des plateformes vierges de découvertes archéologiques. Ces prospections ont porté sur des plateformes construites au XVIIIème siècle en détruisant des mamelons granitiques sur lesquels reposaient des chapelles médiévales. Nous avons détecté deux probables éminences rocheuses en prenant appui sur le contraste entre le socle naturel, et le remblai anthropique. 4- Étendu le relevé topographique général du site aux chemins d’accès du site, aux remparts non datés défendant le sommet, ainsi qu’aux pentes que nous n’avions pas encore traitées au moyen d’un tachéomètre, et de GPS différentiels. Des structures périphériques au monastère ont ainsi été découvertes, à l’image d’une carrière de granit moderne, mais surtout de nouveaux tronçons de remparts non caractérisés. 5- Mené une campagne de numérisation 3D des vestiges découverts à l’aide de photogrammétrie terrestre. Ces relevés ont permis de modéliser l’ensemble des structures connues de l’aire funéraire en trois dimensions, complétant les relevés au pierre à pierre et topographiques afin de participer à une meilleure compréhension spatiale de la zone. 6- Repris l’atelier d’inventaire du mobilier archéologique découvert à partir des années 60 et jusqu’en 1992. Cette activité a permis la publication de deux articles traitant d’un lot précieux de verre mérovingien, mais aussi d’un lot majeur de pots de pierre ollaire en talcschiste et chloritoschiste alpin. La campagne 2016 complétera la fouille de la nef, mettant à jour la totalité des formae conservées. L’extension de la fouille aux abords du bâtiment permettra de comprendre définitivement son emprise et participera à la bonne connaissance de son évolution, de l’implantation des formae dans un bâtiment inconnu à l’édification de la basilique identifiée en 2014. Une campagne de topographie sera une nouvelle fois menée sur le massif afin de compléter les données déjà acquises. La poursuite de l’atelier universitaire d’inventaire du mobilier ancien se concentrera sur le mobilier céramique, des plateformes les moins étudiées notamment. Orthophoto et proposition de restitution (T. Chenal) Plan pierre à pierre de l’espace funéraire du Saint-Mont (T. Chenal, d’après Ch. Kraemer et T. Chenal)Le site du Saint-Mont : Fouilles archéologiques, relevés topographiques / année 2015
Dates de l’opération de fouille : septembre et octobre 2015
Financements : DRAC Lorraine, Projet collectif de recherche Monastères en Europe occidentale, commune de Saint-Amé, Communauté de communes Terre de Granit, Ville et Office de Tourisme de Remiremont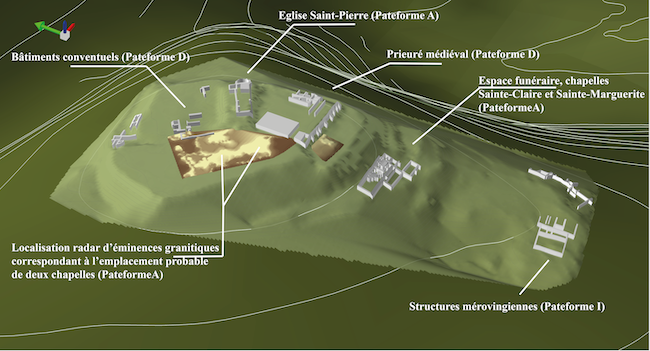

Le site :
Objectifs et résultats :
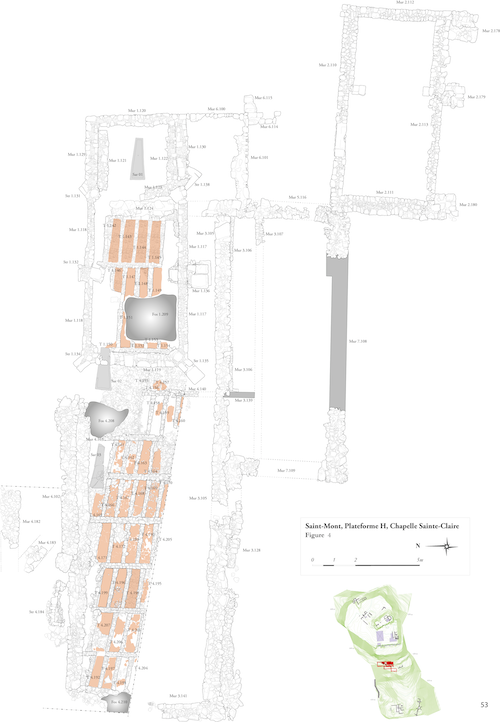

Prospections à Papaïchton (Guyane) / 2015

Dates : du 14 au 16 octobre 2015 Participation de : Michelle Hamblin La convention cadre archéologie entre la Direction des affaires culturelles et le Parc amazonien ont permis la mise en place d’une mission de prospection qui s’est déroulée à Papaïchton du 14 au 16 octobre 2015. L’opération est motivée par un projet de mise en valeur et d’extension du sentier La Source, créé par le Parc amazonien de Guyane. Elle permettra de compléter les informations de la carte archéologique nationale et donc d’enrichir la contribution du service de l’archéologie dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme de Papaïchton. Source : http://www.parc-amazonien-guyane.fr/actions/archeologie-et-randonnee-a-papaichton/
Convention cadre archéologie entre la Direction des affaires culturelles et le Parc amazonien
Prospecter le site de la montagne couronnée présent à proximité du bourg : tel était l’objectif afin d’évaluer son potentiel archéologique. Une prospection pédestre extensive de la zone concernée par le projet d’extension a donc été réalisée : exploration du terrain en parallèle, vérification systématique des chablis, dont la formation peut entamer des niveaux d’occupation anciens, observation des amas rocheux à la recherche de gravures, etc.
Sur le site fossoyé, la priorité a été accordée au relevé du tracé et à la description morphologique du fossé, complétés par une prospection sommaire de l’intérieur et des abords immédiats. La mission s’est révélée fructueuse avec de nombreux mobiliers archéologiques retrouvés et l’ensemble du fossé (600 mètres de circonférence) et d’une partie de l’intérieur de la zone parcourue.
Les deux archéologues ont ensuite profité de leur venue pour faire une intervention au collège sur le métier d’archéologue et leurs méthodes de travail. Les élèves ont découvert un métier et les jeunes reporters du collège ont profité de l’occasion pour interviewer les professionnels et mettre en pratique les pratiques photos et vidéos.
Prospections et sondages dans les chenaux de la Loire en Bourgogne et Région Centre / campagne 2015
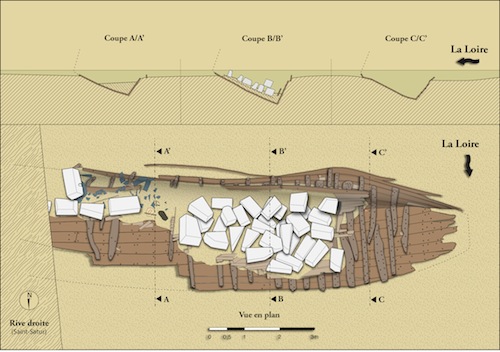
Responsable : Annie Dumont (Ministère de la Culture-DRASSM et UMR 629) L’année 2015 a été plus propice que les deux précédentes aux recherches dans les chenaux actifs et nous avons repris le programme où nous l’avions laissé fin 2012, en réalisant trois actions de terrain, le niveau étant descendu pratiquement aussi bas qu’en 2003, année de la canicule : prélèvements d’une meule à Bannay, de bois à La Charité et sondage sur l’épave de Saint-Satur. A La Charité-sur-Loire, deux groupes de vestiges avaient été topographiés et en partie datés en 2010/2011. Ils correspondent très probablement à des piles ayant supporté des moulins pendant. Le premier groupe (ensembles 2, 3, 4 et 5) est constitué de deux fondations de piles très érodées (3 et 4), d’une digue destinée à concentrer le flux sur ces piles (2), et d’un aménagement de berge permettant l’accostage d’un bateau (5), le tout étant entouré de nombreux blocs. Des analyses radiocarbone placent cet ensemble entre le milieu du XIe et la fin du XIIIe siècle. L’analyse dendrochronologique de deux pieux prélevés sur le massif n° 3 permet de préciser cette fourchette chronologique et d’affirmer que cet aménagement a été mis en place et a fonctionné dans la première moitié du XIIIe siècle. En 2015, des prélèvements ont été effectués sur le massif n° 4, afin de vérifier sa contemporanéité avec le premier ensemble ; cependant, le nombre réduit de cernes n’a pas permis une datation dendrochronologique. L’épave de Saint-Satur (dép. Cher) a été signalée en 2011 et datée par 14C dans la fourchette 1319 – 1435 ap. J.-C. Un sondage a pu être réalisé en août 2015 afin d’en faire l’expertise. Une de ses extrémités se trouve enfouie sous la berge côté rive droite, l’autre est cassée, ce qui ne permet pas de connaître sa longueur totale initiale, ni, en l’absence d’étude architecturale complète, de savoir de quel côté se trouve la proue et la poupe. Elle ne repose pas à plat sur le sable, mais présente un fort pendage, avec une inclinaison le sud (amont), ce qui a provoqué la disparition du flanc situé en aval, seuls la sole (le fond) et le flanc amont étant partiellement conservés.
Participants : Philippe Moyat (ETSMC et UMR 6298) : responsable hyperbare, prospections et sondages subaquatiques, photographies, relevés de terrain, sondages, traitement de données en DAO ; Marion Foucher (post-doctorante, UMR 6298) : sondage sur l’épave de Saint-Satur, étude des ardoises et des archives ; Murielle Bonnet, bénévole : sondage sur l’épave de Saint-Satur ; Luc Jaccottey (Inrap et UMR6249) : étude des meules de Bannay ; Catherine Lavier (UMR8220, UPMC, LAMS) : analyse dendrochronologique des bois prélevés ; Céline Bonnot-Diconne (2CRC) : traitement et étude des cuirs et matières végétales ; Gérard Mazzochi (association La tête dans la rivière) : prise d’images au cours du sondage de l’épave de Saint-Satur.
Financements : Ministère de la Culture (SRA Centre et Bourgogne, DRASSM)
Date de réalisation sur le terrain : du 3 au 22 août 2015
La cargaison de meules de Bannay comprend dix-sept meules disposées sur le sable, dans le chenal de la Loire (voir fiche de site dans Campagne 2013). Découvertes en 2012, elles avaient fait l’objet d’un relevé et d’un sondage qui a permis de vérifier l’absence de bateau sous les meules. Afin de déterminer précisément de quelle carrière proviennent ces meules perdues dans le chenal de la Loire, un prélèvement pour analyse pétrographique était nécessaire. L’étude de l’ensemble de cette cargaison serait souhaitable (L. Jaccottey) afin d’en déterminer la chaine opératoire employée pour les extraire et les façonner, ainsi que la typologie de ces outils. Cependant, au cours de ces trois dernières années, la Loire a presque totalement ré-enfouis ces meules sous le sable ; en août 2015, seule une toute petite portion de la meule n° 4 émergeait du sable, et nous avons dû la dégager avant de la prélever. Les difficultés rencontrées pour sortir une seule meule nous ont confortés dans l’idée que le prélèvement de l’ensemble, s’il était décidé un jour pour une étude complète et une présentation au public, devra se faire avec des moyens humains et matériels conséquents. L’étude est en cours.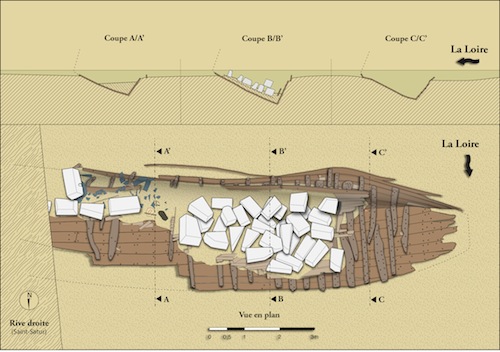
Nous avons pu la dessiner sur une longueur de 11,50 m, et sa largeur préservée est de 3,40 m. Tous les bois visibles sont a priori en chêne. Il s’agit d’un bateau assemblé à fond plat, la sole étant constituée de planches parfois assez larges (40 cm). Au moins neuf sont visibles, cependant, leur nombre est sans doute supérieur car il est probable que certaines d’entre elles ne couvrent pas la longueur totale de l’embarcation et que des assemblages existent sous les blocs de pierre qui constituent la cargaison se trouvant encore en place. Une trentaine de renforts transversaux sont visibles, et sont constitués de courbes alternant avec des membrures plates. Plusieurs renforts localisés près de la berge, sous les blocs, sont manifestement cassés. On note que ces renforts sont nombreux et rapprochés, attestant que ce bateau a dès l’origine été conçu pour transporter une cargaison pondéreuse.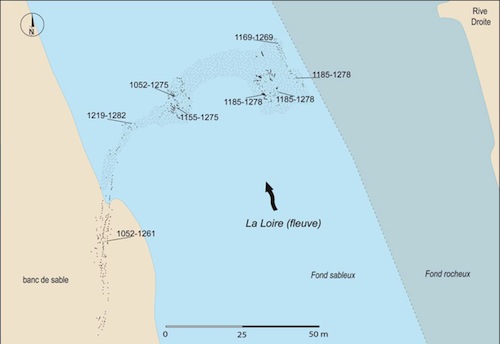
Le bateau de Saint-Satur possède les caractéristiques des embarcations traditionnellement rencontrées sur la Loire aux époques médiévales et modernes : bateau à fond plat, aux flancs assemblés à clin. Sa fouille complète permettra de vérifier s’il existe une emplanture de mât, et peut-être, si l’extrémité localisé près de la berge est conservé, un dispositif de gouvernail. Cette épave remontait le courant, comme en témoignent les ardoises qui constituent l’autre partie de la cargaison, et qui proviennent des gisements localisés près d’Angers.
Avec la fouille et l’étude complète de ce qui subsiste de l’épave de Saint-Satur, on disposera d’un cas concret d’épave remontant le courant de la Loire, chargée de pierres et d’ardoises, probablement à la charnière des XVe/XVIe siècles (d’après une première analyse dendrochronologique – C. Lavier). Les études en cours et à venir sur les pierres (analyse pétrographique pour détermination précise de l’origine), les ardoises, les chaussures en cuir également découvertes dans l’embarcation, le calfatage, et l’analyse architecturale complète de la coque permettront d’en proposer une restitution virtuelle. Il manquera néanmoins des informations en raison de l’absence d’au moins une des deux extrémités et d’un des deux flancs, et à cause de l’état des bois conservés. Cependant, il s’agit, dans l’état actuel des recherches, et pour tout le cours de la Loire, de l’épave antérieure au XVIIIe siècle, la mieux conservée. La poursuite de la recherche de comparaisons et de sources bibliographes est prévue au cours de l’année 2016.
Ancienne église Saint-Martin de Luxeuil : fouilles programmées et étude d’archéologie du bâti / été et hiver 2015

Responsable : Sébastien Bully (UMR ARTEHIS) Participation de : Morana Čaušević-Bully (université de Franche-Comté-UMR Chrono-environnement), Thomas Chenal (UMR ARTEHIS), Adrien Sagesse (UMR ARTEHIS), Aurélia Bully (UMR ARTEHIS), Amélie Berger, Jessy Crochat, Matthieu Le Brech, Ivan Valent, Lucija Dugorepec, Martine Aubry-Voirin, Alicia Mougin. Dates de chantier : 3 août au 4 septembre, 9 novembre au 8 janvier. Financements : Ministère de la Culture – DRAC Franche-Comté
Conseil régional de Franche-Comté, Conseil départemental de Haute-Saône,
Ville de Luxeuil-les-Bains, Caritas veritatis foundation,
Fondation Gilles et Monique Cugnier Projet collectif de recherche Monastères en Europe occidentale (Ve –Xe siècles). Topographie et structures des premiers établissements en Franche-Comté et Bourgogne. La reprise des recherches sur l’ancienne basilique funéraire paléochrétienne Saint-Martin, devenue monastique à l’époque mérovingienne, est concomitante du projet de valorisation du site par l’aménagement d’un centre d’interprétation des vestiges archéologiques découverts entre 2008 et 2010. Les résultats obtenus cette dernière campagne confirment la richesse exceptionnelle du site et viennent en compléments de l’abondante documentation issue des précédentes campagnes de fouilles tout en précisant, en complétant ou, parfois, en nuançant certains points. Pour l’essentiel on retiendra :

Le site :
BULLY (S.), BULLY (A.) et ČAUŠEVIĆ-BULLY (M.) avec la coll. de FIOCCHI (L.), « Les origines du monastère de Luxeuil (Haute-Saône) d’après les récentes recherches archéologiques », L’empreinte chrétienne en Gaule (de la fin du IVe au début du VIIIe siècle), Collection « Culture et Société médiévales », Turhout, 2014, p. 311-355.


Objectifs et résultats :
– la découverte du bas-côté nord de l’église paléochrétienne, dans l’immeuble bordant la place au nord, et de nombreuses tombes associées (sarcophages et coffre en tuiles) ;
– l’engagement d’un réexamen du plan de l’annexe latérale sud de l’église, installée dans un enclos funéraire ou un mausolée primitif de l’Antiquité tardive dont le plan s’avère plus étendu en direction du sud ;
– des compléments apportés à notre connaissance de la crypte de saint Valbert des années 600 (traces de sarcophage en situation privilégiée, vestiges d’un décor de stucs) ;
– l’accroissement du nombre et de la variété des sarcophages ;
– la mise au jour du bâti d’un habitat de la fin du Moyen Âge (hôtel particulier ?) dans l’immeuble moderne bordant la place au nord (immeuble Tallon intégré dans le futur centre d’interprétation).


Projet collectif de recherche Monastères en Europe occidentale (Ve–Xe siècles) / 2015

Coordination : Sébastien Bully et Christian Sapin (UMR ARTEHIS) en partenariat avec l’UMR Chrono-environnement, l’UMR METIS – université Pierre et Marie Curie Paris VI-Jussieu, le Centre d’études médiévales d’Auxerre, l’APAHJ (Saint-Claude) Participation de : Morana Čaušević-Bully (université de Franche-Comté-UMR Chrono-environnement), Thomas Chenal (UMR ARTEHIS), Adrien Sagesse (UMR ARTEHIS), Aurélia Bully (UMR ARTEHIS), Xavier D’aire (CEM), David Vuillermoz, Hugo Parent, Valentin Chevassu, Matthieu Le Brech, Ornella Salvi, Colas Finck. Nous avons poursuivi en 2015 les recherches sur l’abbaye de Gigny (Jura) à travers la seconde phase de l’étude archéologique des élévations de la façade de l’abbatiale. L’objectif était de définir un phasage de cet édifice majeur de l’architecture de l’an mil dans la région et de documenter les vestiges inscrits dans la façade d’un massif occidental repéré par radar-sol. Sur la base des observations réalisées sur la façade, l’abbatiale de Gigny aurait été dotée d’une avant-nef homogène en volume, sans décrochements de toitures de bas-côtés, relançant la discussion sur les hypothèses de restitution de celle de Cluny II. C’est encore les méthodes de l’archéologie du bâti qui sont sollicitées sur l’abbaye de Baume-les-Messieurs où, après le carré claustral, c’est l’ensemble des bâtiments conventuels qui est étudié depuis deux ans. Il s’agit, cette année encore, de préciser le phasage des bâtiments monastiques, et plus particulièrement de l’aile sud du cloître (questions du réfectoire et des cuisines). En complément de l’analyse des élévations, des sondages limités en surface ont été ouverts dans les cours de l’aile de ouest. Les résultats, décevants, ont permis cependant d’engager une réflexion sur les conditions de l’installation du monastère dans un site où la topographie physique est extrêmement contrainte. Pour la première année nous sommes intervenus sur le prieuré de Marast en Haute-Saône en soutien à un travail de master hébergé par le Pcr. Ce monastère d’Augustins fondé au XIIe s. est à la limite de notre programme, mais c’est un des rares établissements comtois dont on pourrait encore percevoir une organisation claustrale romane, à l’instar de Baume et de Gigny. Dans l’attente d’un investissement plus lourd en archéologie du bâti, les premiers relevés topographiques confirment le potentiel d’un site qui semble offrir une déclinaison plus tardive d’une topographie associant cloître et chapelle funéraire greffée sur la salle du chapitre. Parmi les publications scientifiques, on notera en 2015 l’édition en ligne et papier dans le BUCEMA des Actes des 4eme Journées d’études monastiques qui s’était tenues à Vézelay en 2013. À Luxeuil, nous avons organisé un colloque international au mois de septembre 2015 sur le thème de Moines et monastères du haut Moyen Âge en Europe. À cette occasion, nous avons réalisé avec Annick Richard (SRA Franche-Comté) une publication de la série « Archéologie en Franche-Comté » sur les recherches menées depuis plusieurs années autour du monachisme luxovien.
Topographie et structures des premiers établissements en Franche-Comté et Bourgogne (sixième année)
Dates des opérations : entre avril et novembre
Financements : Ministère de la Culture – DRAC Franche-Comté
Conseil régional de Franche-Comté, Conseil départemental de Haute-Saône,
Conseil départemental du Jura, Caritas veritatis foundation.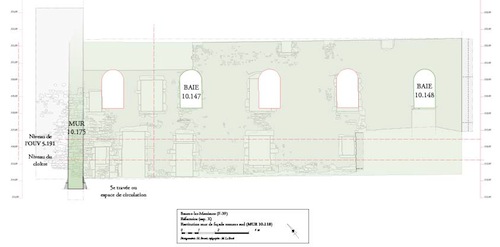
Objectifs et résultats :


Le monastère Notre-Dame de Château-sur-Salins est également étudié dans le cadre d’un travail de master hébergé par le Pcr, en partenariat étroit avec le programme de fouilles programmées dirigé par Ph. Gandel (UMR ArTeHiS) et D. Billoin (UMR ArTeHiS) sur le site. Ici, un premier état des lieux sous la forme de relevés topographiques et de sondages archéologiques limités a révélé un complexe en grande partie inédit, recouvert par des tas d’épierrements et dissimulé par le couvert forestier. C’est un ensemble de bâtiments monastiques dans un état de conservation exceptionnel – sur plusieurs mètres d’élévation – qui est en quelque sorte fossilisée sur le plateau de Château-sur-Salins. Dans leur dernier état, les bâtiments conventuels, qui s’organisent autour d’un cloître, dateraient de l’époque moderne et l’église prieurale du XIIIe s. Mais c’est sur la question des origines de ce monastère et des conditions de sa fondation que portent nos interrogations, à la lumière de sources historiques discutables, de son environnement proche et de la découverte de mobilier archéologique du haut Moyen Âge.
En fonction d’une méthodologie déjà largement éprouvée depuis le début de ce programme, le dernier volet du Pcr a porté cette année sur la constitution d’une nouvelle « strate de documentation » pour cinq sites, à travers des notices historiques et des prospections géophysiques. Parmi les sites prospectés cette année, on retiendra plus particulièrement les résultats obtenus sur l’église Saint-Maurice de Jougne avec la localisation de son abside disparue et de structures à mettre en relation avec sa crypte.


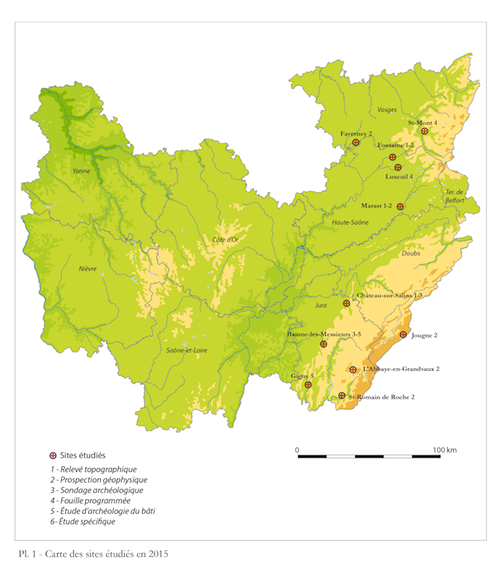
Monastère Saint-Pierre d’Osor / printemps 2015

Mission archéologique du ministère des Affaires étrangères (premier volet) ; Collaboration croato-française Responsables : Sébastien Bully (UMR ARTEHIS), Miljenko Jurković (université de Zagreb-centre IRCLAMA), Morana Čaušević-Bully (Université Bourgogne Franche-Comté-UMR Chrono-environnement), Iva Marić (université de Zagreb-centre IRCLAMA) Participation de : Ivan Valent, Thomas Chenal (UMR ARTEHIS), Adrien Sagesse (UMR ARTEHIS), Jelena Behaim, Brunilda Bregu, Matthieu Le Brech, Jessy Crochat, Lucija Dugorepec, Inès Pacat, Justine Gautier, Nadia Saint-Luc, Nadia Botalla, Ornella Salvi, Valentin Chevassu et Eva Žile. Financements : ministère des Affaires étrangères français, ministère de la Culture croate, ministère des Sciences croate, École française de Rome, Caritas veritatis foundation. Le monastère bénédictin Saint-Pierre d’Osor, sur l’île de Cres, aurait été fondé au début du XIe s. par saint Gaudentius, évêque de la cité. Engagée depuis 2006, la fouille programmée répond à plusieurs objectifs : il s’agit de comprendre les modalités de l’installation du monastère dans un contexte urbain – d’origine protohistorique et antique – et d’étudier une topographie monastique qui doit tenir compte à la fois des contraintes urbaines, mais également de constructions antérieures, peut-être déjà religieuses. L’analyse archéologique des vestiges de l’ancienne abbatiale Saint-Pierre complète les études d’histoire de l’art afin de préciser la datation d’un édifice considéré comme insigne pour l’architecture romane dans la région et révélateur des échanges et influences avec la côte adriatique occidentale. Les méthodes employées sont celles de l’archéologie du sous-sol, du bâti et les prospections géophysiques. La campagne 2015 a porté sur l’achèvement de la fouille de l’église réduite Saint-Pierre engagée en 2014, après une première tranchée de sondage ouverte la première année de la mission en 2006. L’église réduite au XVe-XVIe s. correspond à une partie de la nef centrale et du bas-côté nord de l’église du XIe s. dont elle conserve le mur gouttereau nord. Nous avons également engagé la fouille du flanc nord de l’église du XIe s. La fouille a porté plus particulièrement sur un caveau maçonné en position privilégiée au-devant de l’ouverture latérale de l’ancien bas-côté nord de l’église romane. Sa couverture était assurée par une large dalle calcaire anépigraphique. À l’instar de l’ensemble des caveaux fouillés sur le site, la tombe contenait plusieurs individus enterrés successivement, ici au nombre de sept. BULLY (S.), JURKOVIĆ (M.), MARIĆ (I.) et ČAUŠEVIĆ-BULLY (M.), « Monastère Saint-Pierre d’Osor (Croatie, île de Cres). Bilan de la mission franco-croate 2015 », Chronique des activités archéologiques de l’École française de Rome, mise en ligne en 2016 sur https://cefr.revues.org/1601
Dates de chantier : 12 mai au 20 juin 2015
en partenariat avec aIPAK/APAHJ
Le site :
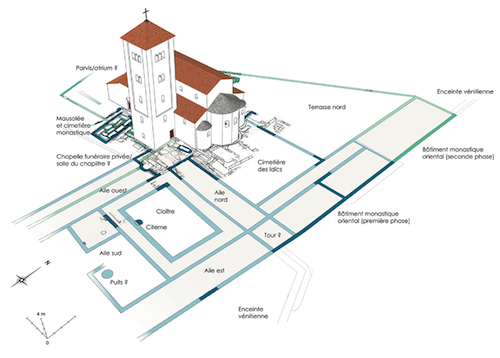
Objectifs et résultats :
Cette année ce sont 21 nouvelles sépultures qui ont été fouillées dans la nef de l’église. Il s’agit uniquement d’inhumations en pleine terre ou en cercueils datables des dernières phases d’utilisation de la grande église avant sa réduction à la fin du Moyen Âge.
Mais la découverte majeure porte sur les vestiges d’un segment de la façade occidentale, avec son entrée et le sol de mortier, d’une première église, peut-être de plan en croix grecque. Nous nous réservons le temps de l’étude avant de préciser une datation pour cet édifice, dont la construction pourrait se situer entre le VIe et les IXe s.
En parallèle de la fouille de l’église, nous avons entrepris celle de l’annexe nord du XIIe s. L’objectif était d’identifier d’éventuelles installations ou tombes pouvant étayer l’interprétation de cette petite annexe, architecturalement soignée, comme étant une memoria en relation avec la présentation de reliques dans les niches du mur est. Malheureusement, la fouille a seulement permis de constater que cet espace avait déjà été totalement décaissé par les autrichiens au XIXe s. (d’après une monnaie et le mobilier céramique). Seul un négatif de mortier sur le rocher indique la présence d’une structure antérieure.


Parallèlement, nous avons poursuivi l’analyse d’archéologie du bâti du mur d’enceinte et l’étude architecturale de l’église romane a été engagée à partir d’un travail de restitution en 3D.
Une synthèse des recherches a été présentée dans une exposition – accompagnée d’un catalogue – organisée à Mali Losinj et Zagreb entre le printemps et l’automne 2015 (cf. Notice du programme Monastères insulaires).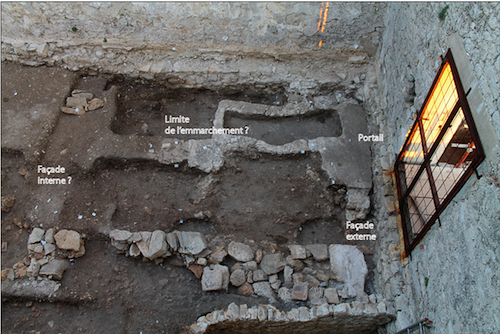
Les monastères et sites ecclésiaux insulaires dans l’archipel du Kvarner (Croatie) / Campagne 2015

Responsables : Morana Čaušević-Bully (université de Bourgogne Franche-Comté-UMR Chrono-environnement), Sébastien Bully (UMR ARTEHIS)Retour ligne automatique Mission archéologique du ministère des Affaires étrangères (second volet) Dates de chantier : du 29 juin au 18 juillet, du 19 au 30 octobre. Participation : Ivan Valent, Thomas Chenal (UMR ARTEHIS), Adrien Saggese (UMR ArTeHiS), Jessy Crochat, Lucija Dugorepec, et les contributions de Pascale Chevalier (UMR ArTeHiS), Inès Pactat, Mia Rizner et Miro Vuković En partenariat avec aIPAK/APAHJ Financements : ministère des Affaires étrangères français, ministère de la Culture croate, École française de Rome, Commune d’Omišalj, Commune de Mali Losinj, Région de Primosko-Goranska, Caritas veritatis foundation Le programme de prospection-inventaire des sites ecclésiaux insulaires engagé en 2010 est structuré autour de trois axes majeurs : Le programme de prospection-inventaire initié en 2010 est entré dans une nouvelle phase en 2015 avec le démarrage de la fouille programmée de la grande église paléochrétienne du complexe de Martinšćica (île de Cres). Dans le même temps, la poursuite des prospections a été à l’origine de la découverte d’une nouvelle église (paléochrétienne ou haut-médiévale) sur l’îlot désert de Mali Ćutin. Le troisième volet du programme a porté sur le site de Mirine-Fulfinum (île de Krk) avec la préparation du chantier de fouille dans le secteur dit de « l’église à trois absides », édifice daté des IXe-XIe s., construit sur un complexe antique suburbain (villa ?). Lien

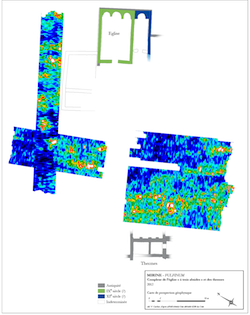

Les sites



Objectifs et résultats
Les principaux résultats des recherches menées à travers les programmes « Monastères et sites ecclésiaux insulaires » et « Monastère Saint-Pierre d’Osor » ont été présentés lors de l’exposition « Aquileia-Salona-Apollonia. Un itinéraire adriatique du IIe s. av. J.C. au début du Moyen Âge », qui s’est tenue aux musées de Mali Lošinj et de Zagreb durant l’année 2015.
Du 15 au 21 juin, un atelier doctoral sur le thème « Les sources pour l’histoire de l’Adriatique orientale (IVe-XVe siècle). Textes, archives et archéologie » a été organisé en collaboration avec l’Ecole française de Rome. La rencontre, en partie financée par la commune d’Omišalj, s’est déroulée dans le vestibule de l’église paléochrétienne de Mirine.
L’ensemble des résultats des différentes opérations est publié en ligne dans le cadre des chroniques archéologiques de l’Ecole française de Rome.



ČAUŠEVIĆ-BULLY (M.), BULLY (S.), Kvarner (Croatie). Prospection-inventaire des sites ecclésiaux et monastiques : campagne 2015, Chronique des activités archéologiques de l’École française de Rome, https://cefr.revues.org/1578
Le site archéologique de Savigny-Les-Beaune « La Champagne » / 2014

Des traces de vignes romaines (ou médiévales) et modernes en Côte de Beaune Le site Cette opération est l’aboutissement d’une enquête documentaire motivée par deux photos de 1962 de Lucien Perriaux (naturaliste bourguignon et futur maire de Beaune 1965-1968) qui montrent des traces, difficilement interprétables à l’époque, mais qui aujourd’hui sont tout à fait comparables aux fosses de plantations de vignobles anciens (romains ou médiévaux) tels que ceux qui sont mis au jour depuis une quinzaine d’années par les archéologues en France. Objectifs et résultats Au final, le repositionnement des photos au sol, le géoréférencement des photos aériennes ont permis de retrouver la seule parcelle de terrain préservée des aménagements et accessibles à la fouille … dans le périmètre de la cuverie Bouchard Père et Fils, une des plus importantes maisons de vin de Bourgogne. Des prospections magnétiques et électriques (Pôle-Pôle et tomographie) ont précisé la surface investigable. Le sondage a mis au jour un ensemble de fosses de plantations de vignes analogues à celles observées par Lucien Perriaux, des fosses en alvei avec provignages dont la forme et les creusements internes évoquent plutôt un âge antique que médiéval. En plus de ces traces, un autre ensemble de fosses de plantation et de provignage sans doute modernes, a été mis en évidence avec des racines et des fragments de ceps conservés sous forme charbonneuse.Un relevé aérien par drone a été effectué pour restituer le site en plan et en 3D Perspectives La métrique de ces fosses sera à comparer à celle d’autres vignobles publiés en France. Des datations 14C sur des fragments de charbons de bois et les restes organiques recueillis dans les fosses seront pratiquées à la suite.Ce programme fait suite aux recherches sur les vignobles anciens, commencé à Gevrey-Chambertin-Brochon en 2008-2012. Ces vestiges de plantations attestent la viticulture sur des terrains actuellement non occupés par la vigne, dans un territoire viticole emblématique, aux portes de Beaune, dans le fameux Pagus Arebrignus du panégyrique à Constantin de 312 et dans le périmètre des climats viticoles candidats au patrimoine UNESCO. [Lire le communiqué de presse]
Responsable : Jean-Pierre Garcia, professeur à l’université de Bourgogne, UMR CNRS-uB-Culture 6298 ARTEHIS et MSH-Dijon.
Participation de : A. Quiquerez, F. Delencre, D. Stuart (UMR ArTeHiS) et 15 étudiants du master 1 AGES « Archéo-GEo-Sciences »
Dates : 17-21 mars 2014.
Financements et soutiens : Programme DINOS, Conseil Régional de Bourgogne (via le Plan d’Action Régional pour l’Innovation), Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, SRA Bourgogne

Ces indices étaient situés à l’époque des photos de Louis Perriaux en surface de gravières. L’enquête s’est poursuivie par l’étude des photos aériennes de 1962 à 2013, géolocalisées pour replacer le site dans le paysage d’aujourd’hui qui est devenu la zone industrielle de Beaune de « La Champagne ».

Le site archéologique de la Cime de la Tournerie sur la commune de Roubion (Alpes-Maritimes) / campagne de fouille 2014

Fouille programmée triannuelle (2014-2016) dans le cadre du Projet Collectif de Recherche de l’UMR Camille Jullian : « Peuplement et occupation du sol du Massif du Mercantour au cours de l’holocène » Le site Le site de la Tournerie sur la commune de Roubion, fouillé pour la première fois dans le cadre du programme Alcotra PIT Mercantour Alpi Marittime, correspond à un site monumental de l’âge du Fer caractérisé par un réseau d’enceintes concentriques délimitant une plate-forme d’environ 450 m.
Responsable : Franck Suméra (Conservateur en chef, MCC)
Participation de l’UMR ARTEHiS : Patrice Méniel (DR CNRS), étude des vestiges osseux d’animaux.Marie Poignant (Master AGES), fouille et gestion du mobilier archéologique.Dates d’intervention : juin et juillet 2014.
Implanté sur un monticule qui culmine à 1816 m, il constitue un belvédère qui offre une vue à 360° sur les plus hauts sommets du Mercantour et de l’Argentera. Les relations entretenues avec le paysage et la nature des découvertes réalisées à l’occasion des fouilles conduites en 2011 indiquent une vocation cultuelle du site. Bien qu’il soit trop tôt pour conclure, la présence d’os humains, de stèles, d’une perle en bronze ainsi que la topographie pourraient évoquer un sanctuaire de type héroïque similaire à celui des « Touries » sur la commune de Saint-Jean-et-Saint-Paul dans l’Aveyron.
L’importance des moyens mis en œuvre pour l’édification du site soulève de manière inédite la question de la démographie des populations du Mercantour pendant l’âge du Fer et celle de l’existence d’une société suffisamment hiérarchisée pour mobiliser une entreprise de construction qui a conduit à creuser dans la roche des fossés de 2 m de profondeur sur plusieurs centaines de mètres de long.
En l’état des connaissances, le site de la Tournerie n’a pas d’équivalent dans les Alpes du sud et si sa vocation est bien confirmée, ce serait le premier sanctuaire de haute montagne de l’âge du Fer.
L’étude des restes animaux ne fait que débuter, mais l’état de conservation des ossements est tout à fait exceptionnel permet de faire de nombreuses observations sur les traces anthropiques, cuisson et découpe, qui indiquent que nous avons affaire à des déchets culinaires. Les premières déterminations montrent l’importance des caprinés dans cet assemblage. Cette faune semble présenter de nombreuses analogies avec celle, également en cours d’étude au laboratoire d’archéozoologie ArTeHiS, du site à stèles du premier âge du Fer des Touries, fouillé sous la direction de P. Gruat (CG Aveyron).
Vert-la-Gravelle (Vert-Toulon) « La Crayère » (Marne). Nécropole d’hypogées et minière de silex du Néolithique récent (3500-3000 avant notre ère) / campagne de fouille 2014

Nom du site : Vert-la-Gravelle (Vert-Toulon) « La Crayère » (Marne) La campagne de fouille 2014 Découvert au milieu du XIXe siècle, puis fouillé par Joseph de Baye en 1873-1874, le site fut redécouvert en juin 2012 dans le cadre d’un programme de prospection sur le Néolithique des marais de Saint-Gond (Marne). Il comporte deux secteurs : à l’est une nécropole de quatre hypogées et à l’ouest, en continuité, une minière de silex. La fouille a montré qu’il existait de grandes plates-formes, jusque-là inconnues, devant les couloirs d’accès menant aux chambres funéraires. Les entrées étaient bloquées par des blocs de pierre meulière lors de la condamnation définitive des monuments sépulcraux. Les chambres funéraires, quadrangulaires, sont toutes comparables et mesurent une dizaine de mètres carrés.
Date de fouilles : du 27 mai au 28 juin et du 15 au 30 août 2014.
Responsable : Rémi Martineau (CR CNRS – UMR 6298 ArTEHiS)
Participants de l’UMR 6298 ArTeHiS : Anthony Dumontet, Fabrice Monna, Jehanne Affolter
Participant de la MSH de Dijon : Laure SalignyFinancement : DRAC/SRA Champagne-Ardenne (Ministère de la Culture).Le blog sur le Néolithique des marais de Saint-Gond : http://saintgond.hypotheses.org
Cette nécropole se situe à moins de deux mètres d’une minière d’exploitation du silex, très certainement contemporaine. Le système d’exploitation du banc de silex associe des puits de mines de trois mètres de diamètre et de deux mètres de profondeur et une longue tranchée en front de taille. Cette structure a livré de nombreux outils fracturés en bois de cerf et des déchets de débitage des rognons de silex.
Les prospections ont montré que ce secteur sud-ouest de la Côte d’Île-de-France comprend des dizaines de minières de silex regroupées en au moins cinq secteurs, sur les communes de Vertus, Loisy-en-Brie, Vert-Toulon, Coizard et Villevenard. Ces nombreuses exploitations minières permettront sans doute de mieux comprendre la présence des 150 hypogées fouillés dans la Marne depuis 140 ans, dont plus de 120 sont situés dans la région des marais de Saint-Gond.
Belfort « Le Bramont » Habitat de hauteur du Néolithique moyen et du Bronze Moyen / campagne 2014

Responsable du chantier : Financement : MCC – DRAC Franche-Comté Le site fortifié du Bramont à Belfort (Territoire de Belfort) fait l’objet d’un programme de recherche pluriannuel depuis 2010. Il est implanté au débouché oriental de la Trouée de Belfort, à l’extrémité d’un éperon étroit et allongé aux versants escarpés au nord-ouest et au sud-est. Deux remparts transversaux en ferment les parties les plus étroites, sous la forme de levées de terre et de pierres d’une hauteur maximale de 1,80 m qui isolent un espace allongé grossièrement rectangulaire de 2000 m2 environ. Ces remparts sont reliés du côté nord par une levée de pierre et de terre de plusieurs dizaines de centimètres de hauteur, alors qu’une levée moins conséquente, discontinue, souligne une partie du bord sud. L’occupation du néolithique L’occupation néolithique est surtout connue par des amas de déchets de taille et des ébauches de haches en pélite-quartz nombreux sur le site qui témoigne d’une occupation entre la seconde moitié du Ve millénaire avant notre ère et le premier quart du IVe millénaire. Dans l’état actuel des fouilles, aucune trace de rempart de cette période n’a été clairement mise en évidence. Cette absence pourrait alors laisser penser qu’à cette époque le site du Bramont ne serait qu’un habitat de hauteur non défensif, spécialisé dans la mise en forme d’ébauches de haches en relation avec les exploitations de pélite-quartz de Plancher-les-Mines (Haute-Saône), comme il en existe plusieurs dans la région de Belfort – Montbéliard. Mais il n’est pas exclu non plus qu’un rempart ancien ait été remanié lors des constructions de l’âge du Bronze auquel se rattachent tous les aménagements actuellement datés. Les remparts de l’âge du Bronze Les remparts ouest, nord et sud, datés entre 1500 et 1350 av. J.-C., soit du Bronze moyen et du tout début du Bronze final, appartiennent à des types de constructions distincts qui peuvent revêtir des fonctions différentes. Bilan La situation du site fortifié du Bramont sur l’un des derniers promontoires dominant le débouché oriental de la Trouée de Belfort, n’est sans doute pas étrangère au choix de ce site à l’âge du Bronze moyen.
Jean-François Piningre (associé à l’UMR 6298, ArTeHIS)Avec Annick Richard (UMR 6249 Chrono-environnement, Besançon – SRA Franche-Comté)
Dates de fouille : 12 juillet – 15 août 2014




– Le rempart occidental, large d’une douzaine de mètres, montre deux étapes de constructions successives et l’aménagement de fours à chaux. Composé d’un talus de blocs de calcaire et de terre et d’inclusions de chaux indurée, cet édifice ne se résume pas à une simple accumulation de matériaux. Il répond à des pratiques architecturales plus élaborées avec des façades extérieures, parementées de grandes dalles, dont l’aspect monumental était sans doute recherché.
– Le rempart sud, aux dimensions beaucoup plus réduites, supportait un alignement de blocs espacés volumineux. Cette construction a pu jouer un rôle de contrefort et de soubassement aux habitations dont les nombreux foyers revêtus de dalles de calcaire rubéfiées et les dépotoirs jalonnent sa bordure intérieure.
– Le rempart Nord se présente sous une forme moins soignée, aux parements irréguliers. Son contact avec le rempart ouest est toutefois complexe et fait état de constructions se recoupant, ainsi que d’un accès latéral possible, condamné ensuite.
Les distinctions architecturales des aménagements soulèvent la question du statut différent de ces structures. Il apparaît clairement que le rempart ouest montre la volonté d’une certaine monumentalité avec sa masse importante, un parement extérieur soigné, composé de matériaux sélectionnés et vraisemblablement extraits à l’extrémité est de l’éperon où ces bancs de calcaire stratifié sont encore visibles. Cette construction élaborée serait d’autant plus justifiée qu’elle serait associée à un accès au site. Les raisons de l’élargissement de ce rempart, qui vient encore en accroître sa masse, restent encore obscures. L’association des modifications apportées à la jonction des remparts ouest et nord à cette étape est probable et indique une opération d’envergure qui ne résulterait pas que d’une simple consolidation de l’ouvrage. L’aménagement de fours à chaux et les matériaux rubéfiés utilisés dans le remplissage pourraient illustrer aussi une évolution des techniques par la recherche d’une plus grande stabilité de la masse interne en l’absence d’armature de bois.
Du point de vue culturel, la céramique et quelques parures en bronze attestent d’une forte influence des groupes implantés dans la plaine d’Alsace et en Suisse orientale, qui font sentir leur influence en direction du Jura et de la Bourgogne à partir de 1500 av. J.-C. Mais il est toutefois acquis que ces liens, estimés prépondérants dans la formation du Bronze moyen de Franche-Comté septentrionale et d’Alsace méridionale, ne sont pas les seuls à prendre en compte. Un lot de formes céramiques, bien individualisées en 2014, renvoie à des influences nord-italiques et méridionales, ainsi qu’a des contacts avec le Plateau suisse. A côté de son dispositif architectural élaboré, le site du Bramont occupe une place de référence dans les relations est-ouest, mais aussi sud-nord, jusqu’ici sous-estimées dans le Bronze moyen de France orientale.
Les sites d’Annegray et de Faucogney : fouilles programmées et sondages / été 2014
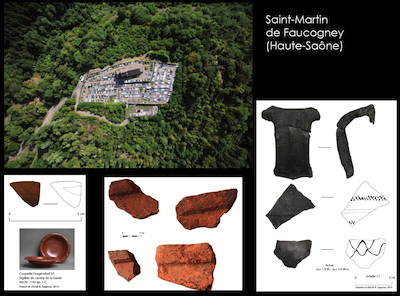
Projet collectif de recherche Monastères en Europe occidentale (Ve –Xe siècles). Topographie et structures des premiers établissements en Franche-Comté et Bourgogne)Collaboration franco-irlandaise Le site : Le hameau d’Annegray (commune de la Voivre, Haute-Saône) est le lieu du premier monastère de l’Irlandais Colomban fondé à la fin du VIe s. Des premières fouilles menées en 1958 avaient révélé les vestiges d’une église romane et des sarcophages mérovingiens. C’est sur cette base, qu’à partir de 2010, nous avons engagé des campagnes annuelles de recherches archéologiques afin de localiser le monastère précoce que l’hagiographie situe dans, ou à proximité d’un « castrum [romain] ruiné que la tradition des anciens nommait Anagrates » (cf. notices d’actualités des années précédentes). Objectifs et résultats 1- Lors de cette nouvelle campagne, nous avons débuté la fouille des parties orientales de l’église dite romane, dont le chevet avait été localisé par géoradar en 2013 avant d’être confirmé par un sondage. En dépit de structures très arasées, la fouille a permis de préciser le plan du chevet avec une abside centrale cloisonnée sur ses absidioles. La travée de chœur était fermée par une barrière dont on conserve seulement le négatif ; la fondation maçonnée d’un autel a été découverte dans l’absidiole sud. L’abside centrale accueillait la tombe en coffrage mixte d’un homme et d’un périnatal. Cette tombe en situation privilégiée a été datée par radiocarbone dans le Xe s., indiquant que l’église est contemporaine ou légèrement antérieure, mais que l’on ne peut plus retenir la datation traditionnelle de sa construction dans la première moitié du XIe s. Les indices d’un édifice antérieur (mérovingien ?) restent rares (fragment de vitrail, négatifs de maçonneries, sépultures), mais bien présents. 2- Les prospections pédestres dans un périmètre de quelques centaines de mètres autour des vestiges de l’église confirment une occupation antique du lieu par la découverte de fragments de tegulae et de céramiques. 3- Un second sondage ouvert dans la nef de la proche église Saint-Martin de Faucogney n’a pas permis de confirmer l’hypothèse d’un édifice chrétien et/ou antique antérieur à la construction actuelle. En revanche, et pour la première fois de la céramique mérovingienne a été découverte dans le comblement des fosses de sépultures modernes. 4- Les prospections pédestres autour de l’église ont livré du mobilier antique et peut-être antique tardif (céramique, verre et tuiles) sur et au pied de deux petites éminences rocheuses. Ces indices accréditent l’hypothèse d’une occupation (cultuelle ?) du Mont Saint-Martin à l’époque gallo-romaine. La campagne 2015 verra la poursuite de la fouille programmée de l’église Saint-Jean-Baptiste ainsi que l’ouverture de nouveaux sondages archéologiques sur les petites buttes à proximité de l’église Saint-Martin de Faucogney.
Responsables : Sébastien Bully (UMR ArTeHiS), Conor Newman (université de Galway), Morana Čaušević-Bully (université de Franche-Comté-UMR Chrono-environnement)
Participation de : Aurélia Bully, Thomas Chenal, Laurent Fiocchi, Alicia Mougin, Adrien Sagesse en partenariat avec UMR SISYPHE – Université Pierre et Marie Curie Paris VI-Jussieu, MSH Dijon-USR CNRS-UB 3516, APAHJ
Dates de chantier : 21 juillet au 15 août 2014
Financements : Ministère de la Culture – DRAC Franche-Comté
Conseil régional de Franche-Comté, Conseil général de Haute-Saône,
Caritas veritatis foundation,
Fondation Gilles et Monique Cugnier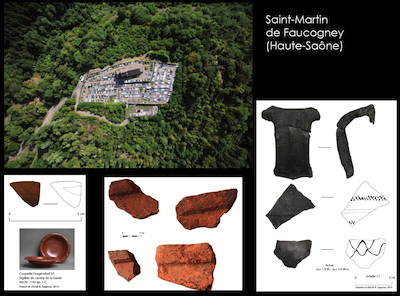


Monastère Saint-Pierre d’Osor / printemps 2014 Collaboration croato-française

Responsables : Sébastien Bully (UMR ArTeHiS), Miljenko Jurković (université de Zagreb-centre IRCLAMA), Morana Čaušević-Bully (École française de Rome), Iva Marić (université de Zagreb-centre IRCLAMA) Le site : Le monastère bénédictin Saint-Pierre d’Osor, sur l’île de Cres, aurait été fondé au début du XIe s. par saint Gaudentius, évêque de la cité. Engagée depuis 2006, la fouille programmée répond à plusieurs objectifs : il s’agit de comprendre les modalités de l’installation du monastère dans un contexte urbain – d’origine protohistorique et antique – et d’étudier une topographie monastique qui doit tenir compte à la fois des contraintes urbaines, mais également de constructions antérieures, peut-être déjà religieuses. L’analyse archéologique des vestiges de l’ancienne abbatiale Saint-Pierre complète les études d’histoire de l’art afin de préciser la datation d’un édifice considéré comme insigne pour l’architecture romane dans la région et révélateur des échanges et influences avec la côte adriatique occidentale. Les méthodes employées sont celles de l’archéologie du sous-sol, du bâti et les prospections géophysiques. Objectifs et résultats : La neuvième campagne de fouille programmée du monastère Saint-Pierre d’Osor a permis d’achever la fouille du cimetière monastique et du mausolée établit sur le flanc sud de l’église abbatiale. Des datations C14 des IXe-Xe s. obtenues sur certaines inhumations nous assurent désormais que l’espace funéraire et le mausolée sont antérieurs à la fondation « officielle » du monastère vers 1018. Entre les XIe et XIVe s., les trois formae du mausolée et les six tombes maçonnées – d’une seconde phase – accueillirent plus d’une centaine d’inhumations, essentiellement masculines. La fouille a porté également en 2014 sur l’église réduite moderne, dont la surface correspond à une partie de la nef centrale et du bas-côté nord de l’église romane. Des tombes privilégiées en cercueil ou dans des caveaux maçonnés, ont également été mises au jour ; des dépôts de fioles en verre dans les tombes pourraient indiquer des inhumations de prêtres. La fouille de l’église a encore révélé les vestiges d’une barrière de chœur, des niveaux de sols et des structures antérieures dont l’exploitation se poursuivra en 2015. Un second sondage, ouvert dans l’aile sud du cloître, a mis au jour les vestiges particulièrement bien conservé d’un sol de mortier – du réfectoire ? Le cloître de Saint-Pierre d’Osor figure désormais parmi les rares cloîtres bénédictins romans connus en Croatie. Depuis cette année, le site fait l’objet de travaux de restauration et de mise en valeur dans le cadre de la création d’un parc archéologique. La maîtrise d’ouvrage est assurée par la Ville de Mali Losinj, sous le contrôle du ministère de la Culture (Surintendance de Rijeka), à partir d’un cahier des charges défini par l’équipe archéologique. Une première tranche de travaux a porté cet automne sur le bas-côté sud de l’église et le mausolée. Lien :
Participation de : Laurent Fiocchi, Tonka Kružić, Ivan Valent, Inès Pactat, Brunilda Bregu, Matthieu Le Brech en partenariat avec aIPAK/APAHJ
Dates de chantier : 12 mai au 20 juin 2014
Financements : ministère de la Culture croate, ministère des Sciences croate, École française de Rome, Caritas veritatis foundation


La campagne 2015 sera consacrée à l’achèvement de la fouille de l’église abbatiale romane dans l’emprise de l’église tardive et à l’engagement de la fouille de son vestibule découvert en 2006.


BULLY (S.), JURKOVIĆ (M.), MARIĆ (I.) et ČAUŠEVIĆ-BULLY (M.), « Monastère Saint-Pierre d’Osor (Croatie, île de Cres). Bilan de la mission franco-croate 2014 », Chronique des activités archéologiques de l’École française de Rome, mise en ligne en 2015 sur http://cefr.revues.org/
Abbaye de Bobbio (Italie) : prospections géophysiques, 2014

Collaboration franco-italienne Le site Située dans la vallée de la Trebbia, au sein des Apenins, l’abbaye de Bobbio fut fondée par Colomban en 612, après son exil de Gaule. La crypte gothique de l’abbatiale conserve la dépouille de l’abbé irlandais décédé en 615. Durant le Moyen Âge, l’abbaye est un important lieu de pèlerinage et figure parmi les grands centres spirituels d’Europe occidentale. Le musée municipal conserve d’importants témoignages des siècles du haut Moyen Âge, mais les bâtiments monastiques sont pour l’essentiel des reconstructions de la fin du Moyen Âge, à l’exception de l’abbatiale qui conserve des parties romanes.
Responsables : Eleonora Destefanis (Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”), Sébastien Bully (UMR ARTeHIS), Christian Camerlynck (UMR METIS – Université Pierre et Marie Curie Paris VI-Jussieu), Roberta Conversi (Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna)
Dates : 30 avril au 2 mai 2014
Financements : projet Making Europe : Colombanus and his legacy
Objectifs et résultats
Les prospections GPR engagées sur le monastère de Bobbio s’inscrivent dans le cadre du programme de recherche international Making Europe : Colombanus and his legacy et complétent des premières prospections magnétiques réalisées par l’université de Galway (Irlande) en 2013. Mieux adaptée aux contraintes d’espaces architecturés et urbains, nous avons mis en œuvre la méthode du radar-sol à l’intérieur du monastère et sur les places adjacentes. La prospection a porté sur l’ensemble de l’abbatiale et sa crypte, sur le cloître et les galeries, son aile orientale et sur la place qui borde le monastère à l’est. L’analyse de l’ensemble des carte-radars est toujours en cours, mais la localisation de structures dans la nef de l’abbatiale romane a permis d’ores et déjà de déterminer l’emplacement d’un sondage archéologique qui sera réalisé en 2015. Au moment de la célébration des 1400 ans de la mort de saint Colomban, il s’agira des toutes premières recherches archéologiques menées sur le monastère.
Le site du Saint-Mont : reprise de fouille et relevés topographiques / 2014

Projet collectif de recherche Le site : Le Saint-Mont (commune de Saint-Amé, Vosges) est réputé pour être l’emplacement du premier monastère d’Austrasie, fondé au début du VIIe s. par saint Amé, moine de Saint-Maurice d’Agaune puis de Luxeuil, et par saint Romaric, leude austrasien. Le site du Monasterium Habendum a fait l’objet de plusieurs campagnes de fouilles entre 1964 et 1991 par Michel Rouillon puis par Charles Kraemer. Les recherches ont permis la découverte de nombreuses structures et de mobilier s’inscrivant pour l’essentiel dans une large fourchette chronologique comprise entre l’Antiquité tardive et l’époque moderne. Les vestiges s’étagent entre le sommet du mont et deux terrasses sur son flanc sud, soit une surface estimée actuellement à 3 hectares. En tenant compte des résultats anciens, nous avons engagé une nouvelle série de relevés topographiques et de prospections géophysiques ; une révision de fouille a été menée sur des vestiges anciennement dégagés afin de mieux comprendre l’évolution topographique d’un site monastique qui s’implanterait, d’après le récit hagiographique des fondateurs, sur une villa mérovingienne, puis sur un castrum tardo-antique. Objectifs et résultats : Pour cette nouvelle campagne, nous avons : La campagne 2015 complétera la « relecture » des structures engagée en 2013 en réalisant une fouille exhaustive du secteur afin de valider l’hypothèse de l’existence d’un grand édifice funéraire mérovingien. Il s’agira d’en déterminer l’emprise et le plan exact, comme d’étudier plus précisément son architecture et les formae qu’il accueille. Une campagne de topographie sera une nouvelle fois menée sur le massif afin de compléter les données déjà acquises.
Monastères en Europe occidentale (Ve – Xe siècles). Topographie et structures des premiers établissements en Franche-Comté et Bourgogne, sous la direction de Sébastien Bully et Christian Sapin
Responsables : Thomas Chenal (UMR ArTeHiS – Chercheur associé), Charles Kraemer (chercheur au pôle archéologique, HISCANT-MA, Université de Lorraine)
Participation de : Martine Aubry-Voirin, Valentin Chevassu, Alicia Mouginen partenariat avec UMR METIS – Université Pierre et Marie Curie Paris VI-Jussieu, MSH Dijon-USR CNRS-UB 3516, MSHE Ledoux Besançon -USR 3124, APAHJ
Dates d’intervention : 30 juin au 20 juillet 2014
Financements : Projet collectif de recherche Monastères en Europe occidentale, commune de Saint-Amé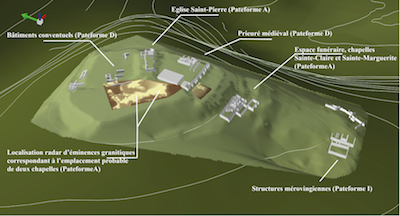

1- Nettoyé les structures visibles des chapelles Sainte-Claire et Sainte-Marguerite, puis repris les anciennes fouilles qui s’étendaient à l’ouest afin de mieux comprendre l’emprise générale du bâtiment antérieur à ces chapelles gothiques. Avec la découverte de la façade du bâtiment et de 32 tombes en formae, le plan et le phasage de ces structures nous permettent désormais de suggérer que l’on serait en présence d’un édifice funéraire de 22 mètres de long pour 8 de large.
2- Traité la prospection radar qui avait été menée sur des plateformes vierges de découvertes archéologiques. Ces prospections ont porté sur des plateformes aménagées au XVIIIème siècle en détruisant des mamelons granitiques sommés de chapelles médiévales. Nous avons détecté deux probables éminences rocheuses en prenant appui sur le contraste entre le socle naturel et le remblai anthropique.
3- Étendu le relevé topographique général du site aux chemins d’accès, aux remparts non datés défendant le sommet, ainsi qu’aux pentes que nous n’avions pas encore traitées au moyen d’un tachéomètre et de GPS différentiels. Des structures périphériques au monastère ont ainsi été découvertes, à l’image d’une carrière de granit moderne.
4- Mené une campagne de photogrammétrie terrestre et drone à l’occasion du nettoyage des structures de l’espace funéraire. Ces relevés ont permis de modéliser l’ensemble des structures connues de l’aire funéraire en 3D, complétant les relevés au pierre à pierre et topographiques afin de participer à une meilleure compréhension spatiale de la zone.


Le site de la carrière de Saint-Valbert (Haute-Saône) : relevés topographiques et sondage/ 2014

Projet collectif de recherche La campagne de sondages et de prospections 2014 fait suite à une première campagne réalisée en septembre 2013 sur le site de la carrière de sarcophage de Saint-Valbert en Haute-Saône (70). La première campagne avait permis de déterminer partiellement le mode d’exploitation du grès de la carrière grâce, notamment, à un sondage sur un front de taille. Elle a dans un deuxième temps permis de débuter l’enregistrement des blocs et des fronts de taille repérés en prospection afin de caractériser l’étendue du site. Objectifs et résultats : Le travail de terrain mené dans la carrière de Saint-Valbert (70) en août 2014 avait plusieurs objectifs : 1- Établir l’étendue de la carrière de Saint-Valbert, que l’on évalue désormais à 7 hectares, grâce à de nouvelles prospections et de nouveaux relevés topographiques. 2- Compléter l’inventaire des blocs et des fronts de tailles présents au sein de la zone d’étude afin d’avoir un aperçu de la densité et de la localisation des déchets de tailles. Plus d’une centaine de blocs et une dizaine de fronts de taille ont été enregistrés. 3- Cartographier les blocs présentant des traces relatives à la fabrication de sarcophages. 4- Réaliser deux nouveaux sondages afin de confirmer le mode d’exploitation du grès qui s’avère être une exploitation en tranchée. Les traces observées sur les fronts de taille dégagés ont permis d’obtenir des informations sur la chaîne opératoire d’extraction des blocs dans la région de Luxeuil-les-Bains. 5- Tenter de déterminer s’il s’agit d’un type de production unique ou si d’autres types d’éléments tels que des blocs de grand appareil auraient pu être extraits au sein de la carrière. 6- Collecter de nouvelles informations qui nous permettent de situer plus finement les périodes d’occupation et d’abandon de ce site carrier. Ces deux campagnes de recherches menées sur le site de Saint-Valbert ont permis de confirmer le réel potentiel de ce site et sa bonne conservation. Nous avons pour la première fois pu établir l’étendue réelle de la carrière et définir des zones à plus forte densité de vestiges. Le type de production n’est probablement pas unique sur le site. En effet, les blocs extraits sont pour la plupart de grandes dimensions et nous ne pouvons pas écarter l’hypothèse d’une exploitation antique, par exemple, pour des blocs de grands appareils prenant place dans les constructions de l’agglomération secondaire de Luxeuil. La carrière a probablement fonctionné aux alentours des VI-VIIIème siècle, période de production des sarcophages monolithique dans la région. Comme pour d’autres sites carriers, la période d’occupation comprend certainement des phases d’occupations antérieures (antique notamment) entrecoupées de phases d’abandon. Mais aucun site archéologique n’a été décelé à proximité du site ou en lien direct avec le site ce qui n’en facilite pas l’attribution chronologique.
Monastères en Europe occidentale (Ve – Xe siècles). Topographie et structures des premiers établissements en Franche-Comté et Bourgogne, sous la direction de Sébastien Bully et Christian Sapin
Responsable : Mougin AliciaEn partenariat avec MSH Dijon-USR CNRS-UB 3516, MSHE Ledoux Besançon -USR 3124, APAHJ
Dates d’intervention : 18 au 29 août 2014
Financements et participation : Projet collectif de recherche Monastères en Europe occidentale, Commune de Saint-Valbert

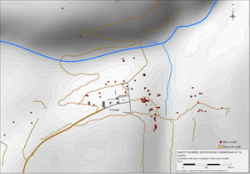
Les monastères et sites ecclésiaux insulaires dans l’archipel du Kvarner (Croatie) / Campagne 2014

Collaboration croato-française Les sites : Le programme de prospection-inventaire des sites ecclésiaux insulaires engagé en 2010 est structuré autour de trois axes majeurs : Objectifs et résultats : À l’instar de la campagne précédente, nous sommes intervenus en 2014 sur les complexes de Martinšćića (île de Cres), de Mirine-Fulfinum (île de Krk) et l’îlot de Lukovac (île de Rab). À Mirine-Fulfinum, la seconde campagne de fouilles sur le mausolée du Ve s. a permis d’en préciser les différents états et de fouiller 8 nouvelles sépultures, portant à 13 le nombre de tombes découvertes dans, ou en relation avec le mausolée familial. À proximité, Une petite construction, interprétée jusqu’alors comme une memoria, a fait l’objet d’une révision et d’un complément de fouille. En dépit de l’absence de tombe repérée – en raison d’un sol de mortier d’une seconde phase particulièrement bien préservé que l’on a souhaité conserver –, il s’agit plus probablement d’un second mausolée. L’ensemble des recherches archéologiques participe à la création d’un parc archéologique comprenant la ville antique de Fulfinum et le complexe paléochrétien et médiéval de Mirine. Sur l’îlot de Lukovac, la poursuite des relevés topographiques a été rendue possible cette année par des travaux de débroussaillage et le nettoyage d’arases de maçonneries localisés en fonction de la micro-topographie. Cette campagne a révélé une densité de lotissement sur la quasi-totalité de l’îlot et la présence d’une galerie sur le flanc sud de l’église protobyzantine, ainsi que d’une vaste citerne à son chevet. La prise en compte de l’ensemble des structures, replacé dans une lecture plus globale du paysage côtier et insulaire, plaide désormais en faveur de l’interprétation d’un dispositif militaire protobyzantin, plus que celle d’un établissement religieux. Lien :
Responsables : Morana Čaušević-Bully (École française de Rome), Sébastien Bully (UMR ARTEHIS)
Participation d’Ivan Valent, Mia Rizner, Iva Marić, Miro Vuković, en partenariat avec Josip Burmaz et Dinko Tresić-Pavičić de la société Kaducej, aIPAK/APAHJ
Dates de chantier : 27 avril au 10 mai, 23 juin au 4 juillet, 20 au 25 octobre 2014
Financements : Ministère de la Culture croate, École française de Rome, Commune d’Omišalj, Commune de Mali Losinj, Commune de Lopar, Caritas veritatis foundation
– Identification des sites monastiques potentiels à partir des sources écrites, des données archéologiques, architecturales et topographiques ;
– Conditions et modalités de l’installation et de la diffusion du monachisme insulaire dans le Kvarner, entre le Ve et le XIe siècle : occupation du sol et voies maritimes, construction de l’espace ;
– Topographie monastique et architecture cultuelle : héritages et influences, cénobitisme et érémitisme.
L’exécution de ce programme passe un dépouillement bibliographique, des sondages archéologiques, des études de bâti, des relevés topographiques, la constitution d’une documentation graphique et photographique, des prospections pédestres et géophysiques. Depuis cette année, le site de Martinšćića fait l’objet d’une fouille programmée.
À la suite des relevés topographiques du site de Martinšćića, des sondages archéologiques et de l’étude du bâti des vestiges de l’église à plan en croix grecque, la première campagne de fouilles programmées a porté sur un bâtiment à abside outrepassée découvert en 2011. Les résultats préliminaires indiquent que l’on serait en présence d’une salle de réception de l’Antiquité tardive de la villa maritime. Des premiers indices d’une occupation du Ier s. ap. J.–C. ont également été mis au jour. Mais à ce stade des recherches, il reste délicat de se prononcer sur la contemporanéité de cette partie de la villa avec l’église paléochrétienne, dans le cadre d’une possible réoccupation monastique.







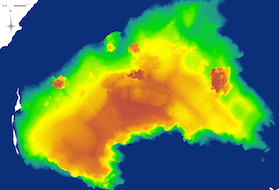

ČAUŠEVIĆ-BULLY (M.), BULLY (S.), Kvarner (Croatie). Prospection-inventaire des sites ecclésiaux et monastiques : campagne 2014, Chronique des activités archéologiques de l’École française de Rome, mise en ligne en 2015 sur http://cefr.revues.org/
Campagne de fouilles PCR Autun-Genetoye 2014

Responsables : Yannick Labaune (coordination scientifique), Filipe Ferreira (resp. fouille théâtre du haut du Verger), Matthias Glaus (resp. études architecturales), Martine Joly (resp. fouille temple dit de Janus), Matthieu Thivet (resp. fouille ateliers de potier) La fouille réalisée cette année dans la parcelle des « Grands Champs » en périphérie du complexe monumental de la Genetoye à Autun a permis de confirmer l’hypothèse émise par la prospection géophysique de l’existence d’un quartier artisanal antique à l’extérieur de l’enceinte d’Augustodunum. Ce quartier qui semble s’implanter dès la première moitié du premier siècle de notre ère ne se développe réellement que dans le courant du deuxième siècle, pour être ensuite rapidement abandonné durant le milieu du troisième siècle. Le temple dit de Janus et ses abords immédiats – 2014.4 (resp. Ph. Barral, M. Joly) La campagne 2014 a permis de conforter et de préciser les observations réalisées l’an passé, dans le cadre de deux sondages d’ampleur limitée. Ces nouvelles données intéressent les états antiques comme les états médiévaux, à des degrés divers. La confirmation de l’existence d’un substrat cultuel laténien, seulement soupçonné l’an passé, sur la base de quelques éléments de mobilier, constitue un point important. La présence d’une série conséquente de micro-vases est confortée par la découverte d’un fragment de fourreau d’épée laténienne. Les micro-vases, de formes variées, s’inscrivent typologiquement dans une fourchette large (IIIe-Ier siècles av. n. è.). Par comparaison avec les types illustrés à Mirebeau (Joly, Barral 2008), il ne fait aucun doute que certains exemplaires se rattachent à La Tène C2, voire à La Tène C1. Une fibule en fer de schéma La Tène C se situe dans la même ambiance chronologique, tandis que quelques potins illustrent des variantes tardives, attribuables à La Tène D2. Pour l’instant, aucune structure ne peut être rattachée à cette première utilisation cultuelle du site, ce qui est en grande partie lié à l’exiguïté des fenêtres d’observation de ces niveaux précoces. La continuité de l’utilisation du sanctuaire, à la charnière de l’âge du Fer et de l’époque romaine, semble avérée puisque les premiers aménagements de sol, sous la forme de niveaux cailloutis damés, sont en relation avec un matériel numismatique homogène de faciès augustéen moyen-tardif, correspondant donc au premier quart du Ier siècle ap. J.-C.. Une phase d’aménagement du site, autour du changement d’ère ou un peu après, peut être formulée sur cette base, à titre d’hypothèse de travail. Sans aucun doute, une partie des résultats les plus significatifs de la campagne concerne le premier état monumental maçonné (état antique 2), lui aussi déjà détecté l’an passé. Le fait que les éléments se répartissent largement dans l’espace laisse supposer qu’il s’agit d’un ensemble déjà imposant, quoique moins monumental que le suivant. En effet, pour partie, les aménagements liés à cet état rappellent ceux du dernier état antique, mais sous une forme moins imposante et semble-t-il plus réduite dans l’espace. Dans le détail, les procédés de mise en œuvre pour la réalisation des murs et des sols diffèrent également entre les deux états. Les aménagements de ce premier état monumental se distinguent notamment du suivant sous l’aspect de l’organisation et de la physionomie du dispositif d’entrée (l’utilisation mixte du bois et de la maçonnerie est également à souligner). Il est notable que l’orientation de l’entrée pérennise probablement un dispositif plus ancien remontant au début de l’époque julio-claudienne. On aurait ici un témoignage ponctuel de la résilience de l’organisation des lieux de culte antiques dans la durée, bien illustrée sur d’autres sites. Un point irritant concerne la datation de ce deuxième état antique, qui ne repose pour l’instant que sur des arguments indirects. Des éléments de mobilier céramique en relation avec cet état sont caractéristiques du deuxième tiers du Ier siècle de n.è. et il semble raisonnable de penser que la mise en place de ce premier état monumental a eu lieu vers le milieu du Ier siècle après J.-C. L’un des objectifs principaux de la campagne 2014, qui consistait à reconnaître et étudier les différents éléments constitutifs du système d’accès au temple de l’état antique 3, le plus monumental, a été largement rempli. L’étude des maçonneries a notamment permis de distinguer les différentes étapes de construction du sanctuaire de ce dernier état antique. Par ailleurs, les séries de mobilier liées au décor architectural du temple se sont encore accrues. Leur étude permettra d’avancer progressivement dans la restitution de l’ordonnancement architectural et décoratif du sanctuaire. Enfin, la connaissance des étapes tardives d’occupation du site, à l’époque médiévale, a progressé, sans toutefois que des informations décisives concernant la datation de l’enceinte fossoyée médiévale aient pu être apportées. Indirectement, la découverte d’installations appartenant à un nouvel état, daté de la période XIIIe-XVe siècles par un mobilier assez abondant et homogène, fournit un TAQ pour la fin du premier état médiéval. La présence d’éléments de mobilier céramique des XIe-XIIe siècles, issus malheureusement de remblais sans lien strict avec les structures du premier état, donne une indication générale qui devra être confortée par les recherches futures. Le théâtre du Haut du Verger – 2014.5 (resp. F. Ferreira) Les fouilles dirigées cette année dans le cadre du PCR mis en place nous ont donné l’opportunité de mieux saisir le cadre chrono-stratigraphique du théâtre du Haut-du-Verger. Construit au cours du premier siècle de notre ère, et probablement terminé à la fin de celui-ci, cet édifice ne sera utilisé qu’une centaine d’années. Au cours de cette brève période de fréquentation, certains signes de faiblesse avaient déjà pu être décelés, ce qui donna lieu à quelques reprises de maçonneries. Il connait également une dernière phase de monumentalisation entre la fin du IIe s. ap. J.C. et le début du IIIe s. ap.J.C avec l’adjonction d’une vaste salle à exèdre dans l’angle sud du bâtiment, rien ne permet encore de déterminer s’il existait la même salle en pendant du côté nord du mur diamétral. Rapidement abandonné dans la première moitié du IIIe s. ap. J. C., l’édifice fut rapidement réutilisé en tant que lieu d’approvisionnement en matériaux et ses structures d’accès furent profondément modifiées. L’écroulement du théâtre, survenu probablement au milieu du IIIe s., a définitivement scellé l’histoire du monument. Peu de traces de récupérations postérieures sont visibles et, outre les structures abimées par l’effondrement même de l’édifice, les maçonneries restent dans un état de conservation remarquable.
Dates des chantiers de fouilles : du 7 juillet au 15 août 2014
Financements : Ministère de la Culture (Drac), Région Bourgogne (DRRT)
Avec la participation de : Inrap, Bibracte EPCC, Ville d’Autun, Direction des services techniques de l’Autunois
Extension et organisation du complexe antique : le secteur artisanal – 2014.3 (resp. M. Thivet)


Si l’artisanat de la céramique semble être dominant, la présence d’indices de métallurgie et de tabletterie laisse entrevoir un quartier aux activités diversifiées. Ce constat est d’autant plus important que seuls 600 m² ont été sondés cette année sur un quartier dont l’extension maximale pourrait approcher des 2,5 hectares.
Sur l’emprise étudiée, la production de céramique est clairement orientée vers les services à boire et notamment la production de gobelet. On notera également la découverte exceptionnelle de plusieurs dizaines de moules destinés à la production en série de statuette en terre cuite blanche et dont l’étude approfondie sera engagée en 2015.
La limite d’extension du quartier vers l’est et le complexe monumental de la Genetoye, est marquée dans les premiers états d’occupation du site par la présence d’une voie orienté nord/sud et dont le tracé sera pérennisé pendant toute l’antiquité. Cette voie dont le tracé, vers le nord pourrait permettre d’accéder au théâtre, semble monumentalisée dans le courant du deuxième siècle, par la présence de deux murs bordiers. S’il est possible d’imaginer que ces deux murs espacés d’environ quatre mètres forment une galerie permettant localement l’accès au complexe monumental depuis le quartier artisanal, la récupération intégrale de ces maçonneries ne nous permet pas de le certifier.
La masse de données accumulées cette année, tout particulièrement sur les ensembles mobiliers, continuera d’être étudiée en 2015, et fera l’objet d’un rapport sur l’état d’avancement de cette étude dans le prochain rapport d’activité du PCR.


Là encore, il nous manque les informations permettant de caler en chronologie absolue ces différentes étapes. L’état antique 3 débute durant la seconde moitié du Ier siècle de n.è., sans qu’il soit possible pour l’instant d’être plus précis. De nombreuses phases de travaux et de remaniements affectent le sanctuaire, mais ne peuvent être datées précisément. Le matériel présent dans des remblais liés aux reconstructions appartient à la période flavienne.
Dans la dernière phase de reconstruction observée, à l’est de la cella, au niveau de la jonction entre la galerie et le vestibule, des fragments de chapiteaux corinthiens datables de l’époque flavienne, réemployés dans la maçonnerie suggèrent que ces travaux commencent vers le début du IIème siècle. Quelques fragments de céramiques provenant en particulier de la couche de destruction nous orientent vers une datation similaire et attestent l’utilisation du temple durant la première moitié du IIème siècle, au moins.
Concernant la chronologie de la fin de l’entretien et de l’abandon du lieu de culte, aucun élément nouveau ne vient préciser les observations réalisées en 2013, à partir des données monétaires, témoignant d’une fréquentation du site jusqu’au troisième quart du IVème siècle au plus tard.


concernant l’utilisation du lieu au cours de la période tibéro-claudienne, il serait nécessaire de préciser le plan du monument antérieur dont des fondations ont été observées. On peut également se demander si le reste du monument présente les mêmes séquences stratigraphiques : concernant les agrandissements successifs du monument, ou encore la monumentalisation de son angle sud notamment. Il serait ainsi possible de distinguer un véritable projet de construction uniforme sur l’ensemble du monument de (re)constructions ponctuelles.
L’occupation celtique de la plaine du Po : le territoire de Verone (Italie) / Campagne 2014

Responsable scientifique : Daniele Vitali Partenaraires : Nicola Bianca Fàbry (Chercheur Independent) ; Thierry Lejars (AOROC, UMR 8546) ; Wolfgang Teegen (Université de Munich) ; Patrice Méniel (ArTeHiS) ; Jean-Paul Guillaumet (ArTeHiS) ; Anna Marinetti & Patrizia Solinas (Université Ca’ Foscari, Venise) ; Federico Biondani (Padoue) ; Marta Rapi (Université de Milan) ; Sandra Jaëggi (Université de Fribourg, CH) ; P. Onisto (Université de Ferrare) ; Associazione A. Balladoro, Povegliano Veronese ; Comune di Povegliano Veronese ; Province de Vérone ; Région du Veneto ; Fondazione Cariverona ; OTKA , Hong Entre 2007 et 2009, une étude systématique consacré aux Celtes du territoire de Vérone (les Cénomanes) a été lancée par l’Université de Bologne, la Surintendance Archéologique du Veneto, l’ELTE de Budapest, et l’Associazione Balladoro de Povegliano Veronese, à partir de la fouille programmée d’une importante nécropole localisée à quelques centaines de mètres du chef-lieu, au lieu-dit “Madonna dell’Uva Secca- Ortaia » qui avait donné d’importants résultats au début des années ’90. Les fouilles programmées 2007-2009, dont les protagonistes sont les universités de Bologne et de Budapest, leurs étudiants ainsi que d’étudiants d’autres universités européennes, ont acquis un dossier de 174 nouvelles tombes, presque exclusivement de type laténien et gallo-romain : 50 incinérations et 112 inhumations. Plusieurs objet de luxe ou de prestige en argent permettent aussi d’esquisser quelques lignes d’histoire de l’art laténienne à cette époque « tardive » (Fàbry, 36é Colloque AFEAF, Vérone). Plusieurs graffiti et inscriptions sur les corps des céramiques ont été étudiées par P. Solinas et A. Marinetti, de l’Université de Venise : plusieurs noms individuels et les formes de la langue nous indiquent clairement que nous sommes en présence de celtophones ainsi que d’onomastique celtique, ce qui constitue un élément d’éxceptionnalité même dans la Cisalpine ; identité celtique dans un contexte romanisé. Cette nécropole est dès maintenant la plus importante de l’Italie du nord, pour les périodes de LT C2-D1-D2 et elle devient –avec les autres du territoire véronais dont le collègue Luciano Salzani de la Surintendance Archéologique du Veneto a été l’éditeur, une des références majeurs de l’archéologie du La Tène final. La présence importante de tombes d’enfants, à peu-près 2/3 du total est un élément assez unique. Le but de cette recherche (qui a suscité le 36è colloque de l’AFEAF à Verone en 2013) est bien sûr celui de l’étude critique et de l’édition scientifique, mais aussi celui de l’inauguration d’un nouveau musée archéologique, à Povegliano Veronese même, dans la Villa Balladoro.
En 1992-1993 plusieurs nécropoles appartenant à des époques différentes avaient été découvertes dans les mêmes terrains au cours d’une fouille de sauvetage : au total 432 tombes (282 incinérations, 145 inhumations) entre lombards, romains et celtes.
Une des tombes celtiques les plus riches à double incinération emblématique de la situation et bien connue par la littérature, était la n. 225 : la seule dont le mobilier restauré et partiellement publié montrait un assemblage remarquable et complexe : vaisselle céramique, métallique (situles du type Eggers 20 et 22, poelons du type Povegliano et Aylesford, louches du type Pescate), armement (épées et fourreaux laténiens, lances, boucliers) et parures, ainsi que plusieurs deniers romains en argent frappés du 135, 126, 124 av. n. è. et sans marques d’usure : 123 av. J.-C. le terminus post quem de référence pour cette sépulture.
Dans cette nécropole bi-rituelle, les incinérations sont presque toujours associées à des armes en fer et marquent le statut du guerrier ; les inhumations ne sont jamais associées aux armes ; 70% du total des inhumés correspond à des tombes d’enfants dont le 60% décédés à une âge inférieur à 1 an.
Onze tombes sont remarquables par leur taille et par leur structure (T. 6, 24, 36, 37, 38, 56, 96, 191, 136, 173, 190) : une grande fosse, d’environ 8 mètres carrés, contient un coffrage en bois, avec le/les défunt/s et le mobilier ; elle est délimitée à la surface du sol antique par un fossé annulaire, qui devait renfermer un tumulus, disparu au cours du temps.
La présence de cet élément visible pendant plusieurs temps a favorisé le saccage d’environ 50% des tombes, à une époque difficile à préciser (romaine, lombarde ?).
Ces tombes remarquables sont concentrées en deux-trois groupes et rejoignent d’autres tombes similaires découvertes en 1992-1993.
Le mobilier métallique est presque toujours dé-fonctionnalisé : les armes, les fibules, la vaisselle métallique, les outils. Les armes appartiennent aux types laténiens du LT C2 et LT D1 : lames d’épées et les fourreaux respectifs, les boucliers avec les umbos à ailettes rectangulaires ou à demi-lune (type Mokronog). C’est Th. Léjars (AOROC Paris) qui est chargé de leur étude.
Les armes indiquent l’existence d’une composante guerrière celtique (au moins une vingtaine de guerriers), très significative en Cisalpine, à une époque à laquelle cette dernière apparaît « romanisée » depuis quelques générations.
Sont bien connus le rôle et l’importance de la composante guerrière des Cénomans qui ne renoncèrent jamais à la prérogative du port des armes, malgré la pax romaine en cours.
En 187 av . J.-C. les aristocrates cénomans protestèrent auprès du Senat de Rome parce que le préteur M. Furius Crassipedes leur avait séquestré les armes : Rome ne pouvait pas se permettre une rupture avec ses alliés Cénomans et donc le préteur fut démenti et les armes restituées : Celtes oui mais aussi hommes libres et indépendants, avec leur identité.
Ces armes donc restèrent pendant plusieurs décennies le marqueur de l’élite cénomane jusqu’à la fin du IIe- premiers décennies du Ier. s. av. J .-C.
Le croisement des données typo chronologiques de différentes classes de matériaux associées dans les mobiliers (fibules laténiennes, en fer, bronze, argent ; monnaies romaines en bronze et en argent, monnaies gauloises (« drachmes massaliotes »), et des formes céramiques nous ont permis d’établir une grille chronologique, fondamentale pour la Cisalpine orientale.




Parmi les quelques particularités des objets déposés dans les mobiliers, nous signalons une petite balance en bronze pour orfèvre / atélier monétaire ; des outils témoignant le travail ou les activités agricoles exploitées dans les campagnes environnantes (forces, faucilles, herminettes, haches) ; des strigiles denonçant l’importance culturelle du gymnase ; un set de pions en os et des astragales de cochon denonçant une fonction spéciale du titulaire de la tombe.
Elle est aussi un point de raccordement important pour le monde transalpin septentrional et oriental de l’époque et de la civilisation des oppida ; armement, parures vestimentaires, vaisselle métallique, constituent des éléments communs à cette époque, qui ont une circulation capillaire dans une Europe qui vit et traverse une sorte de première globalisation.
L’étude de ce type particulier de sépulture, assez rare à trouver dans une nécropole antique et aussi difficile à identifier dans le terrain à cause de la petite taille de la fosse et de la fragilité des squelettes, a été confiée à Wolfgang Teegen.
Fouilles d’Albinia (Italie) / Campagne 2014

Responsable scientifique : Daniele Vitali Soutiens : Entre 2000 et 2009, dix campagnes de fouilles archéologiques se sont déroulées sous ma direction dans l’atelier romain d’amphores découvert à Albinia, en province de Grosseto (Toscane), sur la côte tyrrhénienne, à une dizaine de kilomètres à vol d’oiseau de la colonie romaine de Cosa. L’atelier d’Albinia, dont nous avons publié jusqu’à aujourd’hui quelques rapports préliminaires, et quelques articles de synthèse, est un complexe industriel parmi les plus importants de l’Italie romaine : avec son extension d’environ 3.000 mètres carrés, et une épaisseur stratigraphique de 2,20 m., intégrée dans un contexte de port maritime, port fluvial et réseau viaire terrestre (Voie consulaire Aurelia). Pendant les presque deux siècles d’activité (dernières décennies du IIe s. av. J.-C. – deuxième quart du Ier s. de n. è.), il a produit plusieurs centaines de milliers, voire quelques millions d’amphores, utilisées pour transporter les vins de la plaine de l’Albegna et de l’Ager cosanus en direction des Gaules ; des vins destinées à une consommation plus ou moins élitaire, avec une intensité et une continuité variées dans les temps, dont témoignent les découvertes archéologiques dans plusieurs sites (oppida, fermes, lieux de culte) en Bourgogne. Plusieurs centaines de milliers de fragments d’amphores découverts dans les oppida, les habitats des Eduens et des peuples clients et limitrophes (Sequanes, Arvernes, Lingons, Mandubiens), (Bibracte, Cabillonum, Matisco, Alesia, spécialement) confirment le lien de la Bourgogne et du Nivernais avec les régions viticoles d’Italie entourant Albinia. Non seulement les formes et les pâtes des amphores attestent de ce lien mais aussi les timbres amphoriques qui marquèrent la structure de la production d’Albinia et de l’ager cosanus, et que nous trouvons ponctuellement dans les lieux de consommation. Parmi la masse énorme des ratés de cuisson d’Albinia, nous avons identifié un Corpus de 666 timbres amphoriques, lequel -à l’état actuel des études- constitue un des Corpora majeurs de la Méditerranéenne antique. Le dossier « Albinia » représente un unicum et sa systématisation, son organisation et sa mise en forme pour la publication donneront un apport fort substantiel à nos connaissances d’histoire économique et sociale concernant les contacts entre le monde romain et les peuples de la Gaule avant et après la conquête. Cette fouille, qui a eu une durée totale de 30 mois, a produit et accumulé une documentation considérable de fiches d’UF, de plans et de dessins, qui attendent une présentation définitive. Deux mémoires de Master ont été réalisées sous ma direction en 2013 et 2014 à l’UB- UFR Sciences Humaines, pour essayer de progresser dans le travail (M. RIOU, La production des céramiques communes de l’atelier d’Albinia, du IIe s. av. J.-C. au Ier s. après J.-C., Master MAM- HAMA). Bibliographie essentielle : 2013- VITALI Daniele, BENQUET L., FABRY N.B., Albinia e i Galli, Colloquio Internazionale Grosseto, (CELUZZA M.G., a cura di), sous impression. 2013- VITALI Daniele (BENQUET L. – LAUBENHEIMER F.), Nouvelles données sur l’atelier d’amphores d’Albinia (Orbetello, Italie) : campagnes de fouille 2003-2006, dans Itinéraires des vins romains en Gaule. IIIè – Ier siècles avant J.-C. Confrontation de faciès, Actes du Colloque de Lattes(30 janvier- 2 février 2007) F. OLMER (éd.), MAM – HS n°5, 2013, p. 513-529 2011-2012- VITALI D, Albinia, Atlante dei siti di produzione ceramica (Toscana, Lazio, Campania e Sicilia) con le tabelle dei principali relitti del Mediterraneo occidentale con carichi dall’Italia meridionale, IV secolo a.C.- I secolo d.C., in G. OLCESE (éd.), Immensa Aequora 2, Roma 2011-2012, p. 48-54. 2007- HILL M. J., LANOS P., CHAUVIN A., VITALI D., LAUBENHEIMER F. — An archaeomagnetic investigation of a Roman amphorae workshop in Albinia (Italy). Geophysical Journal international, 2007, 169, 2, p. 471-482. 2007- CAPELLI C., CABELLA R., PIAZZA M., VITALI D. — La produzione di ceramica romana dell’atelier di Albinia (GR) : nuovi dati archeometrici. In : D’AMICO C. (éd.). — Atti del IV Congresso Nazionale di Archeometria, Pisa, 1-3 febbraio 2006. Bologna : Pàtron, 2007, p. 465-472. 2007- PIAZZA M., CABELLA R., VITALI D. — Le strutture murarie dell’atelier di ceramica romana di Albinia (GR) : considerazioni geologico-petrografiche. In : D’AMICO C. (éd.). — Atti del IV Congresso Nazionale di Archeometria, Pisa, 1-3 febbraio 2006. Bologna : Pàtron, 2007, p. 183-190. 2006- VITALI D. — VOLVS da Albinia. OCNUS, 2006, 14, p. 237-242, 7 fig., rés. en angl., bibliogr. (4 réf.). 2006- VITALI D. (éd.). — Le fornaci e le anfore di Albinia : primi dati su produzioni e scambi dalla costa tirrenica al mondo gallico : atti del seminario internazionale, Ravenna, 6-7 maggio 2006. Bologna : Università di Bologna, Dipartimento di archeologia, 2007. 206 p., ill. bibliogr. (dissém.). (Albinia 1). ISBN 88-6113-099-2 et 978-88-6113-099-9 2004- VITALI D., LAUBENHEIMER F., BENQUET L. — Albinia (prov. de Grosseto). Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité, 2004, p. 14 – 31. 2004- COTTAFAVA E., VITALI D. — Albinia, gli impianti produttivi. In : GUAITOLI M. T. (éd.), MARCHETTI N. (éd.), SCAGLIARINI D. (éd.). — Scoprire : scavi del Dipartimento di archeologia : catalogo della mostra, Bologna, S. Giovanni in Monte, 18 maggio-18 giugno 2004. Bologna : Ante Quem, 2004, p. 106-109. (Studi e scavi. Nuova serie ; 3). 2004- LAUBENHEIMER F., VITALI D. — Albinia, l’economia del vino : dalle produzioni alla diffusione. In : GUAITOLI M. T. (éd.), MARCHETTI N. (éd.), SCAGLIARINI D. (éd.). — Scoprire : scavi del Dipartimento di archeologia : catalogo della mostra, Bologna, S. Giovanni in Monte, 18 maggio-18 giugno 2004. Bologna : Ante Quem, 2004, p. 109-114. (Studi e scavi. Nuova serie ; 3). 1999- VITALI D. — Les sources archéologiques et historiques sur l’aristocratie de la Gaule cisalpine. In : GUICHARD V. (dir.), PERRIN F. (dir.). — L’aristocratie celte à la fin de l’Age du Fer (IIe s. avant J.-C., Ier s. après J.-C.) : table ronde, Glux-en-Glenne, 1999. Glux-en-Glenne : Centre archéologique européen du Mont Beuvray, 2002, p. 15-28, 2 fig., bibliogr. p. 27-28. (Bibracte ; 5)
Partenaires : Université de Bologne-Italie ; Soprintendenza ai Beni archeologici della Toscana ; Comune di Orbetello (Grosseto) ; Università di Siena- Italie ; Università di Genova ; Ecole Française de Rome ; Collège de France-Paris ; Centre Archéologique européen de Bibracte ; UMR 6298 ; UMR 5608 TRACES Toulouse / Inrap ; Région Bourg
L’UMR 6298 ARTEHIS et le programme FABER de la Région Bourgogne ont soutenu jusqu’à l’année dernière quelques étapes complémentaires de ce programme :
dossier préliminaire des timbres amphoriques
homogénéisation des listes des unités de fouille.
Le Centre Archéologique Européen de Bibracte s’est chargé aussi d’autres tâches concernant ce dossier : mise en forme de la plus grande partie de la cartographie de la fouille.
Notre objectif est celui de reprendre de manière frontale le dossier et continuer l’emprise jusqu’à son achèvement.
En 2004 et 2005, un programme de recherche national avec plusieurs partenaires universitaires et d’autres institutions scientifiques concernées, s’est déroulé en Italie, sous ma direction ( « Fabbricanti di anfore e produttori di vino : archéologie ed economia del vino tra l’Etruria romana e il mondo gallico (II sec. a.C. – I sec. d. C.) (www.ricercaitaliana.it/…/dettaglio_prin-20041085) (2004-2005).
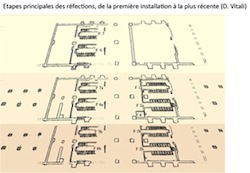

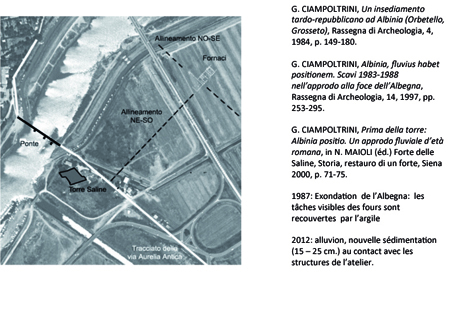
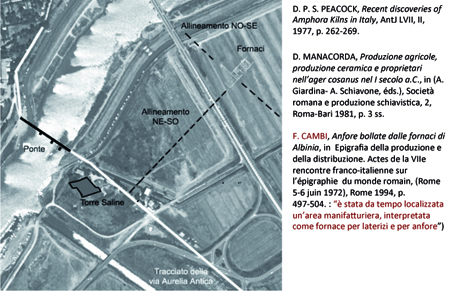

D’autres domaines viticoles italiens apparaissent en réseau avec la Gaule (par exemple ceux du Latium et de la Campanie côtières) mais la région d’Albinia est largement prédominante.
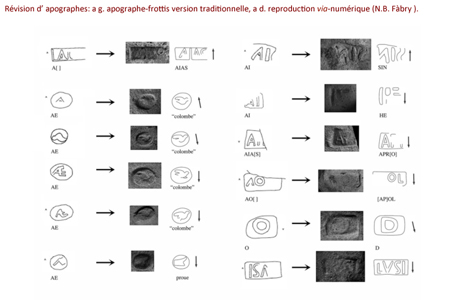
Plusieurs cargaisons jamais arrivées à destination dont témoignent de nombreuses épaves (v. Fos-sur-Mer) nous donnent l’ampleur des volumes de denrées embarquées dans les ports d’Albinia-Cosa à destination de la Gaule.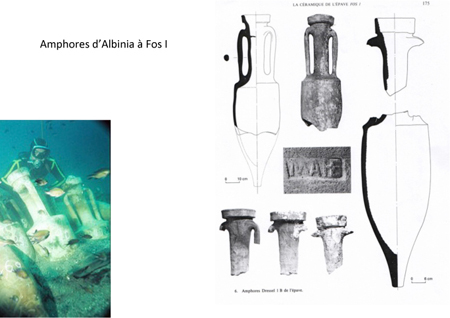
Le texte de synthèse que nous sommes en train de préparer prévoit l’analyse et l’exploitation critiques de toute la documentation accumulée.
D’autres chercheurs déjà impliqués dans le passé par les apports multidisciplinaires de leur compétence (analyses minéro- pétrographiques, sédimentologie, paléobotanique, archéozoologie, magnétométrie, épigraphistes…) seront ultérieurement concernés.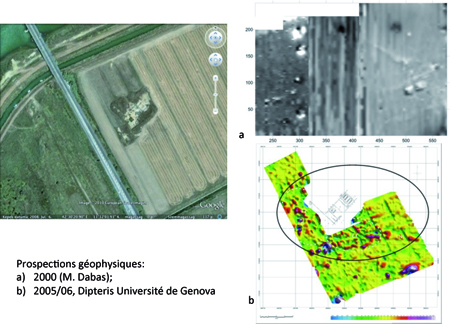
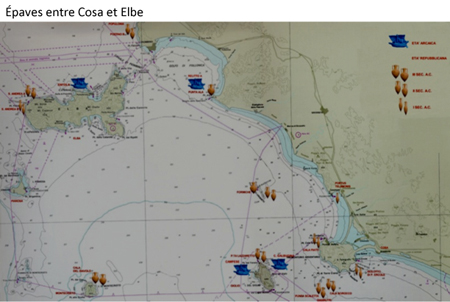
2005- VITALI D., LAUBENHEIMER F., BENQUET L., COTTAFAVA E., CALASTRI C. — Le fornaci di Albinia (GR) e la produzione di anfore nella bassa valle dell’Albegna. In : CAMILLI A. (éd.), GUALANDI M. L. (éd.). — Materiali per Populonia. 4. Firenze : All’Insegna del Giglio, 2005, p. 259-279. (Quaderni del Dipartimento di Archeologia e Storia delle arti dell’Università di Siena ; 61).
Programme de recherche : Loire amont et moyenne / campagne 2014

Evolution du système ligérien et des occupations humaines au cours des deux derniers millénaire. Quatre fenêtres : de Digoin à Nevers – La Charité/La Chapelle Montlinard – de Saint-Satur à Cosne/Boulleret – Briare/Brisson-sur-Loire. Ce programme de recherche intègre des prospections et des sondages dans les chenaux actifs, des recherches en archives, une étude du bâti de La Charité (arches de pont dans les caves), et l’étude géomorphologique du secteur La Charité/La Chapelle Montlinard. Les actions dans les chenaux actifs de la Loire qui avaient été annulées en août 2013, n’ont pas pu être menées à bien en 2014 en raison des conditions climatiques et hydrologiques exceptionnelles de ces deux années. Les moyens mis à notre disposition ont été consacrés au secteur de La Charité-sur-Loire (géomorphologie, étude du bâti et des archives). On sait maintenant, grâce aux recherches menées dans les archives médiévales, qu’un pont existait déjà sur la Loire, près de La Chapelle-Montlinard, au XIIe siècle, soit un siècle avant les premiers vestiges datés de 1249, découverts dans le petit chenal. Il est possible que ce pont du XIIe siècle se trouve dans un des paléochenaux visibles dans la plaine d’inondation, mais il a également pu être entièrement détruit par les mouvements du fleuve. Publications en ligne : Évolution des ponts et du lit mineur de la Loire, entre La Charité-sur-Loire et la Chapelle-Montlinard », Développement durable et territoires, vol. 5, n°3 | décembre 2014.[En ligne] Les prospections dans le lit de la Loire, entre La Chapelle-Montlinard (Région Centre, dép. Cher) et La Charité-sur-Loire (Région Bourgogne, dép. Nièvre). BUCEMA (Centre d’études médiévales Auxerre), 15, 2011, p. 51-54. [En ligne] Patrimoine immergé : la vie quotidienne en bord de Loire (Auvergne, Bourgogne, Centre). Archéologie en Bourgogne n° 26, 2011. [En ligne]
Responsable :Annie Dumont (Ministère Culture-DRASSM et UMR6298)
Intervenants : Philippe Moyat (ETSMC, UMR 6298) : responsable hyperbare, prospections subaquatiques, photographies, relevés de terrain, sondages, traitement de données en DAO ; Jean-Pierre Garcia (UB, UMR 6298) : encadrement des études de géomorphologie ; Ronan Steinmann (doctorant U Bourgogne, UMR 6298) : responsable des études de géomorphologie ; Morgane Cayre, contractuelle : prospection dans les chenaux, transcription d’archives, sondages ; Marion Foucher , doctorante et contractuelle : étude des arches du pont médiéval de La Charité ; Aurélia Bully], contractuelle : recherche sur les archives médiévales ; Yvan Robin (3D SCAN MAP) : relevés topographique, traitement des données du bâti.
Financements : Union européenne (FEDER), Université de Bourgogne, Ministère de la Culture (SRA Centre et Bourgogne ; DRASSM), Région Centre et Etablissement public Loire.
Dates de réalisation : juin 2013 – décembre 2014
Un bras méandriforme existe dès le XIIIe siècle, en plus du chenal franchi par le pont de bois daté par la dendrochronologie de 1249. Il est donc possible que d’autres structures de franchissement aient été implantées sur une Loire à plusieurs bras actifs.
Autre donnée importante, livrée par l’analyse du bâti ancien conservé dans les caves des maisons situées dans l’axe du pont, un pont en pierre a existé entre la rive droite et l’île du Faubourg avant 1520, date à laquelle était attribuée jusqu’à présent la première construction d’un ouvrage en pierre. Ce premier état de pont est à placer après la destruction du pont en bois de 1249 et avant le XVe siècle, date de construction des maisons dont les fondations reposent sur des arches de pont. C’est le début du Petit Âge Glaciaire qui semble avoir provoqué une métamorphose fluviale ayant pu nécessiter la construction d’un nouveau pont dès le XIVe siècle. C’est à ce moment que se fixe l’axe de franchissement qui perdure aujourd’hui, l’île et les berges, même si par la suite le chenal perd en largeur suite à la construction des digues et des quais.
Sans reprendre en détail toutes les données collectées, on voit bien, à travers les documents d’archives analysés, que les ponts des époques médiévale et moderne semblent plutôt soumis aux actions climatiques extrêmes, même si leur construction est dotée de dispositifs destinés à les protéger des actions guerrières des hommes. Au cours de la période contemporaine, l’homme est plus violent que la nature, et les dommages commis aux ponts sont plus fréquemment les conséquences des guerres. De nombreux bois de fondation ainsi que des éléments de piles en pierre, témoignant de l’histoire mouvementée de ce franchissement, sont visibles aux abords et sous le pont actuel qui franchit le petit chenal.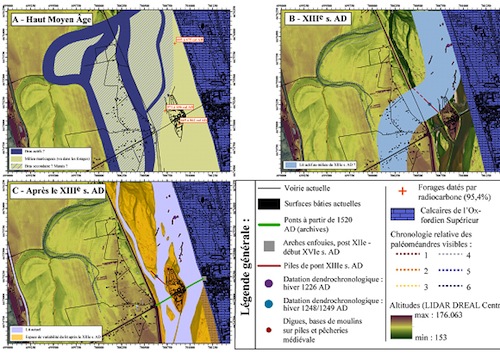
Fouille subaquatique pluri-annuelle du moulin sur bateaux de Sermesse (71) dans le Doubs / campagne 2014

Responsable : Annie Dumont (Ministère Culture-DRASSM et UMR6298 ARTEHIS) La campagne de fouille 2014, première de l’opération triannuelle, a permis de poursuivre le dégagement, le relevé et l’étude de la coque du forain, le plus petit des deux bateaux ayant supporté le moulin flottant (voir résumé 2013). Les cinq premiers mètres, soit près de la moitié, avaient été dégagés en 2012, et il était prévu de le dégager entièrement en 2014. Le fort pendage de l’épave, la découverte sur l’arrière d’un arbre complet de grande dimension, et l’arrivée d’une crue en fin de chantier n’ont pas permis d’atteindre complètement cet objectif. Cependant, à l’issue de cette campagne, on dispose des principales caractéristiques architecturales du bateau. D’un point de vue méthodologique, la restitution en 3 D de l’épave a été réalisée selon le processus suivant : les bois constituant l’épave ont été numérotés au fur et à mesure de leur dégagement. Certaines parties de la coque ont fait l’objet d’un dessin classique, ou d’un croquis annoté, sur planchette PVC (coupes des renforts transversaux notamment), d’autres, présentant un caractère ponctuel, comme les réparations, ont été photographiées afin ensuite, d’être redessinées en DAO ; enfin, les points de jonctions des différents bois, les éléments principaux de l’épave, ont été relevés en x, y, z. Ces cotes ont ensuite été intégrées dans le logiciel VectorWorks, puis exportées dans le logiciel de traitement 3D Sketchup, d’où sont extraites la plupart des vues. En 2014, nous avions comme objectif de réaliser également une couverture photographique intégrale de la coque, avec des repères, afin de traiter ces photos dans le logiciel de restitution 3D Photoscan. Cependant, les mauvaises conditions de visibilité que nous avons connues en juin, liées à la montée très rapide de la température de l’eau, n’ont pas permis de réaliser ce travail. Les analyses radiocarbone effectuées au cours des campagnes précédentes sur les pieux (1435-1631 ; 1450-1640 ; 1480-1650) et sur l’épave du forain (1460-1640) plaçaient cet ensemble cohérent dans la fourchette XVe-XVIIe siècle. L’analyse de l’abondant mobilier céramique présent aux abords immédiats du moulin, en surface des sédiments ou à l’intérieur des deux coques tend à préciser cette datation entre la fin du XVIe siècle et le tout début du XVIIe siècle. Parmi les objets métalliques découverts en 2014, on compte des appes (agrafes), de tailles différentes, détachées de la coque. Deux nouveaux outils viennent compléter la série déjà collectée : il s’agit d’une serpette et d’une hache de charpentier appelée doloire ou épaule de mouton, dont la douille est facettée et décorée d’une estampille. Enfin, la coque du forain, dans laquelle on avait découvert, en 2012, deux récipients métalliques (un pichet en étain et une marmite en fonte) ainsi que des balances romaines bloqués contre la membrure 5, a livré cette année trois nouveaux récipients métalliques. Une écuelle en étain et deux marmites en fonte se trouvaient contre la membrure 7.
Intervenants : Philippe Moyat (ETSMC, UMR6298) : responsable hyperbare, photographie et traitement 3D ; Carole Vélien (contractuelle) : étude du mobilier céramique et métallique ; Archéologues-plongeurs : Duncan Le Cornu, Morgane Cayre, Claire Touzel ; Aide bénévole à terre : Jean-Pierre Vérot
Financement : Ministère de la Culture (SRA Bourgogne et DRASSM), Région Bourgogne (reliquat PARI 2013), BQR Pres (Universités Bourgogne et Franche-Comté). Aide de la mairie de Saunières.
Ce forain est un bateau à fond plat, constituée de planches en chêne assemblées à franc-bord, étanchéifiées par un calfatage à la mousse végétale, et renforcé par des membrures clouées et chevillées. Il s’inscrit dans un schéma de construction bien connu sur tous les cours d’eau européens, et sur la Saône en particulier, même s’il présente quelques particularités ou différences (voir par exemple l’épave de Saint-Marcel sur la Saône, ou l’épave XVIIIe s. du parking Saint-Georges à Lyon). 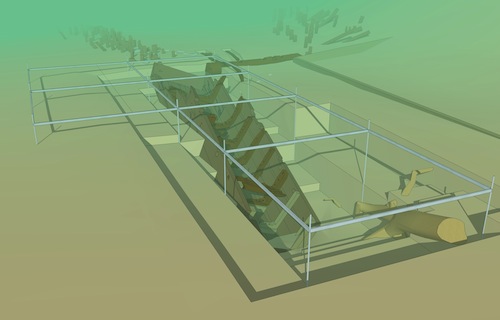
Vert-la-Gravelle (Vert-Toulon) « La Crayère » (Marne). Nécropole d’hypogées et minière de silex / campagne 2013

Nom du site : Vert-la-Gravelle (Vert-Toulon) « La Crayère » (Marne) Redécouvert par Joseph de Baye en 1873-1874, puis par André Loppin et André Brisson dans les années 30, le site avait été oublié jusqu’à une nouvelle redécouverte en juin 2012, grâce à la population locale. En 2013, deux nouveaux hypogées et deux puits d’extraction de silex du Néolithique récent (3500-3000 avant notre ère) ont été remis au jour. Le site semble divisé en deux parties : la nécropole d’hypogées à l’est et la minière à l’ouest. Outre le caractère exceptionnel des monuments redécouverts, la fouille permet de relancer la problématique d’occupation de la région des marais de Saint-Gond (Marne). L’exploitation du silex grâce à des puits de mines de plusieurs mètres de profondeur pourrait en effet expliquer en partie l’attractivité du secteur où sont concentrés plus de 120 hypogées néolithiques. Objectifs de la campagne 2013 : 1. Sondages sur la minière de silex de « Lessard » à Coizard. 2. Étude de la nécropole d’hypogées de « La Crayère » à Vert-la-Gravelle (Vert-Toulon). Les campagnes de fouilles 2013-2015, dirigées par Rémi Martineau (CNRS, ArtTeHiS, Dijon), sont financées par la DRAC/SRA Champagne-Ardenne (Ministère de la Culture) et ont été très soutenues par les communes de Vert-la-Gravelle/Vert-Toulon et de Coizard-Joches, mais aussi par leurs habitants.
Date de fouilles : du 29 juillet au 23 août 2013
Responsable : Rémi Martineau (CR CNRS – UMR 6298 ArTeHiS)
Participants de l’UMR 6298 ArTeHiS : Anthony Dumontet et Jehanne Affolter
Participant de la MSH de Dijon : Laure Saligny
Évaluation du potentiel archéologique, fouilles de structures, relevés, dessins, photos, prospections géophysiques.
Dégagement des hypogées pour permettre leur étude (coupes, relevés, photos …), sondages autour des monuments, prospections et relevés GPS des structures.
Les fouilles programmées sur le complexe antique d’Autun « La Genetoye », premiers résultats / été 2013

Nom du site : « La Genetoye » (Autun, 71) Le site La zone d’investigations, d’une centaine d’hectares, est située à la confluence entre les rivières Arroux et Ternin, à proximité de l’enceinte d’Autun – Augustodunum, capitale des Eduens à l’époque romaine. Elle se révèle extrêmement riche et son occupation s’inscrit résolument dans la longue durée. On y rencontre une vaste enceinte de plaine de l’époque néolithique et des indices d’occupation protohistoriques (Age du Bronze et second Age du Fer). Le site est surtout connu pour ses vestiges antiques et son complexe cultuel, probablement l’un des plus monumentaux du territoire des Trois Gaules, encore dominé par les vestiges en élévation du temple dit « de Janus ». Campagne 2013 Une campagne d’évaluation chrono-stratigraphique a été menée au cours de l’été 2013 sur trois secteurs du complexe antique : les abords du temple dit « de Janus » (resp. M. Joly, U. Paris-IV ; Ph. Barral, UFC) ; le théâtre de la Genetoye (resp. F. Ferreira, U. Paris-IV) et la périphérie du complexe cultuel, frange occidentale (resp. P. Nouvel, UFC ; M. Thivet, UFC ; Y. Labaune, SAVA). Cette campagne confirme le potentiel archéologique fort du secteur. L’existence d’un substrat d’occupation protohistorique bien constitué, à l’âge du Bronze final et à l’extrême fin de l’âge du Fer a pu être mise en évidence (on ne connaissait d’ailleurs pas jusqu’à présent, à Autun, d’occupation contemporaine de celle de Bibracte, la capitale gauloise des Eduens) ; l’état de conservation des vestiges s’avère excellent (puissance stratigraphique supérieure à deux mètres aux abords du temple dit de Janus) ; enfin, les vestiges inédits de la fortification du temple au Moyen-âge (notamment un réseau fossoyé ceinturant la cella) sont susceptible d’expliquer son état de conservation. Perspectives Un nouveau chantier sera ouvert dès 2014 au niveau de l’enceinte néolithique (resp. O. Lemercier, UB). Les trois chantiers engagés sur le complexe d’époque romaine réoccupé à l’époque médiévale sont amenés à se poursuivre jusqu’en 2015 grâce à des équipes renforcés et des moyens mécaniques adaptés.
Date de fouilles : été 2013
Responsable : Yannick Labaune
Participation de :
A. Quiquerez : Approche géo-archéologique et paléo-environnementale de la zone de confluence Arroux-Ternin
J.-P. Guillaumet : Recherches documentaires, Base de données, Système d’Informations Géographiques
F. Delencre, F. Ducreux, M. Kasprzyk, S. Mouton-Venault, N. Tisserand : Etudes spécialisées
Trois axes de recherches ont été privilégiés :
• Analyser l’évolution du milieu naturel et d’évaluer les modalités d’aménagement de ce terroir contraignant, un secteur inondable.
• Comprendre la dynamique et les formes d’occupation humaine de la Préhistoire jusqu’au Moyen-âge.
• Appréhender le complexe cultuel antique à travers son développement, les pratiques cultuelles qui y sont observées et son organisation sur le temps long, sa relation avec la ville antique et sa périphérie (quartier artisanal, nécropoles, établissements ruraux) et les modalités de son abandon.
Ainsi, le programme bénéficiera dès 2014 de quatre chantiers-écoles des universités de Bourgogne, Franche-Comté et Paris-Sorbonne, permettant aux étudiants – chose rare – de s’initier sur un même site à la fouille de vestiges couvrant un spectre chronologique large, de la Préhistoire récente au Moyen-âge. Une attention toute particulière est en outre portée à l’harmonisation des pratiques et des enseignements des différentes équipes universitaires engagées dans le cadre des PRES Bourgogne-Franche Comté et Sorbonne-Université.
La prospection subaquatique dans le Doubs – 1 : le moulin sur bateaux de Sermesse (71)/ campagnes 2012-2013

Nom du site : le moulin sur bateaux de Sermesse (71) Le site A l’issue des campagnes de prospection subaquatique de 2010 et 2011, un ensemble de structures ayant servi à faire fonctionner un moulin flottant a été identifié à Sermesse, contre la rive gauche, à une profondeur de 3 à 4 mètres. En 2012 et 2013, deux sondages très limités ont été effectués afin de connaître le potentiel de ce site et son état de conservation. Perspectives 2014 Le relevé et les observations effectués sur la grosse pièce de bois située en amont des deux épaves montrent un potentiel de datation dendrochronologique, le tronc de chêne utilisé n’étant équarri que sur une face a conservé son aubier sur la partie qui n’est pas exposée au courant. Le dégagement d’une petite surface montre que d’autres bois sont assemblés à cet élément et qu’une fouille de l’ensemble sera nécessaire pour en garantir la compréhension (passerelle et système de liaison entre les deux bateaux ? Dispositif lié à la capture du poisson placé à l’extrémité de la digue ?).
Date de fouilles : septembre 2012 et juin 2013
Responsable : Annie Dumont
Participation de : Philippe Moyat (ATSMC et UMR6298) : responsable hyperbare, relevé et prises de clichés sous l’eau.Claire Touzel (UMR 6298)Jonathan Letuppe (Evéha) : dessins des bateaux.Carole Vélien (contractuelle) : étude du mobilier céramique.Céline Bonnot-Dicone (C2RC) : étude des cuirs.
Financements : Ministère de la Culture (SRA Bourgogne et DRASSM), Région Bourgogne (PARI 2012 et 2013)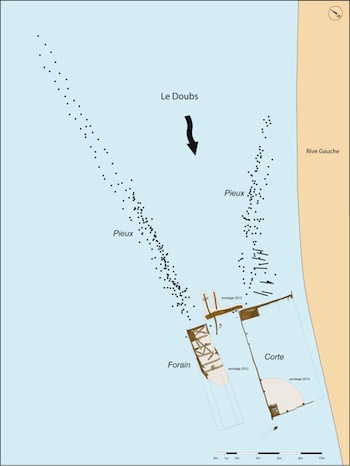
Le gisement comprend deux lignes de pieux, appelées benne, destinées à diriger l’eau sur la roue du moulin, et deux coques de bateau : l’une de petites dimensions, le forain, et une grande embarcation ayant supporté le mécanisme, la corte. Il s’agit d’un type de moulin très répandu en Europe pendant toute la période médiévale et moderne, mais sur lequel on ne possède pas de données archéologiques. Des maquettes ont été réalisées à partir des derniers exemplaires qui ont existé jusqu’au début du XXe s. (comme la maquette du Musée de Pierre de Bresse par exemple), et quelques-uns ont été préservés en Europe Centrale ou de l’Est. A Sermesse, on a la chance de disposer d’une structure datant de l’époque moderne pré-industrielle. La coque du forain est en partie dégagée du sédiment, alors que celle de la corte se trouve encore enfouie sous le talus de la berge. En surface des sédiments, des bois travaillés et des outils sont visibles, montrant à la fois la bonne conservation de l’ensemble mais également, ce qui est plus préoccupant, son démantèlement en cours par l’érosion fluviatile.
La coque du forain est en partie dégagée du sédiment, alors que celle de la corte se trouve encore enfouie sous le talus de la berge. En surface des sédiments, des bois travaillés et des outils sont visibles, montrant à la fois la bonne conservation de l’ensemble mais également, ce qui est plus préoccupant, son démantèlement en cours par l’érosion fluviatile.
Les analyses radiocarbone effectuées sur les pieux (1435-1631 ; 1450-1640 ; 1480-1650) et sur l’épave du forain (1460-1640) plaçaient cet ensemble cohérent dans la fourchette XVe-XVIIe siècle. L’analyse des objets présents aux abords immédiats du moulin, en surface des sédiments ou à l’intérieur des deux coques (sondages) tend à préciser cette datation entre la fin du XVIe siècle et le tout début du XVIIe siècle. C’est à cette période que se situe une bonne partie du vaisselier (étude de C. Vélien) et le talon de chaussure en cuir est issu d’une forme caractéristique du XVIe siècle (étude de C. Bonnot-Diconne).
Au cours des sondages, de la vaisselle en étain, des outils ainsi que des objets de la vie quotidienne d’un meunier et probablement de sa famille ayant vécu il y a 400 ans ont été remontés à la surface et sont actuellement en cours de traitement. Ces objets, ainsi que ceux qui ne manqueront pas d’être découverts au cours des futures fouilles, sont en très bon état de conservation et comportent parfois des matières organiques (bois, cuir) que l’eau douce a très bien préservées.
La datation de ce moulin-flottant dans l’époque moderne pré-industrielle et la possibilité de trouver des éléments de mécanismes en font un sujet d’étude de premier ordre pour la connaissance des techniques de meunerie, de batellerie et de pêche, les trois activités étant regroupées sur une seule structure. Son naufrage accidentel, sans doute un grand malheur à l’époque où il s’est produit, représente, comme tout naufrage, une chance pour la communauté des historiens et des archéologues.
Le site de Vix / campagne 2013

LES TRAVAUX DE RECHERCHE 2013 Une équipe internationale Responsable du programme : Bruno Chaume
Le rempart de la levée 3 et le rempart 11 : équipe autrichienne (Université de Vienne) Le rempart ouest : équipe suisse (Université de Zürich) L’étude géoarchéologique :
La fouille du plateau : équipe franco-allemande (Université de Bourgogne) Responsables : Bruno Chaume, Norbert Nieszery, Walter Reinhard et La fouille du plateau saint Marcel (B. Chaume, N. Nieszery, W. Reinhard) La campagne 2013 s’est achevée par la découverte d’une nouvelle grande maison à abside (la n° 6) d’une longueur de 27 m. de long pour une largeur de 16 m. Ce bâtiment exceptionnel par ses dimensions se situe dans l’enclos qui jouxte celui du Palais de la Dame de Vix. Au sud du plateau un sondage sur les greniers (C. Petit, L. Berrio, Univ. de Paris I) a confirmé la fonction de stockage des céréales de ces grands bâtiments. Des graines d’orge carbonisées ont été trouvées en assez quantité dans les trous de poteau. La fouille du Breuil (B. Chaume, N. Nieszery, W. Reinhard) Situé dans un méandre de la Seine, à 200 m environ de la tombe princière, cet ensemble a été révélé pour la première fois lors d’un vol effectué par A Cordier en 2011. La fouille de 2013, menée sur une étendue de 800 m2, a mis au jour deux sites, sans doute des établissements ruraux du Hallstatt D2-D3 (fin du premier âge du Fer et de LTC2-D1 (fin du second âge du Fer). Les prospections géophysiques (Fritz Lüth, Deutsches Archäologisches Institut, Harald von der Osten (Service des fouilles du Bade-Wurtemberg). Un programme de prospections de très grande ampleur (3 à 4000 ha) a débuté au cours de la campagne 2013. Il a pour objectif la découverte d’habitats protohistoriques satellites et contemporains de la Résidence
Responsables : Otto Urban
Adjoint : Thomas Pertlwieser
Responsable de la fouille : Ariane Ballmer

Responsable : Christophe Petit
Prospection sous forêt : habitats et parcellaires
Responsable : Dominique Goguey
Adjoint : Alexandra Cordier
Participation de Clément Lassus, Fabien Sévin, Angélique Chevalier étudiants en master d’ARTeHIS, David Bardel (INRAP), David Cambou (INRAP, archéozoologue), Michel Kasprzyk (INRAP), Julian Wiethold (INRAP, Carpologue), membres d’ARTeHIS et Stéphanie Desbrosse-Degobertière (INRAP).


Fouille programmée des grottes de la Verpillière, Mellecey (71) / Campagne 2013

Resp. : Pr. Harald Floss Le site : La Verpillère I : La fouille fine a surtout porté sur le secteur Nord-ouest, où deux niveaux (15 et 16) contiennent du mobilier du Paléolithique moyen et de la transition vers le Paléolithique supérieur. Cette zone a été sécurisée, en fixant à la paroi un grand bloc qui menaçait de s’effondrer . En profondeur, une couche intacte avec de nombreux artefacts en os et en silex (GH 35), a été attribuée au Paléolithique supérieur (Aurignacien ?). Elle a livré des lames et des fragments de lames assez fines, dont une est faite d’une matière première bien identifiable : le silex tertiaire lacustre du gisement de Mont-lès-Etrelles, en Franche-Comté. La présence de plusieurs grands fragments d’os déterminables par espèces (> 10 cm) est également à souligner. Comme pour d’autres couches, l’action des carnivores est visible sur certains fragments d’os. Résultats : La Verpillère II : Résultats :
Cofinancements : Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC de Bourgogne-SRA)
Conseil régional de Bourgogne
Département de Saône-et-Loire
Deutsche Forschungsgemeinschaft (D.F.G.)
Université Eberhard Karls de Tübingen
Les fouilles des grottes de la Verpillière I et II par l’équipe allemande de l’Université de Tübingen, durent depuis 2006. Elles font partie intégrante du PCR « Le Paléolithique supérieur ancien en Bourgogne méridionale ».
La Verpillière I est une grotte connue depuis le XIX° siècle, dont la stratigraphie couvre le Paléolithique moyen et une large partie du Paléolithique supérieur. En 2013, la fouille s’est déroulée dans trois zones principales : le secteur Nord-Ouest, la coupe Ouest, et le secteur Central. Dans chaque secteur, la fouille a cherché prioritairement à retrouver des unités stratigraphiques conservées, rescapées des fouilles anciennes ou des phénomènes érosifs, et susceptibles de livrer une occupation paléolithique structurée.
Cette campagne de fouille a permis d’approfondir la compréhension de la stratigraphie de la grotte, et des processus naturels (effondrements, chenaux d’érosion), animaux (terriers) et humains (fouilles anciennes anarchiques) qui ont contribué à son état actuel. Les lambeaux de couches archéologiques en place repérés, sont malheureusement très localisés et isolés les uns des autres, ce qui rend difficile la reconstitution globale de la stratigraphie initiale.
A La Verpillière II, cavité intacte seulement perturbée par les animaux fouisseurs, les travaux ont porté sur la clarification des rapports sédimentologiques et stratigraphiques, au sud et à l’ouest du site, et en particulier sur la fouille du niveau archéologique GH 3. A côté de la poursuite des travaux dans les sédiments intacts, l’analyse du modèle de l’effondrement et des modalités de remplissage a été poursuivie. Rappelons qu’il s’agit d’une petite grotte, d’environ 5 à 7 mètres de large pour une profondeur estimée à une dizaine de mètres. La partie avant de la grotte est effondrée anciennement sur une surface à peu près équivalente (terrasse). C’est cette partie effondrée, qui est encore peu accessible à la fouille du fait de l’énorme volume de certains blocs.
Le principal niveau archéologique (GH 3) a surtout livré de nombreux éléments attribués au concept Levallois. Il s’agit de nucléus (n = 5) ainsi que de supports typiques (n = 22). Parmi l’outillage, figurent quelques supports retouchés (n = 19), dont une grande partie peut être classé comme racloir (n = 8). Les éléments bifaciaux attribuables au Micoquien de la France de l’est (Keilmessergruppen de l’ouest), observés pour la première fois pendant la campagne de 2012, sont devenus plus nombreux en 2013.
Monastère Saint-Pierre d’Osor / printemps 2013
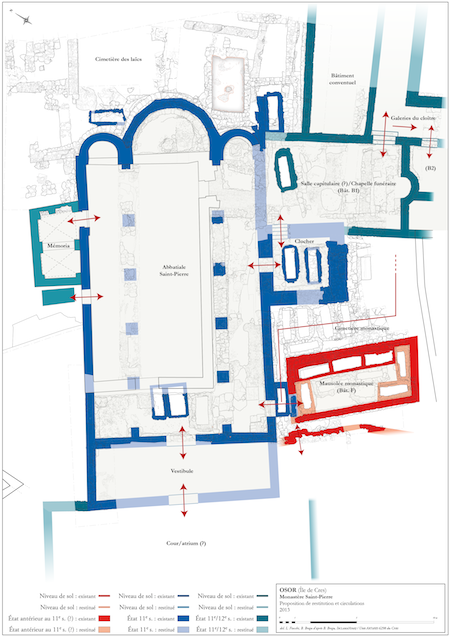
Collaboration croato-française Le site : Objectifs et résultats : Les plus anciennes structures découvertes cette année sont représentées par deux tombes protohistoriques liburnes. Mais la fouille du flanc sud de l’église a essentiellement porté sur des tombes maçonnées médiévales du cimetière monastique, densément présentes dans ce secteur. La plupart des tombes maçonnées ont accueilli de multiples inhumations successives avant d’être scellées par un nouvel horizon d’inhumation tardif (de la fin du Moyen Age et de l’époque moderne) et paroissial. Le cimetière des moines s’est développé au contact de l’église abbatiale, mais également d’un exceptionnel monument funéraire (bâtiment F) que l’on identifie désormais comme un mausolée à formae. Assurément en fonction déjà au Xe s. – d’après une datation C14 réalisée sur une inhumation – , le mausolée est donc antérieur à la fondation « officielle » du monastère. L’étude anthropologique démontre qu’un très grand nombre de moines ont ensuite élu sépulture dans les formae. La fouille de la première travée de la nef de l’église abbatiale a également révélé des tombes maçonnées et des caveaux, ainsi que le prolongement de la façade interne avec le vestibule. À l’exception de la tombe privilégiée d’un abbé ou d’un évêque découverte en 2012 dans le bâtiment B, celui-ci n’a pas accueilli d’autres sépultures. En revanche, la poursuite de sa fouille a permis d’en préciser la datation aux XIe-XIIe s. et déterminer un état antérieur, de l’Antiquité tardive, lié à l’espace urbain. Mais l’un des apports les plus significatifs de la campagne et la confirmation archéologique de l’existence d’un cloître roman au sud-est de l’église, telle que nous l’avions suggéré à partir des prospections géophysiques. En parallèle, nous avons poursuivi l’étude archéologique des élévations du bâtiment monastique médiéval oriental intégré dans l’enceinte vénitienne, ainsi qu’un segment de cette muraille formant clôture du monastère. Publications : ČAUŠEVIĆ-BULLY (M.), BULLY (S.), JURKOVIĆ (M.) et MARIĆ (I.), « Monastère Saint-Pierre d’Osor (Croatie, île de Cres). Bilan de la mission franco-croate 2013 », Chronique des activités archéologiques de l’École française de Rome, 2014
Responsables : Sébastien Bully (UMR ArTeHiS), Miljenko Jurković (université de Zagreb-centre IRCLAMA), Morana Čaušević-Bully (École française de Rome), Iva Marić (université de Zagreb-centre IRCLAMA)
Participation de : Laurent Fiocchi, Tonka Kružić, Ivan Valent, Amélie Berger en partenariat avec aIPAK/APAHJ
Dates de chantier : 06 mai au 14 juin 2013
Financements : Ministère des affaires étrangères français, ministère de la Culture croate, ministère des Sciences croate, École française de Rome, Caritas veritatis foundation
Le monastère bénédictin Saint-Pierre d’Osor, sur l’île de Cres, aurait été fondé au début du XIe s. par saint Gaudentius, évêque de la cité. Engagée depuis 2006, la fouille programmée répond à plusieurs objectifs : il s’agit de comprendre les modalités de l’installation du monastère dans un contexte urbain d’origine protohistorique et antique et d’étudier une topographie monastique qui doit tenir compte à la fois des contraintes urbaines, mais également de constructions antérieures, peut-être déjà religieuses. L’analyse archéologique des vestiges de l’ancienne abbatiale Saint-Pierre complète les études d’histoire de l’art afin de préciser la datation d’un édifice considéré comme insigne pour l’architecture romane dans la région et révélateur des échanges et influences avec la côte adriatique occidentale (Pomposa, Italie). Les méthodes employées sont celles de l’archéologie du sous-sol, du bâti et les prospections géophysiques.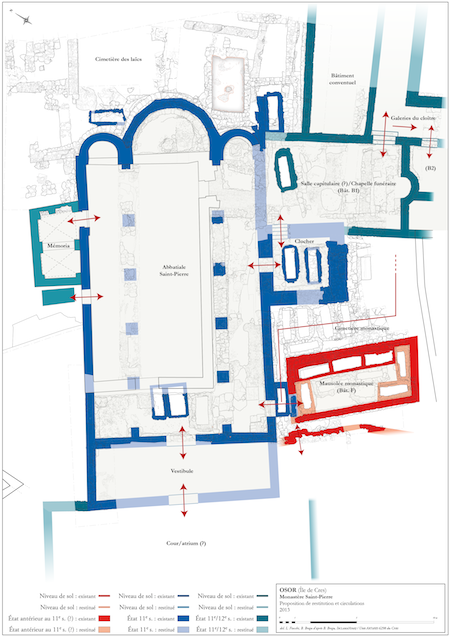
La fouille programmée du monastère Saint-Pierre d’Osor s’est poursuivie en 2013 dans le secteur au sud de l’église et s’est développée à l’est, sous le parking (espace VIII), ainsi que sur le parvis de l’église réduite (espace V). L’ensemble représente une surface ouverte d’environ 290 m2.
La campagne 2014 sera consacrée à l’achèvement de l’étude du mausolée et à l’engagement de la fouille de l’église abbatiale romane dans l’emprise de l’église tardive.

http://cefr.revues.org/1046
Les monastères et sites ecclésiaux insulaires dans l’archipel du Kvarner (Croatie) / Campagne 2013

Collaboration croato-française Les sites : Le programme de prospection-inventaire des sites ecclésiaux insulaires engagé en 2010 est structuré autour de trois axes majeurs : Objectifs et résultats : Parmi les six sites retenus au terme de la première campagne menée en 2010, nous sommes intervenus en 2013 sur quatre d’entre eux : le site de l’îlot de Lukovac (île de Rab), l’église des Saints-Jean-Pantaléon (îlot d’Oruda), les complexes de Martinšćića (île de Cres) et de Mirine-Fulfinum (île de Krk). Publications : ČAUŠEVIĆ-BULLY (M.), BULLY (S.), Kvarner (Croatie). Prospection-inventaire des sites ecclésiaux et monastiques : campagne 2013, Chronique des activités archéologiques de l’École française de Rome, 2014
Responsables : Morana Čaušević-Bully (École française de Rome), Sébastien Bully (UMR ArTeHiS)
Participation de : Ivan Valent, Laurent Fiocchi, Luka Babić, Pascale Chevalier et Miro Vuković en partenariat avec aIPAK/APAHJ, société Kaducej, faculté de géodésie de l’université de Zagreb
Dates de chantier : 15 au 27 avril, 2 au 12 juillet 2013
Financements : Ministère des affaires étrangères français, ministère de la Culture croate, École française de Rome, commune d’Omisalj, Caritas veritatis foundation
– Identification des sites monastiques potentiels à partir des sources écrites, des données archéologiques, architecturales et topographiques ;
– Conditions et modalités de l’installation et de la diffusion du monachisme insulaire dans le Kvarner, entre le Ve et le XIe siècle : occupation du sol et voies maritimes, construction de l’espace ;
– Topographie monastique et architecture cultuelle : héritages et influences, cénobitisme et érémitisme.
L’exécution de ce programme passe un dépouillement bibliographique, des sondages archéologiques, des études de bâti, des relevés topographiques, la constitution d’une documentation graphique et photographique, des prospections pédestres et géophysiques.
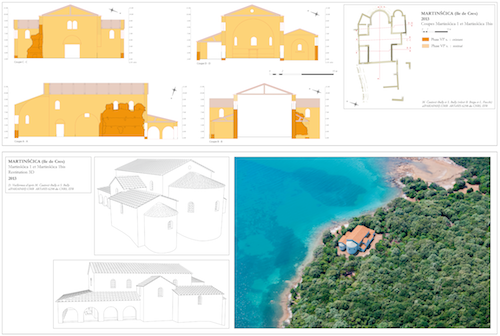
Les relevés topographiques sur l’îlot de Lukovac ont révélé les vestiges inédits d’une église du VIe s. et de constructions annexes. Ce petit complexe – dont il reste à déterminer la nature : monastère ou fortin protobyzantin – serait circonscrit par un mur d’enceinte autour de l’îlot. Sur l’île d’Oruda, l’étude archéologique des élévations de la petite église a permis d’en préciser le plan et de suggérer une datation haute entre les Ve et VIIe s. L’église est également accompagnée de constructions que l’on pourrait associer à un ermitage (basilien ?), et l’îlot voisin de Palacol conserve des vestiges imposants interprétés comme ceux d’un fortin protobyzantin. Les sondages archéologiques sur le complexe de Martinšćića ont révélé que le site ecclésial paléochrétien (monastique ?) s’installe dans une villa maritime des IIIe/IVe s. ; la poursuite de l’étude de l’église confirme la singularité d’un parti architectural à mettre en relation avec un important sanctuaire marin. À Mirine-Fulfinum, la première campagne de fouilles sur une construction située entre la ville antique et le complexe ecclésial paléochrétien, puis monastique médiéval, a révélé un mausolée du Ve s. présentant deux phases de constructions.
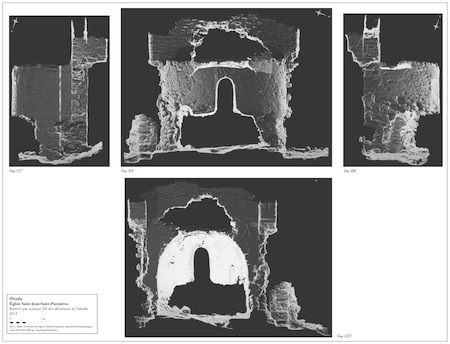
http://cefr.revues.org/1059
Les sites d’Annegray et de Faucogney : sondages et prospections géophysiques / été 2013

(Projet collectif de recherche Monastères en Europe occidentale (Ve –Xe siècles). Le site : Le hameau d’Annegray (commune de la Voivre, Haute-Saône) est le lieu du premier monastère de l’Irlandais Colomban fondé à la fin du VIe s. Des premières fouilles menées en 1958 avaient révélé les vestiges d’une église romane et des sarcophages mérovingiens. C’est sur cette base que nous avons engagé des campagnes de prospections géophysiques dès 2010 afin de localiser le monastère précoce que l’hagiographie situe dans, ou à proximité d’un « castrum [romain] ruiné que la tradition des anciens nommait Anagrates ». En 2012, nous avons ouvert des sondages dans une importante structure fossoyée localisée par la prospection géophysique au pied de la butte accueillant les vestiges de l’église ; celle-ci s’est révélée être une maison-forte contemporaine du prieuré de la fin du Moyen-Âge. Objectifs et résultats : Pour cette nouvelle campagne, nous avons : Perspectives : La campagne 2014 verra la poursuite des prospections géophysiques sur les parcelles à l’ouest de l’église Saint-Jean-Baptiste ainsi que l’ouverture de nouveaux sondages archéologiques sur les structures localisées par le radar-sol sur la butte d’Annegray et dans la nef de Saint-Martin de Faucogney.
Topographie et structures des premiers établissements en Franche-Comté et Bourgogne)
Collaboration franco-irlandaiseResponsables : Sébastien Bully (UMR ARTeHiS), Emmet Marron (université de Galway), Morana Čaušević-Bully
Participation de : Laurent Fiocchi, Laure Saligny, Fabien Chucen partenariat avec UMR SISYPHE – Université Pierre et Marie Curie Paris VI-Jussieu, MSH Dijon-USR CNRS-UB 3516, APAHJ
Dates de chantier : 5 au 30 août 2013
Financements : Ministère de la Culture – DRAC Franche-Comté
Conseil régional de Franche-Comté, Conseil général de Haute-Saône,
Caritas veritatis foundation,
Fondation Gilles et Monique Cugnier

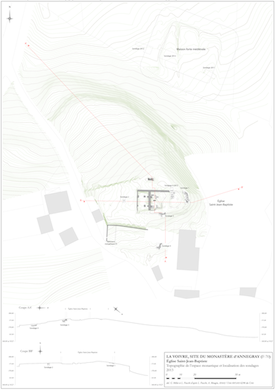
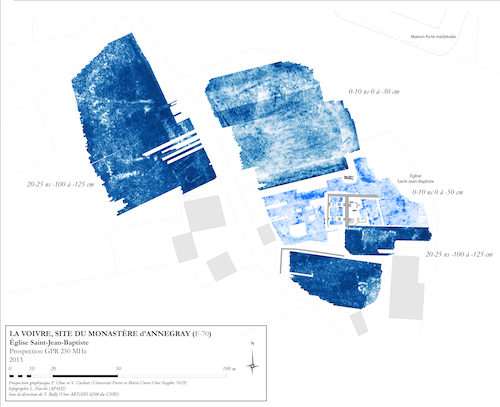
La carrière de sarcophages de Saint-Valbert (Haute-Saône) : relevés topographiques et sondage/ campagne 2013

Projet collectif de recherche Monastères en Europe occidentale (Ve – Xe siècles). Topographie et structures des premiers établissements en Franche-Comté et Bourgogne, sous la direction de Sébastien Bully et Christian Sapin) Le site : Le site de Saint-Valbert a été découvert en 2009 dans le cadre de prospections pédestres portant sur les carrières de grès autour de Luxeuil. L’observation de traces de tailles disséminées (et dissimulées) dans la forêt a permis de suggérer que l’on était en présence d’un site d’extraction de sarcophages du haut Moyen Âge. La campagne 2013, en combinant des relevés topographiques, des prospections pédestres et un sondage archéologique, permet pour la première fois dans la région d’étudier les modes d’extraction des sarcophages en grès. Les recherches déjà menées dans d’autres régions de France sur ces mêmes problématiques ont montré l’intérêt de réaliser des sondages au sein des carrières afin de déterminer le type d’exploitation en étudiant la morphologie des fronts de tailles, mais également en dressant une typologie des traces d’outils et des tranchées préparatoires. L’objectif de cette étude est de définir la production et la diffusion des sarcophages en grés dans l’espace des fondations monastiques luxoviennes. Objectifs et résultats : Le travail de terrain mené dans la carrière de Saint-Valbert (70) en septembre 2013 a permis : 1- De réaliser un premier inventaire des blocs et des fronts de tailles afin de définir la densité des zones d’extraction sur une surface de plus d’un hectare ; 2- De dresser des relevés topographiques afin de créer un modèle numérique de terrain nécessaire à la visualisation du site et de sa topographie ; 3- D’ouvrir un sondage archéologique afin de déterminer le mode d’exploitation du grès (qui s’avère être une exploitation en tranchée). Les traces observées sur le front de taille dégagé sur plus de 6 mètres de longueur ont permis d’obtenir des informations sur la chaîne opératoire d’extraction des blocs. La découverte de mobilier métallique (coin en fer, fragment de pointerolle) encore fiché dans la paroi rocheuse nécessite une étude typologique et métallographique afin de cerner le type de fabrication et la datation de ces outils. 4- D’opérer des prélèvements sur les quinze fronts de tailles découverts en prospections afin de constituer une lithothèque grâce à la confection de lames minces sur les différents grès. Ces lames devraient permettre, à terme, de comparer les échantillons prélevés sur les sarcophages en grès des Vosges méridionales afin d’établir l’aire de diffusion de la carrière de Saint-Valbert. Perspectives : Durant la campagne 2014, nous engagerons de nouvelles prospections afin de cerner l’étendue de la zone d’extraction et son inscription dans le paysage (voies terrestres et cours d’eau) ; nous ouvrirons un nouveau sondage sur un front de taille afin de poursuivre la documentation du mode d’exploitation.
Responsable : Alicia Mougin
Collaboration de : Stéphane Büttner (CEM-UMR ArTeHiS), Fabrice Henrion (CEM-UMR ArTeHiS), Pascal Tobaty (UMR 6282 Biogéosciences)En partenariat avec MSH Dijon-USR CNRS-UB 3516, MSHE Ledoux Besançon -USR 3124, APAHJ, CEM
Dates d’intervention : du 2 au 14 septembre 2013Financements : Projet collectif de recherche Monastères en Europe occidentale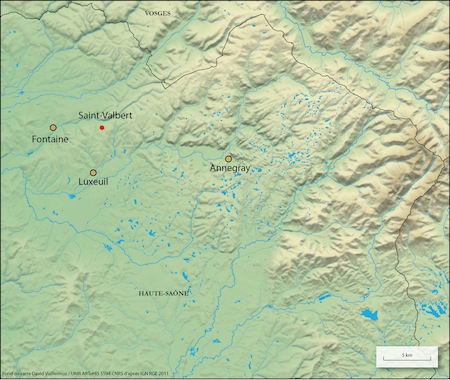
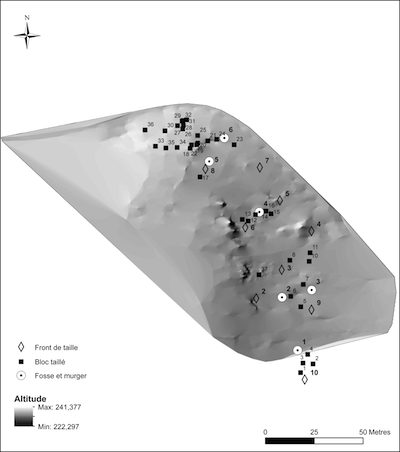


Le site du Saint-Mont (Vosges) : révision de fouilles, relevés topographiques et prospections géophysiques /campagne 2013

Projet collectif de recherche Monastères en Europe occidentale (Ve – Xe siècles). Topographie et structures des premiers établissements en Franche-Comté et Bourgogne, sous la direction de Sébastien Bully et Christian Sapin) Le site Le Saint-Mont (commune de Saint-Amé, Vosges) est réputé pour être l’emplacement du premier monastère d’Austrasie, fondé au début du VIIe s. par saint Amé, moine de Saint-Maurice d’Agaune puis de Luxeuil, et par saint Romaric, leude austrasien. Le site du Monasterium Habendum a fait l’objet de plusieurs campagnes de fouilles entre 1964 et 1991 par Michel Rouillon puis par Charles Kraemer. Les recherches ont permis la découverte de nombreuses structures et de mobilier s’inscrivant pour l’essentiel dans une large fourchette chronologique comprise entre l’Antiquité tardive et l’époque moderne. Les vestiges s’étagent entre le sommet du mont et deux terrasses sur son flanc sud, soit une surface estimée actuellement à 3 hectares. En tenant compte des résultats anciens, nous avons engagé une nouvelle série de relevés topographiques et de prospections géophysiques ; une révision de fouille a été menée sur des vestiges anciennement dégagés afin de mieux comprendre l’évolution topographique d’un site monastique qui s’implanterait, d’après le récit hagiographique des fondateurs, sur une villa mérovingienne, puis sur un castrum tardo-antique. Objectifs et résultats Pour cette nouvelle campagne, nous avons : Perspectives La campagne 2014 complétera la « relecture » des structures commencée en 2013 en opérant, si possible, quelques sondages pour valider l’hypothèse de l’existence d’un grand édifice funéraire mérovingien afin d’en déterminer l’emprise exacte et l’étudier plus précisément. Les prospections radars seront étendues au nord de la Plateforme C. Enfin, l’attention sera portée sur les vestiges de l’église Saint-Pierre (Plateforme A) afin de finaliser son plan pierre à pierre et de valider ses états successifs pressentis.
Responsables : Charles Kraemer (chercheur au pôle archéologique, HISCANT-MA, Université de Lorraine) et Thomas Chenal (Master ACTE, Université de Franche-Comté).
Participation de : Fabien Chuc, Martine Aubry-Voirinen partenariat avec UMR SISYPHE – Université Pierre et Marie Curie Paris VI-Jussieu, MSH Dijon-USR CNRS-UB 3516, MSHE Ledoux Besançon -USR 3124, APAHJ
Dates d’intervention : 15 au 31 septembre 2013, novembre 2013
Financements : Projet collectif de recherche Monastères en Europe occidentale, commune de Saint-Amé
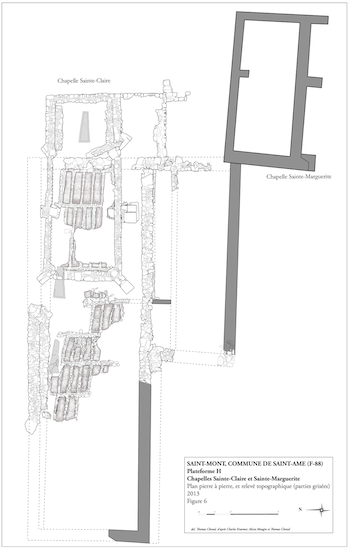

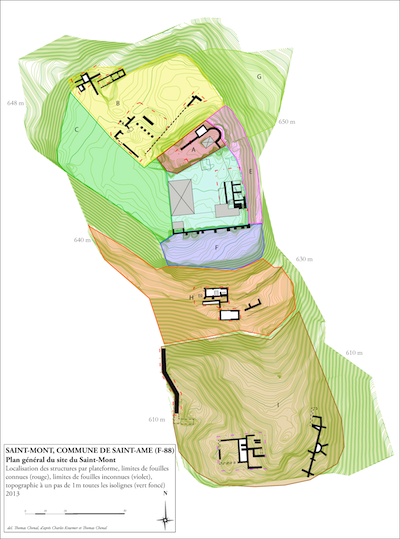
Programme de recherche : Loire amont et moyenne : évolution du système ligérien et des occupations humaines au cours des deux derniers millénaires / campagne 2013

Quatre fenêtres : de Digoin à Nevers – La Charité/La Chapelle Montlinard – de Saint-Satur à Cosne/Boulleret – Briare/Brisson-sur-Loire. En 2013, dans les chenaux actifs de la Loire, où il n’a pas été possible d’intervenir en raison du trop niveau de la Loire, les nouveautés concernent la datation des sites découverts en 2012. Les travaux géoarchéologiques réalisés en 2012/2013 ont concerné trois secteurs : la synthèse des observations réalisées à La Charité-sur-Loire, l’étude sur le temps long du système Loire en amont de ce site et du bec d’Allier avec l’analyse d’une carotte prélevée à l’Hôpital-le-Mercier, et une première prospection dans un secteur où les variations latérales du fleuve n’avaient pas encore fait l’objet d’études (Fleury-sur-Loire).
Responsable : Annie Dumont (Ministère Culture-DRASSM et UMR6298)
Intervenants : Philippe Moyat (ETSMC, UMR 6298) : responsable hyperbare, prospections subaquatiques, photographies, relevés de terrain, sondages, traitement de données en DAO ; Jean-Pierre Garcia (UB, UMR 6298) : encadrement des études de géomorphologie ; Ronan Steinmann (doctorant UB, UMR 6298) : responsable des études de géomorphologie ; Amélie Quiquerez (UB, UMR 6298) : analyse des images LIDAR, géomorphologie ; Florent Delencre (doctorant U B, UMR 6298) : encadrement du stage des Master 2, SIG, prospection terrain ; les étudiants de master 2 AGES –Dijon (Archéo-Géo-Sciences, travaux pratiques) ; Morgane Cayre, contractuelle : prospection dans les chenaux, transcription d’archives, sondages ; Marion Foucher (doctorante UB, UMR6298) : étude des arches du pont médiéval de La Charité ; Alain Magdelaine, bénévole : prospection et photos aériennes ; Elise Doyen (UMR6249) : analyse palynologique ; Luc Jaccottey (Inrap et UMR6249) : étude des meules de Bannay.
Financements : Union européenne (FEDER), Université de Bourgogne, Ministère de la Culture (SRA Auvergne, Centre et Bourgogne ; DRASSM), Région Centre, Mairie de Châtillon-sur-Loire.
Dates de réalisation : juin 2013 – décembre 2014.
Deux structures de fonction indéterminée (digue, pêcherie ?) se rattachent à la période gallo-romaine, à Bannay et à Châtillon-sur-Loire, ce qui représente un apport important pour la compréhension de l’évolution du cours de la Loire sur la longue durée et la taphonomie des vestiges dans ce milieu complexe. Rappelons que dans le secteur de La Charité, localisé en amont de Bannay et Châtillon, seuls des vestiges du XIIIe siècle sont présents et que le chenal ne coulait probablement pas au même emplacement à l’époque romaine. Ainsi, grâce à ces découvertes de vestiges, certes très érodés mais datables, on est en mesure de construire, petit à petit, des schémas d’évolution du chenal secteur par secteur. Jusqu’à présent, les seuls vestiges gallo-romains découverts en Loire amont et moyenne étaient des ponts (Chassenard, Saint-Satur, Cosne, situé juste en aval de Bannay) fondés sur des pieux de grande section. Les découvertes de bannay et de Châtillon montrent que des piquets de plus petits diamètre ont également pu résister à deux millénaires d’érosion fluviatile.
Les meules découvertes à Bannay sont probablement du début du Moyen Âge (étude typochronologique préliminaire de Luc jaccottey) et constituent un des rares exemples de cargaisons perdues au cours de l’acheminement vers les moulins auxquels elles étaient destinées. Elles apportent un instantané inédit sur l’exploitation et le transport des matériaux dans le Val de Loire, ainsi que sur le caractère aléatoire et dangereux de la voie fluviale.
Cet aspect est également illustré par l’épave découverte à Saint-Satur, bloquée contre les restes d’une des piles du pont romain. Celle-ci date des XIVe-XVe siècles et représente un des rares témoins de la navigation de la fin du Moyen Âge. La présence dans la coque d’une partie de la cargaison (blocs de pierre taillée en calcaire blanc) livrera sans aucun doute de nouvelles données sur l’exploitation et le transport des matériaux.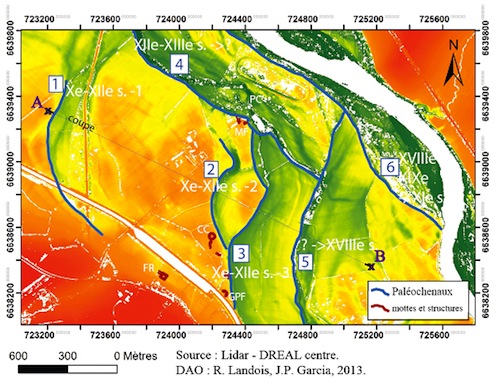
A l’Hôpital-le-Mercier, les résultats de l’analyse palynologique ont été corrélés aux observations sédimentologiques déjà datées et à la mesure de la susceptibilité magnétique. Il en ressort que la dynamique de la Loire amont semble étroitement contrôlée par les fluctuations climatiques, même peu intenses, de l’Holocène, ce qui est particulièrement important pour comprendre la dynamique en aval du bec d’Allier.
Le site de La Charité-sur-Loire ne livre pas de séquence aussi ancienne. Le fleuve a ici effacé ses dépôts, et les sédiments conservés les plus anciens datent du haut Moyen Âge. Les carottages démontrent la présence, à cette époque, d’un marais assez étendu dans la zone aujourd’hui occupée par le lit actif. Celui-ci, pour les périodes antérieures au XIIIe siècle. (pour lequel on dispose d’un pont daté dans le petit chenal) sera probablement à rechercher dans la plaine d’inondation sur la rive gauche (commune de La Chapelle Montlinard). Après le XIIIe siècle, le fleuve change profondément et l’on soupçonne le Petit Âge Glaciaire d’avoir causé cette évolution. En résulte le fleuve Loire moderne, système dynamique développant des îles importantes et des barres de chenal migrant très rapidement.
A Fleury-sur-Loire, les premières observations de terrain consécutives à des observations faites en prospection aérienne montrent une évolution conjointe des chenaux de la Loire et des installations médiévales probablement liées à un point de passage et/ou de péage. Cette étude réalisée dans le cadre d’un stage de terrain pour les étudiants en Master 2 de l’Université de Bourgogne a mis en évidence un secteur particulièrement riche en vestiges médiévaux (trois mottes et un château du XIIIe siècle) sur lequel il serait intéressant de revenir pour en préciser l’évolution.
Les documents d’archives (textes et plans) sont très nombreux et leur recherche demande beaucoup de temps. Leur dispersion dans différents centres de conservation et dans des lieux où elles n’ont jamais fait l’objet d’un inventaire n’en facilite pas l’étude. Cependant, au fil des découvertes, on voit bien l’intérêt d’en faire une recherche systématique et de croiser les informations qu’ils contiennent avec les nouvelles données collectées au cours de ces dernières années sur le terrain. Cette année, trois types de documents ont été traités :
– Poursuite de la transcription des textes d’archives conservés aux Archives municipales de La Charité (Morgane Cayre).
– Photographie de la Carte de la Loire, plan géométrique en couleur et à l’échelle 1 : 2000e, réalisée de 1851 à 1852 par M. Zeiller, puis, en 1853 par M. Joly, tous deux ingénieurs en chef des Ponts et Chaussées. Elle est très précise et la nature des cultures associée à l’utilisation de différentes couleurs fait très bien ressortir d’anciens chenaux de la Loire. Elle a été levée après la construction du canal latéral et elle est centrée sur le cours de la Loire (lit mineur et lit majeur).
– Un carton conservé aux Archives Nationales (site de Pierrefitte) contient : deux plans de l’état des travaux du grand pont de La Charité datés respectivement du 9 et du 13 septembre 1732, levés par Delaguêpiere, Fayolle, Boffrand ; un plan non daté d’un pont en pierre franchissant le petit chenal, entre l’île du Faubourg et la rive gauche ; le plan général des trois ponts de la ville de Nevers, daté de1763. L’analyse de ces plans apportera des données complémentaires aux études archéologiques sur l’évolution des ponts de La Charité-sur-Loire.
Surveillance archéologique du palais des ducs de Bourgogne à Dijon / campagne 2012

Responsables : René-Pierre Lehner (Centre Castellologique de Bourgogne) et Hervé Mouillebouche (UMR ARTEHIS) Participation des chercheurs de l’UMR : Michel Maerten chercheur associé, Guillaume Grillon, Marion Foucher, doctorante Le site : Le musée des Beaux-Arts de Dijon est partiellement installé dans des bâtiments du palais des ducs de Bourgogne : tour de Bar, cuisines ducales et logis neuf. La première tranche de la rénovation du musée, qui prévoit de remettre en valeur les bâtiments médiévaux et d’installer les collections médiévales dans les salles du palais des ducs, a été lancée après une étude bibliographique du bâtiment, une étude préalable de l’architecte en chef des Monument historiques et des sondages archéologiques limités. La bibliographie, ancienne et labyrinthique, les nombreuses transformations au cours des siècles et l’emprise des usages quotidiens n’ont assurément pas facilité l’appréhension d’un bâtiment qui passe pourtant pour être le dernier grand palais princier à ne pas avoir bénéficié d’études et semblent avoir découragé les historiens contemporains. L’étude archivistique partiellement reprise par Sophie Jugie pendant les études préalables, laissait cependant deviner tout l’intérêt historique du logis de Philippe le Bon. Le bâtiment et le chantier : Quoi qu’il en soit, aucune prescription archéologique n’a été édictée pour accompagner le chantier, alors que les travaux ne peuvent manquer d’affecter, parfois irrémédiablement, des structures médiévales classées Monument historique. La plus grande partie du chantier s’est donc déroulée sans surveillance archéologique, jusqu’à l’intervention, à bien des égards trop tardive, du Centre de Castellologie de Bourgogne. Comme il était impossible de retarder ce chantier dont l’importance est évidemment vitale pour l’économie de la ville, les bénévoles du CeCaB interviennent pendant les interruptions de chantier. Nous avons notamment travaillé tous les week end du premier trimestre 2012. Il est difficile d’estimer la quantité d’informations archéologiques disparue avant notre intervention, mais les résultats considérables et impressionnants obtenus en quelques mois apportent néanmoins une certaine consolation. Le logis neuf, bâti par Philippe le Bon à partir de 1450, est un massif bâtiment rectangulaire divisé dans toute sa longueur par un mur de refend. Il comprend un sous-sol et un rez-de-chaussée voûtés, deux étages carrés et trois étages de combles, qui ont partiellement brûlé dans l’incendie de 1503. L’étude : L’étude des maçonneries et des techniques de construction a permis de déterminer que les caves appartiennent à trois ensembles architecturaux distincts. Globalement, seules les deux caves occidentales peuvent être rattachées à la campagne de 1450. Au rez-de-chaussée, la grande salle du sud-est a pu être identifiée avec certitude comme celle que les archives appellent l’échansonnerie. Elle est munie d’un évier monumental lié à sa fonction et ses murs portent en graffiti un blason d’échanson. L’échansonnerie est d’ailleurs idéalement placée, avec accès direct aux caves et au grand cellier du rez-de-chaussée. Un accès direct à un escalier en vis permettait de desservir aisément la salle du poêle, la chambre du duc et la grande salle situées au premier étage. À l’est, une porte extérieure mettait l’échansonnerie en relation avec les cuisines et la paneterie, et tous ces offices pouvaient desservir la grande salle par une galerie dont des traces ont été identifiées sur le pignon est du logis. Il n’est pas anodin, pour une ville comme Dijon, de constater que les deux premiers niveaux du palais étaient presque entièrement consacrés au service du vin et de la table ! Les premières études ont montré que les murs de la plupart des salles des étages — sauf la grande salle — étaient couverts de lambris. En effet, on retrouve un peu partout des empochements de barres de lambris, voire des morceaux de barres, intégrées dans la maçonnerie dès la construction. Les maçonneries ont également conservé les traces de nombreux conduits verticaux : conduit d’évacuation des eaux de l’évier, et quatre conduits de latrines qui évacuaient les matières depuis les étages vers une fosse (encore pleine) conservée au centre des caves. Les suites : L’étude archéologique va désormais se poursuivre par l’observation des structures qui n’ont pas été affectées par le chantier, notamment la tour de la terrasse.
Intervention : 1er trimestre 2012
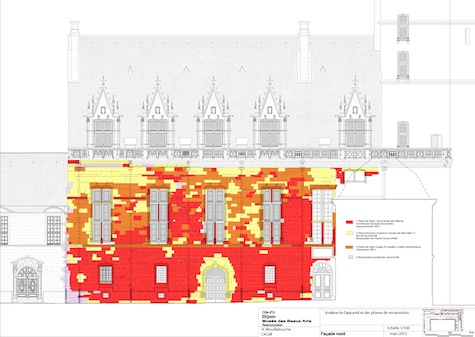


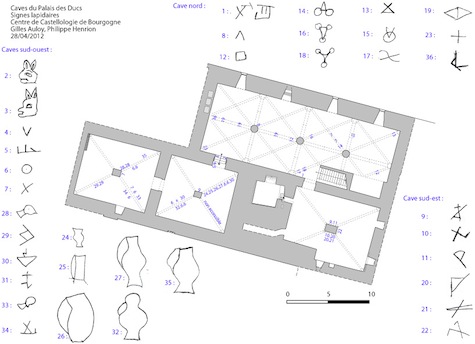
Au premier étage, l’étude des élévations a permis de retrouver les traces du poêle attesté par les sources écrites, au dessus de l’échansonnerie. La grande salle, qui occupe aujourd’hui l’équivalent des premiers et deuxième étages, nous est connue dans son état restauré d’après 1503. Son volume primitif, notamment son couvrement, est actuellement inconnu.
Les second et troisième étages, très restaurés par Charles Suisse, offrent encore des murs et des enduits médiévaux en quantité plus abondante qu’on aurait pu le croire.


Mission franco-tunisienne en charge de l’étude du site de Djebel Oust (Tunisie)

Responsables : A. Ben Abed (Institut National du Patrimoine, Tunis) et J. Scheid (Collège de France) La mission : Les investigations qui se poursuivent depuis l’année 2001 sur le site de Jebel Oust sont le fruit d’une collaboration exemplaire entre l’Institut National du Patrimoine (Tunis) et l’Ecole française de Rome, la Commission des Fouilles du ministère des Affaires étrangères en association avec le Collège de France, le CNRS et l’Institut français de Coopération à Tunis. Elles sont dirigées par A. Ben Abed, J. Scheid, avec la collaboration d’architectes, de dessinateurs, d’archéologues, de géoarchéologues, de céramologues, de doctorants et de techniciens mosaïstes. Le site et l’approche géoarchéologique : Le site antique de Jebel Oust se trouve à 30 kilomètres au sud-ouest de Tunis, sur la route antique de Carthage à Thuburbo Maius, à mi-chemin entre Vthina et Thuburbo. Le site est constitué de trois ensembles majeurs : le temple, édifié dès le 1er siècle de notre ère, à l’aplomb de l’évent d’une source chaude ; les thermes romains, en aval, et les bâtiments accolés (villa) ; enfin, de grandes citernes, situées en marge du site proprement dit et qui captent les eaux de l’oued voisin. L’eau thermale captée dès l’époque antique à Jebel Oust, par ses propriétés physico-chimiques, a engendré la formation d’épais dépôts carbonatés (travertins) au sein des différentes structures (aqueduc, natatio des thermes, etc.). Ces dépôts ont véritablement fossilisé les vestiges archéologiques (marches, escaliers, sols, colonnes, canalisations, etc.) et représentent le support principal de l’enquête géoarchéologique et géomorphologique effectuée sur le site par J. Curie, jeune chercheur à l’UMR 6298 ArTeHis (Université de Bourgogne) et C. Petit, professeur d’archéologie environnementale à l’Université de Paris 1, en collaboration avec les différents acteurs de la mission. Vue sur l’une des piscines des thermes antiques de Jebel Oust : observons les dépôts carbonatés moulant les marches d’escalier et les bases de colonnes (Prise de vue : J. Curie). Références bibliographiques : Ben Abed, A., Scheid, J. (2005) – Nouvelles recherches archéologiques à Jebel Oust (Tunisie), Compte rendus des séances de l’année 2005, janvier-mars. Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, Paris. Ben Abed, A., Scheid, J., Broise, H., Balmelle, C. (2011) – Le sanctuaire de source de Jebel Oust (Tunisie), Les Nouvelles de l’Archéologie, n°124, sept. 2011, p. 10-14. Curie, J. (2006) – Etude de concrétions carbonatées sur le site antique de Jebel Oust (Tunisie), mémoire de Master 2 Archéosciences et Géo-environnement, sous la direction de C. Petit, UFR des Sciences de la Terre et Environnement, Université de Bourgogne, 2006, 63p. Curie, J., Petit, C. (2008) − “Jebel Oust (Tunisie) : recherches géoarchéologiques”, in Mélanges de l’Ecole Française de Rome, t. 120.1, 2008, p. 268-270. Petit, C., Curie, J. (2007) − “Jebel Oust (Tunisie) : l’étude de concrétions carbonatées”, in Mélanges de l’Ecole Française de Rome, t. 119.1, 2007, p. 320-321.
Participation de : Julien Curie : approche géoarchéologique et analyse géomorphologique du site (avec C. Petit, Université Paris 1/Panthéon-Sorbonne).
Le principal objectif de la mission est de relever, d’étudier et de publier les fouilles de 1961-1963, entreprises par l’Institut national d’Archéologie et d’Art sous la direction du regretté Mohammed Fendri. En outre, il fallait mettre en œuvre un programme de consolidation et de protection des pavements en mosaïque et en opus sectile du site. Actuellement, l’équipe se concentre sur la publication des travaux effectués au cours des différentes missions annuelles.
Sondages à Morains-lès-Petit, « Le Canal », « La Fosse à Géarard », « Les Vordes »

Nom du site : Morains-le-Petit (Marne) – « Le Canal », « La Fosse à Gérard », « Les Vordes »Dates de fouilles : du 12 au 31 août 2012 Le site : Dans le cadre d’une prospection thématique sur les habitats néolithiques dans les marais de Saint-Gond, des sondages ont été programmés sur le site de « Pré à Vaches » et du « Canal ». Trois ou quatre fosses de plusieurs mètres de diamètre ont en effet été fouillées sur ces deux lieux-dits par A. Brisson, L. Coutier et A. Duval à la fin des années 20. Elles ont livré plus de 800 objets du Néolithique récent qui ont été récemment étudiés (Martineau L’absence d’accord, au préalable obtenu, de la part de l’exploitant de la parcelle de « Pré à Vaches » a nécessité d’effectuer les sondages sur les parcelles voisines du « Canal », de « La Fosse à Gérard » et des « Vordes ». Quinze sondages ont été réalisés, dont huit se sont avérés positifs. Les structures mises en évidence correspondent à quatre portions de fossés La quasi absence de mobilier dans la fosse FS1 et le fossé FO6 empêche toute datation de ces structures. La morphologie du fossé FO6 peut néanmoins être rapprochée des autres fossés mis au jour sur la parcelle voisine du « Canal ». Le fossé FO15 du SD15 est datable de la fin de la période gauloise, entre la fin du IIe et le Ier siècle av. J-C., et des deux premiers siècles ap. J-C. Il n’a pas été possible de savoir s’il s’agit d’une zone de rejet ayant entraîné ce mélange d’objets de deux périodes distinctes, ou si le fossé a été comblé en deux phases successives. Le fossé FO8 du SD13 présente un comblement datable aussi du IIe siècle ap. J-C. La céramique des autres fossés et fosses du « Canal », dont une grande fosse polylobée, sont par contre attribuables à La Tène C-D. Ces quelques sondages ponctuels ont permis de mettre en évidence la présence d’un établissement rural comportant deux périodes d’occupation, l’une datée de La Tène C-D, et sans doute plutôt de La Tène D par la céramique, et la seconde de la période gallo-romaine, au plus tard du IIIe siècle.
Responsable : Rémi Martineau (Chargé de recherche CNRS – UMR 6298 ArTeHiS)
Encadrement : Anthony Dumontet (Assistant Ingénieur – UMR 6298 ArTeHiS)
et al. à paraître).
à profil en U et à fond plat et à six fosses. Elles mesurent en général moins de 40 cm de profondeur, sauf pour la fosse FS1 qui dépasse 1 m 40. Le comblement de cette fosse atteste sa contemporanéité avec le fossé FO6.
Fouilles de Loisy-en-Brie « 56 grande rue »

Nom du site : Loisy-en-Brie (Marne) – « 56 Grande Rue » Le site : Une minière de silex néolithique a été découverte fortuitement dans le cadre d’une prospection thématique sur les sites néolithiques dans les marais de Saint-Gond et leur périphérie. Les travaux d’excavation liés à la construction d’une maison on mis au jour six fosses visibles sur une coupe de 25 mètres de long. Menacé de destruction par l’aménagement imminent du jardin, le site fut fouillé en urgence du 17 au 24 octobre 2012. Creusées en pleine craie, les fosses sont de dimensions et de morphologie très variables. Certaines ont un diamètre atteignant plus de trois mètres et l’une d’entre elles s’étend sur plus de quatre mètres. Elles ont été creusées à un peu moins d’un mètre de profondeur pour extraire le silex qui forme dans la craie campanienne un banc horizontal de rognons pouvant atteindre plus de trente centimètres de long. Trois fosses présentent des niches Les déchets de taille du silex sont présents en grande quantité dans les dernières phases de comblement des fosses. Le corpus lithique s’élève à plus de 500 pièces, principalement réparties entre les fosses B, E et F. Il est composé de 34 nucléus de plusieurs types et de 224 éclats. Il n’y a bien entendu aucun outil. Seuls 13 des rognons de silex n’ont pas fait l’objet Les structures mises au jour étaient en nombre limité, mais il ne faut aucun doute qu’il en existe des dizaines dans la partie conservée de la même parcelle et que le site s’étend sur une grande surface dans la partie sud du village. Cette découverte ouvre d’importantes perspectives pour l’étude des minières de silex dans ce secteur et permet de relancer la problématique à l’échelle régionale. L’objectif est maintenant de dater au radiocarbone les
Dates de fouilles : du 17 au 24 octobre 2012
Responsable : Rémi Martineau (Chargé de recherche CNRS – UMR 6298 ArTeHiS)
Equipe de fouilles : Anthony Dumontet (Assistant Ingénieur – UMR 6298 ArTeHiS) et Jean-Jacques Charpy (Conservateur en chef honoraire)
Participation de : Jean-Paul Thevenot (Chercheur associé – UMR 6298 ArTeHiS) et Jehanne Affolter (Chercheur associé – UMR 6298 ArTeHiS)
d’extraction.
de tests, tandis que 42 rognons ainsi que 12 plaquettes ont été testés. Quinze esquilles de bois de cerf ont été retrouvées dans les fosses D et F. Treize échantillons de charbons de bois ont été prélevés pour permettre des datations radiocarbones de la minière.
échantillons de charbon de bois et de bois de cerf prélevés dans les fosses d’extraction, afin de connaître la période d’exploitation de cette minière. Il s’agit en effet de savoir si elle fut contemporaine de l’hypogée des « Gouttes d’Or » situé à moins d’un kilomètre, sur la même commune.
Etude de l’enceinte médiévale de Metz / campagne 2012

Responsable : Julien Trapp (Historia Metensis) Le site : L’enceinte médiévale de Metz a été construite durant le premier quart du XIIIe siècle afin de mettre à l’abri les quartiers s’étant développés à l’extérieur du rempart de l’Antiquité tardive, englobant 160 ha grâce à 5500 mètres de muraille. De nombreuses modifications ont été apportées entre la fin du XIIIe siècle et le milieu du XVIe siècle, avant de devenir obsolète avec la mise en place du système Vauban à la fin du XVIIe siècle. Objectifs et résultats : L’étude menée par l’association Historia Metensis (Metz) consiste principalement au relevé topographique des différents éléments de la fortification médiévale de Metz, aussi bien en plan qu’en élévation, et ceci en quatre campagnes. Les données de terrains ont été confrontées aux sources conservées en archives afin de déterminer les différentes phases de construction et de réfection de l’édifice militaire. La campagne de 2012 a concerné un tronçon de 165 m comprenant le mur de courtine de l’enceinte primitive du XIIIe siècle. À cette époque, la poterne en Chandellerue, encadrée de ses deux tours semi-circulaires, y est percée. Cette partie de l’enceinte était protégée par trois tours dites « de la Cité » (dénomination due à leur entretien par la ville). Elles étaient percées par des archères, mais les sources montrent qu’au tournant des XVe et XVIe siècles, elles sont remplacées par des canonnières. Cette adaptation à l’évolution de l’artillerie est également visible par la construction d’un mur de fausse-braie, percée de meurtrières, à la fin du XVe siècle. À partir du milieu du XVIe siècle, l’enceinte devient obsolète et la poterne en condamnée. Finalement, une partie des murs de courtine et de fausse-braie est détruite et le reste remblayé sur 5 m au début du XXe siècle, au cours de la première annexion allemande. La nouvelle campagne de relevé aura lieu le 10 mars 2013 et concernera un tronçon ayant subit de nombreuses modifications aux XIVe et XVIe siècles, notamment avec l’ajout d’un mur de fausse-braie au nord de la porte des Allemands.
Partenaires : D.R.A.C. Lorraine, Ville de Metz, Pôle d’archéologie préventive de Metz-Métropole
L’équipe : Mylène Didiot, Aurore Duchêne-Gasseau, Nicolas Gasseau, Maxime Henault, Pierre-Marie Mercier, Nathalie Pascarel, Pierre-Edouard Wagner, Sébastien Wagner
Collaborateurs ARTEHIS : Anthony Dumontet, Anne Wilmouth
Date du relevé : 17 février 2012



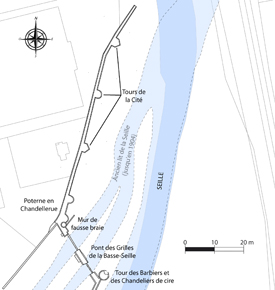
Fouilles programmées de l’établissement rural antique des « Crassées » à Saint-Dizier (Haute-Marne)

Nom du site : Saint-Dizier, « Les Crassées », secteur de l’établissement rural antique Les objectifs de la fouille Les diagnostics et fouilles menés dans les années 1990-2000 aux « Crassées » mêmes et sur près de 30 hectares de haute terrasse de la Marne, permettent de raisonner sur une échelle qui dépasse celle du « site archéologique ». En 2002, la découverte des trois tombes aristocratiques du VIe s. de notre ère à 250 m de salles balnéaires antiques fouillées dans les années 1960 soulève de nouvelles questions historiques (TRUC 2008, TRUC 2009, TRUC 2010, TRUC 2012, PARESYS, TRUC 2009). Le voisinage de la uilla gallo-romaine à qui appartient les bains a-t-il un sens ? Les aristocrates du VIe siècle n’en sont-ils pas d’une manière ou d’une autre les héritiers économiques et/ou fonciers ? Depuis les publications des salles balnéaires par Louis Lepage, l’établissement est réputé pour le corpus céramique de l’Antiquité tardive qu’il fournit, et qui prouve l’occupation soutenue du bâtiment résidentiel au moins jusqu’à la moitié du IVe siècle (LEPAGE 1970 et 1992). En revanche les niveaux d’abandon que Louis Lepage fouille ne contiennent aucun indice qui puisse être contemporain de la chefferie mérovingienne, et il faut attendre le Xe siècle pour voir réapparaître deux cabanes semi-excavées et un four construits en bordure extérieure du bâtiment gallo-romain. Leur présence implique celle d’un habitat contemporain à cet endroit, dont l’agencement est manifestement conditionné par un parcellaire hérité de l’Antiquité. Ces éléments font échos à l’organisation de l’habitat médiéval fouillé par l’Afan au sommet de la pente dans les années 1990, qui elle aussi tient compte de quelques murs antiques. L’évolution qui mène l’établissement de l’Antiquité tardive jusqu’à son abandon ou à sa transformation est donc une des principales problématiques de cette nouvelle mission. L’attention se porte autant sur les maçonneries de l’Antiquité que sur d’éventuels aménagements postérieurs. Si le bâtiment résidentiel des « Crassées » tombe probablement bien en ruine durant l’Antiquité tardive, et si un habitat groupé et son cimetière sont bel et bien créés ex nihilo au Haut Moyen âge, la multiplication des observations archéologiques réalisées dans ce secteur suggère une relation historique entre les deux occupations. La mise en évidence de la proximité géographique d’une élite gallo-romaine et mérovingienne à Saint-Dizier est ainsi une occasion exceptionnelle d’étudier les transformations qui mènent de l’une à l’autre, et de s’affranchir d’une frontière historique trop arbitraire. Afin d’enrichir les informations sur l’occupation médiévale, une fouille est menée de manière conjointe par Stéphanie Desbrosse-Degobertière sur la nécropole qui se développe au Haut Moyen à moins de 100 m du bâtiment résidentiel antique. Elle a lieu depuis l’été 2011. Résultats de la campagne de 2012 L’objectif de cette campagne était d’apporter des précisions sur la forme, la datation et la nature du secteur fouillé à trois reprises au XIXe et XXe siècles. Elle permet d’identifier avec certitude ces salles comme celles de bains privés relativement classiques pour un établissement rural de Gaule Belgique. Ils sont construits à une extrémité du bâtiment résidentiel, dont le reste n’est pas encore connu. Ce secteur n’est pas construit avant la fin du IIe siècle, ce qui demeure tardif par rapport aux exemples connus par ailleurs. Il est fort possible que des bains antérieurs existent à proximité, ou tout du moins un autre bâtiment résidentiel, car le mobilier répandu autour de l’édifice montre une occupation soutenue au moins dès le début du Ier siècle de notre ère. Toute la construction du bâtiment est conditionnée par l’approvisionnement en eau courante du frigidarium. Ses murs sont donc construits en premier, afin de les accoler au plus près de la pente d’où sourde une source, et aussi pour canaliser l’eau dans un profond caniveau afin de ne pas inonder le reste du chantier. A une date que l’on situe actuellement au plus tôt dans le dernier quart du IIIe siècle, les bains sont transformés. Le secteur chauffé est diminué de moitié côté ouest mais en partie agrandi côté est, pour une raison inconnue. Il oblige les bâtisseurs à reconstruire un canal de chauffe au praefornium. Pour une raison tout autant inconnue, les salles servant de sas thermique entre le caldarium et le bassin du frigidarium occupent davantage de place. Le frigidarium semble même séparé du reste des bains par les vestiaires qui sont étendus jusqu’à lui. Quant à la vidange d’origine du bassin froid, elle devient hors d’usage à une date inconnue, peut-être différente de celle des travaux précédents. Elle n’est pas réparée mais remplacée par un caniveau extérieur au bâtiment et aérien. Les bains doivent rester en fonction au moins dans la première moitié du IVe siècle, à l’image du mobilier trouvé dans les cendres du preafornium. Le tesson décoré par une molette du début du Ve siècle découvert cette année dans les déblais de Louis Lepage montre qu’une fréquentation se poursuit au moins jusqu’à cette date, sous une forme inconnue qu’il paraît crucial de déterminer dans les années à venir. Bibliographie
Dates de fouilles : du 11 juin au 06 juillet 2012
Responsable : Raphaël Durost (chargé d’opération et de recherche INRAP – UMR 6298 ARTeHIS)
Collaborateurs : Anne Delor-Ahü (chargée d’opération et de recherche INRAP – UMR 7041 ArScAn), Stéphanie Desbrosse-Degobertière (chargée d’opération et de recherche INRAP – UMR 6273 CRAHAM), Gilles Fronteau (Maître de conférences, Université de Reims Champagne-Ardenne – EA 3795 GEGENA²).


Sondages sur les vestiges du pont médiéval de Taillebourg (Charente-Maritime) / campagne 2012
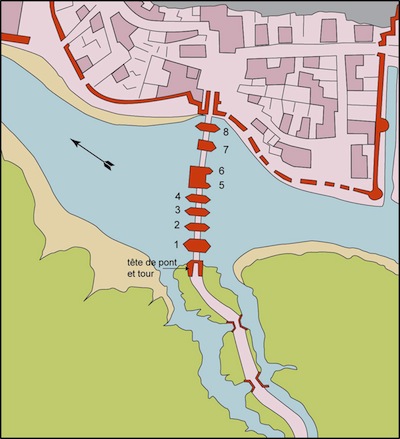
Date : mars 2012 1. Problématique Les prospections subaquatiques menées depuis 2002 par J.-F. Mariotti ont mis en lumière l’existence d’un important gisement immergé entre les communes de Taillebourg et de Port d’Envaux, qui recèle de nombreux témoins d’une zone portuaire (embarcations, digues, matériel halieutique, outils agricoles, etc.), datés principalement des époques mérovingienne et carolingienne. Les vestiges sont répartis dans une portion de fleuve localisée au pied d’une éminence nommée La Garenne, et les structures conservées sont localisées sur des points de plus forte résistance, appelés hauts-fonds ou seuils. Les investigations subaquatiques ont été concentrées sur ces points qui, chaque année, ont fait l’objet de recherches et du relevé exhaustif des vestiges découverts (Dumont, Mariotti dir., à paraître). En 2007, une brève investigation sur le seuil n° 6, où se trouvait le pont médiéval, avait permis de faire un premier relevé et de dater par 14C des échantillons prélevés sur sept pieux de fondation repérés en 2006 par A. Deconinck (Dumont, Mariotti 2009). Les analyses radiocarbone permettent de rattacher ces vestiges à un intervalle allant de la fin du IXe s. au tout début du XIe s. Un seul bois, un peu plus récent, se rattache à l’intervalle début XIe – milieu du XIIe s. Les résultats obtenus conduisent à penser que ce pont, ou du moins un état de pont, a pu être construit soit au Xe s., soit juste après l’an mille. Les objets découverts anciennement à ses abords comportent des éléments des IXe et Xe s. (épées), venant confirmer l’intérêt stratégique de ce lieu, ainsi que l’existence d’un franchissement du fleuve, au moins dès cette époque. 2. Rive droite : datation dendrochronologique des pieux de fondation Près de la rive droite, six pieux en chêne ont pu être suffisamment dégagés afin d’être tronçonnés in situ. Ce travail a été rendu difficile par la présence de nombreux amas de pierres et de blocs, témoins des destructions successives dont le pont a été l’objet au cours du XIXe s. Deux bois possèdent leur dernier cerne sous écorce, et un autre un aubier presque complet, mais difficile à lire tant les cernes sont minces et abimés. L’analyse dendrochronologique, effectuée par C. Lavier, montre que cinq bois ont pu être mis en œuvre, après la coupe (entre la fin d’année 997 et l’hiver/printemps suivants), au cours de l’année 998. Le sixième a été employé plus tardivement, son dernier cerne sur aubier incomplet se placerait en 1110. Rive gauche : découverte de deux piles en pierre Près de la rive gauche, les prospections ont permis de découvrir deux bases de piles qui n’avaient encore jamais été vues. Ces massifs correspondent aux piles 1 et 2 des plans de Cl. Masse et des ingénieurs des Ponts et Chaussées. Ces plans, levés respectivement au XVIIIe et au XIXe s., permettent de restituer en partie l’ouvrage, d’en connaître le nombre de piles et de les localiser par rapport à la configuration actuelle du fleuve (fig. 2). Le massif de la pile n° 2 Dans son état actuel, ce massif forme un rectangle dont le plus grand côté, disposé perpendiculairement au chenal, mesure 4 m, et le petit côté, parallèle au chenal, 3.85 m. Il apparaît évident qu’une partie a été très perturbée par les dragages car de nombreux blocs d’architecture, dont certains de grandes dimensions, se trouvent pêle-mêle dans le chenal, aux abords immédiat de cet ensemble. L’avant-bec et l’arrière-bec, qui étaient de forme triangulaire d’après les deux plans d’archive connus, ont été cassés. Ainsi, ce massif était plus long à l’origine. Le massif de la pile n° 1 De ce massif, on ne voit que deux grandes pierres rectangulaires, taillées en auge et munie d’un rebord. En aval immédiat se trouvent de nombreux blocs d’architecture qui ne sont plus en place et au milieu desquels deux objets étaient visibles : une hache, vraisemblablement d’époque contemporaine et une corne d’appel en céramique, comparable à un autre exemplaire découvert non loin, dans l’un des couloirs de prospection. Bibliographie BLOMME Y., 1988. Les enceintes urbaines et villageoises de Saintonge et d’Aunis. Etude topographique. Bulletin de la Société des Antiquaires de l’Ouest et des musées de Poitiers, vol. 2 (1988), p. 3-32. DEBORD A., 1980. Les bourgs castraux dans l’ouest de la France. Châteaux et peuplements en Europe occidentale du Xe au XVIIIe siècle. Ier colloque international de Flaran, Auch, 1980, p. 57-73. DEBORD A., 1984. La société laïque dans les pays de la Charente, Xe-XIIe siècles. Paris : Picard. DUMONT A. MARIOTTI J.-F. (dir.). Archéologie et histoire du fleuve Charente. Taillebourg – Port d’Envaux : une zone portuaire du haut Moyen Âge sur le fleuve Charente. Editions universitaires de Dijon, collection Art, Archéologie et Patrimoine, Dijon, sous presse. DUMONT A., MARIOTTI J.-F., 2009. Die mittelalterliche Charentebrücke von Taillebourg. Actes du colloque international Archäologie des Brucken/ Achaeology of bridges, Regensburg/Ratisbonne, 5-8 nov. 2009.
Responsable : Annie Dumont, Ministère de la Culture (DRASSM) et UMR 6298 ARTeHIS
Participation de :Catherine Lavier (dendrochronologie – CNRS), Philippe Moyat, Jean-François Mariotti, Jonathan Letuppe (Eveha),Georges Lemaire (DRASSM), André Deconinck (bénévole), Thierry Hoffmann (bénévole)
Le pont de Taillebourg a été édifié au pied d’une hauteur sur laquelle fût construit un château, attesté dans les textes à partir de 1007 ; celui-ci dominait la Charente et permettait le contrôle des marchandises transportées sur le fleuve (Debord 1980 et 1984, p. 53). Un prieuré de l’abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe se trouvait également sur cet éperon ; la plus ancienne mention de cet établissement date des environs de 1100 (cartulaire de Saint-Cyprien-de-Poitiers) mais on en ignore la date de fondation. Il était protégé par une enceinte enserrant une douzaine d’hectares (Blomme 1988). Situé en aval de Saintes, importante agglomération antique devenue siège épiscopale, Taillebourg contrôlait le premier pont permettant de franchir la Charente lorsque l’on venait de la côte atlantique. Ce pont était accessible même lorsque la plaine était inondée car il était prolongé, rive gauche (commune de Port d’Envaux), par une chaussée surélevée appelée Chaussée Saint-James, encore visible dans le paysage actuel. Il est connu pour avoir été le siège de la bataille du 22 juillet 1242, qui vit la victoire de Louis IX sur Henry III d’Angleterre. Le vieux pont de Taillebourg est ruiné en 1652, et il faut attendre 1891, soit plus de deux siècles, pour qu’un nouvel ouvrage soit reconstruit.
On ignore à ce jour les dates exactes de fondation de cette chaussée et du pont. Il apparaissait donc important de chercher à resserrer la fourchette chronologique obtenue grâce aux datations 14C en prélevant de nouveaux échantillons, afin de tenter une analyse dendrochronologique, ce qui constituait le principal objectif de la campagne de sondages menée en mars 2012.
Ces résultats sont cohérents avec les analyses radiocarbones effectuées il y a cinq ans. Les pieux ont été repris en topographie et replacés à nouveau sur les plans anciens (fig. 1). On voit nettement qu’ils sont liés aux piles 5 et 6 qui ont supporté le ou les moulins. Il reste difficile d’en comprendre l’organisation, car les tas de pierres et de blocs présents au fond, suite aux démolitions successives, masquent probablement un certain nombre d’éléments. Néanmoins, les résultats des datations radicarbone et dendrochronologiques permettent d’identifier deux phases de construction et/ou de réparation, la première à la toute fin du Xe s., la seconde au début du XIIe s. Le petit nombre de bois étudiés ne permet guère d’aller plus loin dans l’analyse.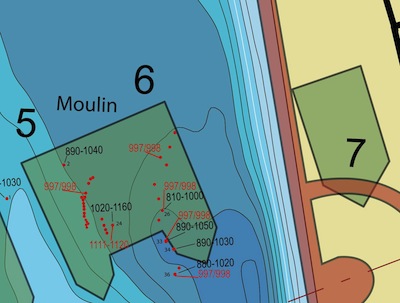
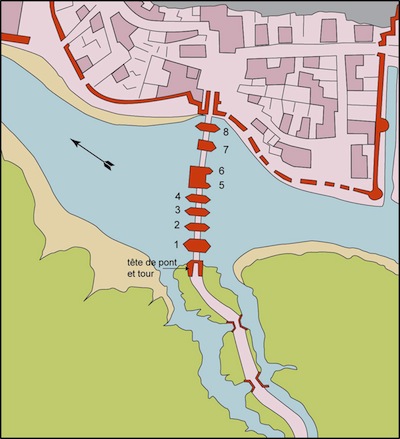
Il est constitué de deux grandes pierres taillées en auge, munies d’un rebord haut d’une vingtaine de centimètres. Ces pierres mesurent un peu plus d’1 m de large pour une longueur d’1,90 m environ. Celle qui se trouve en aval, côté rive gauche est cassée. Les rebords présentent également des fractures, traces de l’arasement de ces massifs. Entre ces grandes pierres, des blocs taillés de plus petites dimensions sont assemblés jointivement. Le relevé de ce massif reste pour le moment incomplet. Un retour sur le terrain est prévu en 2013 pour le terminer.
Une restitution 3D, réalisée à l’aide du logiciel Sketchup, permet de bien visualiser le mode de construction et le caractère monumental de cette base de pile. La construction est originale, et pour le moment, il n’a pas été trouvé de comparaison directe. Cependant, on doit noter que les fouilles de massifs de piles de ponts, quelle que soit la période concernée, restent rares. Le dispositif des grandes pierres taillées en auge pourrait correspondre à une sorte de système autobloquant : les pierres assemblées ou maçonnerie posées dessus, qui formaient l’élévation de la pile, étaient maintenues, à la base, à l’intérieur d’un cadre de pierre. Une recherche dans les traités d’architecture et de construction de ponts est en cours pour tenter de trouver une construction similaire.
Il est probable que le reste de cette base de pile soit conservée sous le remblai qui la recouvre, côté rive gauche. Cette pile était la première implantée dans le chenal et était reliée à la culée du pont surmontée d’une tour. La présence des deux cornes d’appel dans ce secteur pourrait être mise en relation avec la garde du pont.
Les dimensions des deux grandes pierres sont très proches de celles qui forment les côtés de la pile 2, et on peut en déduire, sans trop prendre de risque malgré le caractère inachevé de cette étude, que ces piles sont de même factures et sont contemporaines. Néanmoins, il est pour le moment impossible de les dater dans l’absolu, aucun bois de fondation n’étant visible dans ce secteur recouvert de nombreuses pierres. Trois petits sondages d’ampleur très limitée ont été tentés le long de la pierre amont de la pile 1, mais ils n’ont pas permis de voir si des bois pouvaient se trouver contre ou sous cette pierre. Il faudrait en faire d’autres, plus étendus, afin de vérifier s’il existe sous ces bases de piles un grillage de poutres horizontales, comme cela a été mis en place à Saintes, et a été observé par les personnes chargées de détruire le pont de Taillebourg au XIXe s. (Archives départementales de Charente-Maritime).
Les dater permettrait de savoir si l’on se trouve en présence d’une phase contemporaine ou non de celles qui ont été mises en évidence par les analyses radiocarbone et dendrochronologiques effectuées sur les pieux de fondations conservés près de la rive opposée, à savoir, à la fin du Xe s. et au début du XIIe s. Il est possible que les piles 1 et 2, espacées de 7 m, aient été construites lors d’une autre étape de construction et/ou de réfection, les ponts qui ont perduré pendant sept siècles (durée minimale de d’utilisation du pont de Taillebourg), ayant été l’objet de nombreuses réparations ou reconstructions partielles (Mesqui 1986).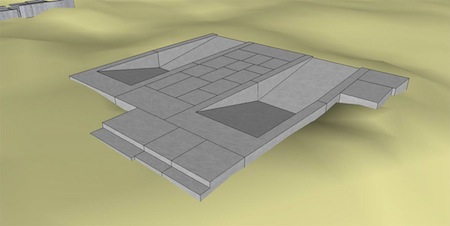
Gevrey-Chambertin (21) : un vignoble gallo-romain / campagnes 2008-2012

Responsable : Jean-Pierre Garcia (PR. Université de Bourgogne) Lors du décapage préamable aux fouilels préventives de l’INRAP en 2008 sur le site « Au-dessus de Bergis » (R.O. Sébastien Chevrier), en plus des structures archéologiques attendues, sont apparues des fosses rectangulaires alignées en au moins 31 rangs orientés presque Nord-Sud sur plus de 110 m de longueur. Les extrémités sud des rangs sont alignées parallèlement à une structure de parcellaire (haie) qui délimite le lieu-dit « Au-dessus- de-Bergis » au Sud. Sondage sur la partie nord-ouest du site Gevrey-Chambertin-Brochon (2011) Fouille et relevé des fosses de plantation (2009) cliché: J.-P. Garcia Les rangs de fosses de plantation (2008) cliché: J.-P. Garcia L’ordonnancement des rangs laissait penser à la vigne, très présente et célèbre sur la commune de Gevrey-Chambertin, et à proximité même du site, mais aussi à des vergers ou à d’autres plantations arbustives. Les fosses rectangulaires possèdent des bords abrupts tandis que leur fond n’est pas plat mais présente deux creusements séparés par un « bourrelet » médian. Ce compartimentage bien particulier a été reconnu pour la quasi totalité des fosses. La fouille minutieuse a laissé apparaître pour certaines des rangs concentriques de pierres arrangées autour d’un conduit vertical, rempli de limon brun qui évoquent la présence d’un tronc de végétal tout comme les traces de racines visibles sur les coupes, un caractère allant dans le sens de l’interprétation de fosses de plantation. Le matériel trouvé dans ces fosses reste pauvre mais exclusivement d’époque romaine : il constitué de rares tessons de céramique émoussés et de débris de tuiles (tegulae). Ces éléments sont les témoins conservés des fumures administrées lors de la culture de la vigne. Les éléments identifiables sont des fragments de gobelets de la fin du Ier ou de la première moitié du IIème s. ap. J.-C, des IIe et IIIe s. (ateliers d’Autun) et des clous, avec parmi eux, des clous de chaussures dont le type est connu au Ier siècle ap. J.-C. les fosses de plantation après fouille, vidées de leur remplissage cliché: J.-P. Garcia De petits trous de faible diamètre (10 cm au maximum), remplis de limon brun, imprient très superficiellement le substrat à proximité des fosses de plantations. Certains apparaissent alignés parallèlement et à l’Ouest des rangs de plantation, à moins d’un mètre de distance du rang. Ce sont des traces de piquets d’un système de palissage complexe dont àon a tenté uen restitution. une reconstitution du vignoble gallo-romain d’après les structures archéologiques conception: J.-P. Garcia; DAO: M. Foucher les fosses de plantation accompagnées de petites fosses de provignage cliché: J.-P. Garcia les fosses de plantation en cours de fouille (2009) cliché: J.-P. Garcia Le vignoble gallo-romain de Gevrey-Chambertin s’insère dans un ensemble de cultures et d’exploitations agricoles gallo-romaines dont témoignent le réseau des villae de la plaine de la Sâone. Si sa limite est n’est pas connue, le vignoble apparaît limité au sud par une haie ou palissade. Des prospections géophysiques magnétiques et des sondages ont permis de placer sa bordure ouest et Nord (haies) ce qui porte la superficie connue de la vigne à 125 m x 250 m environ, soit à près de 3 ha. De même, il fallait s’attendre à trouver à proximité du vignoble des bâtiments d’exploitation comme l’on montré d’autres cas d’études de vignobles antiques en France (Hérault, Drôme, Var, Gard, Vaucluse, Charentes, Rhône etc.) qui sont souvent immédiatement adjacents à des bâtiments de villae. Ces lieux de production de vin possèdent des pressoirs, fouloirs, chais qui laissent des traces archéologiques. Cependant les prospections géophysiques n’ont pas permis de localiser ces bâtiments qui ont peut être été détruits par les aménagements à l’Est de la vigne, sous la zone industrielle de Gevrey-Chambertin-Brochon. Prospection géophysique magnétique pour délimitation du site (2010) cliché: J.-P. Garcia Sondage de délimitation du site (2012) cliché: J.-P. Garcia Prospection géophysique magnétique pour délimitation du site (2011) cliché: J.-P. Garcia Sondage d’une fosse néolithique (2011) cliché: J.-P. Garcia Le vignoble antique de Gevrey-Chambertin est, à ce jour, le premier argument direct et le plus ancien de la viticulture antique en Côte-d’Or après les pépins de raisin datés de 254 ap. J-C, trouvés dans la villa viticole des Tuillières à Selongey (Côte-d’Or). Il rejoint les arguments indirects (pollens, outils, restes organiques, mobilier) d’une production viti-vinicole locale au IIème-IIIème s. et peut-être même à partir du milieu du Ier s. en Côte-d’Or. Publications principales : [RAE 2010] Le vignoble gallo-romain de Gevrey-Chambertin « Au-dessus-de Bergis », Côte-d’Or (Ier-IIe s. ap. J.-C.) : modes de plantation et de conduite de vignes antiques en Bourgogne
Site de Gevrey-Chambertin « Au-dessus de Bergis » et Brochon « Entre Les Ruisseaux » : un vignoble gallo-romain au pied des coteaux bourguignons. (2008-2012)
Participation de : Florent Delencre (doctorant uB), Amélie Quiquerez (MCF uB), Gilles Hamm (CNRS, UMR ARTEHIS), étudiants master AGES 2009-2012
En partenariat avec : fouilles préventives INRAP 2008 (R.O. Sébastien Chevrier)
Dates de chantier : fouilles programmées 2009, 2010, 2011, 2012
Financements : Région Bourgogne (programmes DINOS), UMR ARTEHIS
Le site
Les structures de plantation et l’extension du site ont pu être étudiées lors du chantier d’archéologie préventive de 2008 puis par la suite en fouilles programmées (caampgnes 2009, 2010, 2011 et 2012). Ainsi a pu être délimité l’emprise totale de la vigne et son environnement agraire sur la commune de Gevrey-Chambertin et sur la commune limitrophe de Brochon.


Des traces de plantations de vignes gallo-romaines
La présence des fosses latérales et moins profondes témoigne de la technique ancienne du provignage destinée à propager la vigne de manière végétative. Elle constitue un critère décisif d’identification de cette plantation comme celle d’un vignoble.
Les dimensions des fosses qui suivent une métrique rigoureuse est peu parlante dans nos unités de mesures, mais quand on l’exprime en pieds romains (1 pied = 29,7 cm), les fosses étudiées ont des dimensions en chiffres ronds: Longueur ≈ 3 à 4 pieds ; largeur ≈ 2 pieds ; espacement ≈ 3-4 pieds ; distance entre les rangs ≈ 10 pieds. C’est un indice pour interpréter cette plantation comme un vignoble d’époque romaine et on retrouve d’ailleurs ces dimensions dans les recommandations de Columelle et d’autres agronomes latins
Des éléments d’encadrement chronologique viennent conforter cet âge : installation à la fin du Ier s.-1ère moitié du IIe s., disparition au cours ou après le IIIe s.. Ce sont :
-les ossements d’un chien déposé dans une fossé (datés par radiocarbone entre 54 av. J.-C. et 71 ap. J.-C) situés sous les plantations et précédant l’installation du vignoble;
-une haie qui fait limite parcellaire et qui recoupe les rangs de plantations, datée postérieurement au IIIe s. ap. J.-C.
– une structure calcinée avec charbons de bois de noyer, excluant la présence de la vigne à cette époque sur le site, datée du Vème au VIème s. ap. J.-C.
Un vignoble élaboré
S’il est très vraisemblable que la vigne était conduite sur échalas et sur des perches horizontales de bois ou de roseaux en jugum (« joug ») comme l’indiquent les textes antiques,
une des hypothèses de restitution, fait imaginer un système de palissage oblique qui optimise l’énergie lumineuse reçue pour ce vignoble septentrional, installé en plaine humide, pour lequel le séchage des feuilles et des baies par le soleil matinal est primordial, non seulement pour le mûrissement des raisins mais aussi pour limiter les maladies de la vigne.
Ainsi restitué, ce vignoble s’inspire d’un mode de conduite dit « en pergolette », connu encore actuellement dans le nord de l’Italie ou sur les représentations médiévales italiennes des XIVème et XVème s.
Une telle architecture répond aux normes actuelles de production viticole et avec 2000 à 3000 pieds/ha, le vignoble antique de Gevrey-Chambertin serait proche, par son mode de conduite palissé, de l’optimum associant production en quantité, production de qualité, et ressource en eau.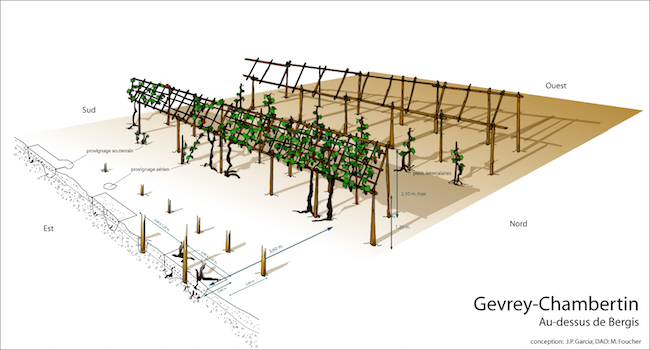


Délimitation du site
En revanche, ces prospections ont permis de mettre au jour des fosses dépotoirs et une occupation du Néolithique moyen inédites (Chasséen de plaine) qui seront publiées à la suite.



La question des terroirs viticoles
Ces vignes gallo-romaines participaient au vignoble de la cité des Lingons ou de celle des Eduens que décrit, dans leur décrépitude, le célèbre panégyrique de 312 ap. J.-C. en l’honneur de l’empereur Constantin (Panégyriques latins VI, 4-8). Sa situation est conforme à cette description du Pagus Arebrignus (la Côte de Nuits et de Beaune), pays doté de vignes, entre la Saône et les hauteurs rocailleuses « sûrs repaires de bêtes sauvages », dans la plaine humide en aval des sources du pied des collines, au milieu des marécages, des mares, des canaux et des villae qui exploitent ces terroirs.
Cette situation contraste avec celle que l’on attribue aujourd’hui à un vignoble de qualité en Bourgogne. Appartenant à un terroir situé à moins de 200 m des vignes actuelles les plus basses en altitude et dans la hiérarchie des crus de l’Appellation Gevrey-Chambertin, il constitue de fait un point important pour la compréhension de la construction des terroirs bourguignons, témoignant d’une considération antique pour les terroirs viticoles différente des conceptions médiévales et actuelles qui réservent les coteaux aux meilleurs crus.
Sa situation en plaine pose la question de l’implantation de la vigne sur les coteaux, que la datation des sols viticoles des versants place, dans l’état actuel des connaissances, à partir du haut moyen Âge. C’est dans cette période charnière de l’antiquité tardive, entre le IIIe s. et le Ve s., que se situe ce changement important à la fois climatique, culturel, social, économique et politique, qui est peut-être général en Gaule devenue chrétienne.
Le complexe monumental antique de La Genetoye (Autun, Saône-et-Loire) : principaux résultats de la campagne de fouilles 2016

Resp. : Ph. Barral, F. Ferreira, M. Glaus, Y. Goubin, M. Joly, Y. Labaune (coord.), P. Nouvel, M. Thivet Le complexe antique suburbain de La Genetoye (Autun, Saône-et-Loire) est situé à quelques encablures de l’enceinte d’Augustodunum, à la confluence entre les rivières Arroux et Ternin. Il est l’objet d’un projet collectif de recherches qui a démarré en 2012 et qui bénéficie du soutien de la DRAC, de la ville d’Autun, de l’Inrap et de Bibracte. Il repose sur une collaboration scientifique qui associe plus particulièrement deux équipes universitaires / CNRS (Université de Franche-Comté – UMR 6249 Chrono-environnement, Université Paris-Sorbonne – UMR7919 Orient et Méditerranée) et le service archéologique d’Autun. Les fouilles menées depuis 2013 ont principalement concerné l’espace situé à l’est de la tour conservée en élévation, où se situait le dispositif d’entrée à l’époque antique. Elles ont montré la présence de vestiges d’occupation laténienne, c’est-à-dire de la fin de l’époque gauloise, contemporains de Bibracte et antérieurs à la fondation de la ville romaine d’Augustodunum. Ils suggèrent la présence d’un lieu de culte pré-romain, dont l’aspect reste difficile à préciser dans l’état actuel des recherches. Il semblerait que les éléments structurants principaux dans l’organisation du sanctuaire se mettent en place à une date précoce, contemporaine des premières occupations d’Autun, et soient pérennisés par la suite. Un premier temple entouré d’une galerie périphérique (péribole) délimitant l’espace sacré est construit dans les années 50 ap. J.-C. Sa durée de vie semble plutôt courte puisque quelques décennies plus tard (vers la fin du Ier s. ou le début du second) un second temple, plus grand, est reconstruit. Il comporte semble-t-il de grandes similitudes avec le précédant : les vestiges de sa tour centrale sont ceux que nous pouvons encore apercevoir. Le site est réoccupé à l’époque médiévale aux alentours de l’An Mil (XIe-XIIe s. ?) : un large fossé est creusé autour de la tour centrale du temple, utilisée de manière opportune comme fortification, ce qui a certainement permis sa conservation. Les fossés sont comblés et la tour très certainement abandonnée à la fin du Moyen-Age. Enfin, la fouille a également montré la présence d’un bâtiment de la fin du Moyen-Age, construit sur sous-sol, muni d’une forge. Il s’agit probablement d’un petit établissement rural. Le monument visible est construit sur un premier espace monumental pour lequel nous n’avons que quelques indices mais aucune identification n’est possible. S’agit-il d’un autre théâtre ? (construction dans la première moitié du Ier siècle pour ce monument inconnu). Les parties inférieures du théâtre ont été dégagés pour la première fois, ce qui nous a permis de raisonner sur son élévation et son plan de façon générale. Les structures observées offrent un excellent état de conservation. Le théâtre bénéficiait de rangs de gradins inférieurs pour les notables de la ville d’Autun, ce qui explique leur embellissement et leur réorganisation à une date indéterminée. On perçoit une gestion organisée des eaux pluviales, par la présence d’une canalisation. Les résultats cumulés des prospections géophysiques et des sondages ciblés réalisés depuis 2012 en périphérie des édifices monumentaux attestent du développement vers l’ouest d’un vaste quartier d’artisans inédit à la Genetoye. Les opérations de 2013 et 2014 avaient permis d’une part, d’obtenir une première image de la structuration spatiale du quartier, et d’autre part, de confirmer la présence de plusieurs ateliers de potiers au sein de ce vaste quartier artisanal. La production semblait alors majoritairement orientée vers les services à boire et les figurines en terre cuite blanche, malgré quelques indices ténus de métallurgie. D’un point de vue spatial, la limite Est du quartier (seul secteur sondé) apparait bordée d’un ensemble de bâtiments implantés le long d’un axe Nord-Sud permettant de relier le théâtre au temple de Janus. Ce programme cherche à répondre à quelques questions essentielles :
![]() Quel rôle le substrat d’occupation pré-protohistorique joue-t-il dans la genèse du complexe antique ?
Quel rôle le substrat d’occupation pré-protohistorique joue-t-il dans la genèse du complexe antique ?![]() Suivant quels rythmes et selon quelles modalités le complexe antique se développe-t-il et s’organise-t-il ?
Suivant quels rythmes et selon quelles modalités le complexe antique se développe-t-il et s’organise-t-il ?![]() Quelle est la part des facteurs naturels (notamment de la dynamique de la plaine alluviale) et des transformations humaines dans cette organisation ?
Quelle est la part des facteurs naturels (notamment de la dynamique de la plaine alluviale) et des transformations humaines dans cette organisation ?![]() Quels liens fonctionnels le complexe suburbain entretient-il avec la ville intra-muros ?
Quels liens fonctionnels le complexe suburbain entretient-il avec la ville intra-muros ?
Le temple de Janus (resp. M. Joly, Ph. Barral)
Ce grand temple apparaît ainsi enfermé dans un espace clos interne très étroit de 60 m de long par 40 m de large, où prennent place de surcroît différents bâtiments annexes.
La fréquentation cesse vers les années 250.
Le théâtre du Haut du Verger (resp. F. Ferreira)
Présentation générale
Un premier « petit » théâtre d’environ 70-80 m de diamètre est construit entre 50-80 après J.-C.
Entre la fin du Ier siècle et le début du IIe siècle, il est agrandi (116m de diamètre) et prend un caractère très monumental avec des nouvelles entrées notamment. Au début du IIIe siècle de nouveaux espaces d’accueil, montrant un lien très net avec le temple de Janus, sont construits.
Les découvertes de 2016
Comme dans la plupart des grands monuments publics, on ne retrouve que très peu de mobilier archéologique, ces édifices font l’objet d’un « nettoyage systématique » et les matériaux sont récupérés dès l’Antiquité.
L’étude du théâtre d’Autun confirme le « haut-standing » de vie qui était offert par les élites à l’ensemble de la population et Autun constitue un des rares exemples de ville où l’on retrouve deux fois le même type d’édifice de spectacle.
Le quartier artisanal (resp. M. Thivet)
La fouille réalisée en 2016, centrée sur un de ces bâtiments, a permis de confirmer la relation étroite qu’entretiennent ces édifices avec le quartier artisanal proche et dont la fonction pourrait correspondre à un ensemble de « boutiques/ateliers » destinés à la commercialisation d’une parties des productions. Parallèlement, la présence cette année de plusieurs témoins de métallurgie du bronze confirme la présence d’artisanats mixtes à la Genetoye.
D’un pont de vue chronologique, s’il est désormais possible d’attester de la fondation précoce (durant la première moitié du Ier s.) du quartier, l’important arasement des vestiges ayant détruit les occupations les plus récentes, nous ne disposons que de peu d’indices sur les phases d’abandon. Néanmoins les quelques observations réalisées en 2013 sur ces niveaux, conservés sous la démolition du théâtre, situe l’abandon définitif du quartier artisanal de la Genetoye vers le milieu du IIIe s.
Monastère Saint-Pierre D’osor / printemps 2011

Responsables : Sébastien Bully (UMR ArTeHiS), Miljenko Jurković (université de Zagreb-centre IRCLAMA), Morana Čaušević-Bully (universités de Zagreb et Paris XII), Iva Marić (université de Zagreb-centre IRCLAMA) Participation de Laurent Fiocchi (APAHJ) Dates de chantier : 16 mai au 18 juin 2011 Le monastère bénédictin Saint-Pierre d’Osor, sur l’île de Cres, aurait été fondé au début du XIe s. par saint Gaudentius, évêque de la cité. Engagée depuis 2006, la fouille programmée répond à plusieurs objectifs : il s’agit de comprendre les modalités de l’installation du monastère dans un contexte urbain d’origine protohistorique et antique et d’étudier une topographie monastique qui doit tenir compte à la fois des contraintes urbaines, mais également de constructions antérieures, peut-être déjà religieuses. L’analyse archéologique des vestiges de l’ancienne abbatiale Saint-Pierre complète les études d’histoire de l’art afin de préciser la datation d’un édifice considéré comme insigne pour l’architecture romane dans la région et révélateur des échanges et influences avec la côte adriatique occidentale (Pomposa, Italie). Les méthodes employées sont celles de l’archéologie du sous-sol, du bâti et les prospections géophysiques. La campagne 2011 a porté essentiellement sur la fouille du bas-côté sud de l’ancienne abbatiale, permettant de restituer le rythme des travées, les circulations – avec la découverte de deux portes – et la fonction funéraire (tardive ?) avec la mise au jour de plusieurs tombes en pleine terre et caveaux. Le plan de l’église a également été complété par la découverte d’une tour de clocher le long du mur sud et occupé par une chapelle funéraire contenant au moins deux caveaux maçonnés. Le principal apport de cette campagne reste cependant la mise au jour d’un second édifice à la fonction funéraire (chapelle, mausolée, église ?) au sud-ouest de l’église. La présence de cette construction, peut-être antérieure à l’église Saint-Pierre, est certainement à l’origine de la situation singulière d’un cloître localisé au sud-est de l’abbatiale. Le cloître, inconnu jusqu’alors, a été identifié par une prospection radar-sol (collaboration de l’unité Sisyphe-Paris VI, Christian Camerlynck, Virginie Cachier) sur la base d’observations dans la topographie et sur des élévations. BUCEMA, depuis 2006 : 
Le site :


Objectifs et résultats :

[En savoir plus]
Les monastères insulaires dans l’archipel du Kvarner / printemps 2011

Collaboration croato-française Dates de chantier : 9 au 14 mai, 20 au 30 juin 2011 Ce programme de prospection-inventaire porte sur monastères connus ou pressenties de l’archipel du Kvarner, dans le Nord-Est de l’Adriatique. Il s’agit d’identifier des sites monastiques à partir des sources écrites, des données archéologiques, architecturales et topographiques ; de définir les conditions et les modalités de leur fondation et de la diffusion du monachisme insulaire dans le Kvarner entre le Ve et le XIe s. : occupation du sol et voies maritimes, construction de l’espace. Le troisième axe de cette recherche intéresse les questions de topographie monastique et d’architecture cultuelle à travers les questions d’héritages et d’influences dans leur rapport avec le cénobitisme et l’érémitisme. L’exécution de ce programme passe un dépouillement bibliographique, des sondages archéologiques, des études de bâti, la constitution d’une documentation graphique et photographique, des prospections pédestres et géophysiques. La campagne 2011 a porté sur deux premiers sites : Saint-Pierre sur l’îlot d’Ilovik et Martinšćica sur l’île de Cres. Les sondages menés à Ilovik ont permis de confirmer une hypothèse émise lors d’une première campagne en 2010 à partir de sondages réalisés dans les élévations de la clôture du cimetière du village. Selon l’historiographie du site, le cimetière aurait été installé dans la clôture d’un petit monastère du XIe s. Les sondages confirment une occupation médiévale du site, mais surtout que le monastère – puis le cimetière – s’est installé dans les ruines d’une vaste basilique paléochrétienne inédite, dotée d’un vestibule et dont la fonction funéraire est attestée. Le second site de Martinscica est connu à travers les vestiges d’une église à plan en croix grecque des Ve-VIe s. recouverte par un épais couvert forestier au bord d’une baie. Après les travaux de déboisement, nous avons pu établir de nouveaux relevés de cet édifice qui, complété par de nombreux sondages, révèlent un grand nombre d’annexes latérales (sacristie, chapelles, etc.) et un important dispositif occidental. Le plan de l’église principal a été complété par ceux de deux autres édifices de culte pressentis et de vestiges dans la forêt correspondant vraisemblablement aux constructions monastiques. BUCEMA, travaux 2010
Responsables : Sébastien Bully (UMR ARTeHIS), Morana Čaušević-Bully (universités de Zagreb et Paris XII)
Participation de Laurent Fiocchi (APAHJ) 
Les sites :


Objectifs et résultats



[En savoir plus]
Prospections à Gigny et Baume-lès-Messieurs/ été 2011

Responsables : Sébastien Bully et Christian Sapin (UMR ArTeHiS) Dates de chantier : 4 au 8 juillet 2011 Les monastères carolingiens jurassiens de Gigny et Baume sont connus, notamment, pour être à l’origine de la fondation de l’abbaye de Cluny par l’abbé Bernon. Il subsiste de l’abbaye de Gigny essentiellement son église du début du XIe s., alors que Baume conserve une grande partie de ses bâtiments monastiques autour de sa grande abbatiale romane. Les deux établissements font l’objet de recherches suivies depuis plusieurs années à travers des sondages, des études d’archéologie du bâti et la constitution d’une nouvelle documentation en plan. Une première prospection géophysique par la méthode du radar-sol en 2003 avait révélé à Gigny l’existence d’une avant-nef disparue. Les prospections ont été poursuivies en 2010 et en 2011 sur les deux sites avec pour principaux sujets d’études les cloîtres (disparus), les états antérieurs aux abbatiales et l’hypothèse – non confirmée – d’un massif occidental à l’abbatiale de Baume. Les résultats attestent d’un important potentiel avec l’identification de nombreuses structures antérieures aux états actuels qui pourraient nous renvoyer, dans certains cas, à l’époque de l’abbé Bernon. Sur la base d’un sondage et des prospections géophysiques, une fouille programmée dans le chœur de l’abbatiale de Baume débutera au mois de novembre 2011. Lien BUCEMA : travaux 2003, 2007, 2008, 2009, 2010
Participation de Laurent Fiocchi (APAHJ), Christian Camerlynck et Virginie Cachier (unité Sisyphe-Paris VI), Marie-Laure Bassi (université de Franche-Comté)
Les sites :
Objectifs et résultats :



[En savoir plus]
Les fouilles médiévales du bois de Cestres, Saint-Martin du Mont (Côte-d’Or) / été 2011
Responsable scientifique du chantier de fouille : Patrice Beck (Pr, Université de Lille 3, UMR 8529 IRHIS) Collaborations d’ARTEHIS : Jean-Louis Maigrot (chercheur associé), (archéogéographie), Franck Faucher (IE Culture), Jean-Pierre Garcia (Pr UB), (archéomatériaux et géoarchéologie), Marion Foucher (doctorante) (archéomatériaux) La fouille des Bordes du bois de Cestres (Côte-d’Or) engagée en 2003 se poursuit cet été. Jean-Louis Maigrot (chercheur associé), (archéogéographie) Il s’agit de l’un de ces petits habitats isolés qui exploite au Moyen Âge les terres du plateau bordant au nord le Val-Suzon. Ce hameau, constitué de deux fermes (H2 & H3) accompagnées de jardins clos (H4), d’une vingtaine d’ares de superficie, d’un four à pain (H4c) et d’un vaste bâtiment (H1) dépend du domaine foncier de l’Abbaye de Saint-Seine. il s’agit peut-être des Bordes Gaudot que certains documents d’archives évoquent à partir de 1323 et déclarent comme désertées en 1417. Les fouilles de l’été 2011 sont consacrées d’une part à un nouveau bâtiment de 25 mètres de long situé à quelques dizaines de mètres du site principal. La destination de ce bâtiment et ses fonctionnalités sont encore à déterminer. Il comprenant 3 structures foyères et daterait, selon Patrice Beck, de la même époque que la borde. Origine naturelle ou anthropique de ce point d’eau ? Jean-Pierre Garcia reconstitue la série géologique locale : pierre de Dijon-Corton et marnes à digonelles dans laquelle est creusé le puits Gaillard. La nature du sous-sol et l’étude des brachiopodes (fossiles) présents dans certaines couches géologiques donnent des informations sur les différentes étapes de l’aménagement du puits et de la « vasque » et permettent d’en approcher la chronologie. Marion Foucher recherche quant à elle les traces d’outils nécessaires à l’extraction des matériaux et réfléchit à l’utilisation des matériaux extraits autour du puits et de la « vasque » en relation avec les 3 bâtiments de l’habitat principal : correspondent-ils aux différentes phases de construction de l’habitat ? Quelle économie des matériaux peut-on en déduire ? Leurs compétences en géoarchéologie et leur connaissance des matériaux géologiques utilisés participeront, une fois les relevés complets réalisés, à la compréhension de la gestion des ressources en matériaux et en eau dans l’économie générale de ce site de la fin du Moyen Âge. Jean-Louis Maigrot travaille à l’analyse archéogéographique du site. La démarche vise à restituer l’évolution, sur le long terme, de l’organisation du territoire dans lequel s’insère la « borde » en cours de fouilles et de mettre en évidence la logique spatiale qui a présidé à son installation. Un modèle prenant en compte les effets territoriaux des pratiques agraires anciennes et construit à partir de l’analyse du parcellaire napoléonien, des missions aériennes du début des années 1950 et de la carte d’état major, montre l’importance du réseau viaire comme instruments privilégiés de la création du territoire. Les chemins sont envisagés à un temps « t » à travers leur architecture générale en référence à leur appartenance à une structure agraire englobante. Dans le détail, la manière dont ils se disposent, leurs interconnections, en particulier avec le réseau mis en évidence par le LIDAR, nous éclairent sur la dynamique de l’occupation des sols. Le modèle confronté aux données de terrain permettra de tester l’organisation de l’espace rural actuel et ancien et l’impact des activités humaines induites par ce site éphémère du XIVe siècle.
Une équipe de 12 fouilleurs participe au chantier durant le mois de juillet 2011.
Responsable scientifique du chantier de fouille : Patrice Beck (Pr, Université de Lille 3, UMR 8529 IRHIS)Collaborations d’ARTEHIS :
Franck Faucher (IE Culture)
Jean-Pierre Garcia (Pr UB), (archéomatériaux et géoarchéologie)
Marion Foucher (doctorante) (archéomatériaux)Les bordes du bois de Cestres, Saint-Martin-du-Mont :
L’enquête pluridisciplinaire engagée à partir de 2003 étudie non seulement l’habitat déserté qui émerge toujours des broussailles dans la parcelle forestière n° 15 des Bois de Cestres mais aussi l’environnement tant « naturel » que socio-économique dans lequel il s’insère et qu’il a contribué à modeler. Elle exploite tant les vestiges archéologiques que les documents écrits et cartographiques, elle explore aussi bien les données géologiques et hydrologiques que pédologiques et phytosociologiques.Fouilles de l’été 2011 : les aménagements périphériques, le four à chaux et le puits Gaillard
A proximité, un four a chaux plus ancien (Xe-XIe s.) est également en cours de fouille.
Enfin, à 350 mètres du hameau, un puits, connu sous le nom de puits Gaillard ainsi qu’un point d’eau (la « vasque ») le jouxtant sont explorés.Le puits Gaillard : étude géoarchéologique et étude des matériaux
Fonctionnement hydrologique du puits ?
Phasage chronologique des aménagements du puits Gaillard en regard de celui du site ?L’archéogéographie du site
Les fouilles de Bibracte / été 2011

Fouilles de la Côme Chaudron, PC 14 « Parc aux chevaux », Le Theurot de la Roche : étude géoarchéologique Responsables : Tomasz Bochnak (Université de Rzeszów, Pologne), Petra Golanova (Université de Brno, République Tchèque) Les fouilles de la Côme Chaudron, initiées par Jean-Paul Guillaumet, se poursuivent cette année dans un cadre européen. La campagne 2011 a pour priorité la poursuite du dégagement de la façade sur rue du complexe de bâtiments caractérisé ces dernières années Une équipe de fouille franco-belge PC 14 se présente comme une grande plate-forme artificielle d’environ 2000 m2 délimitée par 3 murs de pierre. L’objectif de la fouille 2011 est d’explorer sur une grande surface (la moitié de la surface ouverte) les niveaux d’occupation antérieurs à la construction des murs de pierre. Il s’agit de comprendre l’occupation de cette vaste aire qui semble délimitée d’abord par des poteaux en bois puis remplacés, suivant le même plan, par des murs. Equipe franco-suisse (Université de Franche-Comté, Université Paris IV, Université de Lausanne) L’excavation a mis au jour un puits parementé. Jean-Pierre Garcia et Marion Foucher ont pu déterminer les matériaux présents dans et autour du puits dont la fouille n’a pas encore atteint le fond.
Fouilles de la Côme Chaudron
Participation de : Gilles Hamm
Dates du chantier : du 28 juillet au 02 septembre 2011Le site
Le site constitue un quartier spécialisé d’ateliers de bronziers et de forgerons surplombant une exploitation de minerais métalliques à ciel ouvert. Il convient de déterminer les types d’ateliers qui s’y trouvaient et d’appréhender leur évolution dans le temps, de la création de Bibracte à son abandon.La fouille de l’été 2011
Cette dernière année du chantier met en évidence plusieurs phases d’occupation augustéenne. Des zones d’habitat et des ateliers artisanaux précédant la mise en place de la voie principale de l’oppidum se succèdent, témoignant d’une évolution rapide du site. La chronologie de ces différentes phases reste à préciser. Les fouilleurs ont également pu faire apparaître une fosse à amphores peu fragmentées dont l’interprétation est à rechercher : cave ? Rejet ? Dépôt ?

PC 14 « Parc aux chevaux »
Responsables : Daniele Vitali (université de Bourgogne / UMR ARTeHIS), Laurent Bavay (Université Libre de Bruxelles, Belgique)
Campagne de 6 semaines
Participation d’étudiants de l’Université de BourgogneLe site
En 2010 la campagne de fouille a permis d’achever l’exploration des structures associées au dernier état d’aménagement du secteur, dans l’emprise ouverte depuis 2005. Le mur de soutènement nord de la plateforme PC 14 est maintenant dégagé sur une longueur de 21 m. Deux contreforts en granite, espacés d’environ 8 m, participent à la monumentalisation de sa façade bordant la voie qui mène au Theurot de la Roche. Il apparaît aussi que la plateforme préexistait à la mise en place du mur de terrasse.La fouille de l’été 2011
La campagne de cette année se concentre sur la moitié nord du secteur 3 en vue de mieux définir les différentes occupations et d’appréhender l’évolution du bâtiment.
Il semble qu’antérieurement à ce vaste terrassement, le site corresponde à une occupation d’ateliers attestée par plusieurs foyers ainsi qu’une fosse riche en charbon et rejets métalliques. La présence de caves et de fosses à amphores, probablement utilisées comme remblais va également dans ce sens.
La poursuite du chantier en 2012 permettra d’approfondir la chronologie du site et de mieux comprendre la fonction de cette aire de terrassement.Le Theurot de la Roche : étude géoarchéologique
Responsables : Yves Luginbühl, Philippe Barral et Martine Joly
Etude géoarchéologique du site : Jean-Pierre Garcia et Marion Foucher
Le puits est entouré d’un cailloutis de rhyolite noire concassée perméable, exogène au site. Les pierres de parement sont jointoyées par un matériau très riche en charbon de bois aux propriétés assainissantes. Le puits contient quant à lui un argile étanche.
Ces données vont dans le sens d’une fonction de citerne de récupération d’eau de pluie drainée, filtrée et assainie via les différentes couches de matériaux avant sa réception au fond du puits. Sans exclure bien entendu d’autres utilisations ultérieures.
Les fouilles de Vix / été 2011

LES TRAVAUX DE RECHERCHE 2011 La fouille du plateau La campagne 2011 se concentre sur la fouille d’une maison de 27 mètres de long, située dans le grand enclos, devant le grand bâtiment absidial. Sa structure générale semble aller dans le sens d’un habitat de type absidial également (alignement des poteaux, lignes de fondation, fossé de palissade…). Frédéric Cruz procède au relevé topographique des structures du bâtiment sud-est du plateau à l’aide d’un tachéomètre. Laëtitia Huguet est responsable du secteur sud-ouest (angle) du grand enclos. Visant au départ à étudier le fossé longeant le grand enclos, la fouille révéla la présence de sépultures probablement d’époque mérovingienne (datation à venir) ainsi qu’une fosse-dépotoir d’époque antique.
Une équipe internationale :
Responsable du programme : Bruno Chaume
Le rempart de la levée 3 : équipe autrichienne (Université de Vienne)Responsables : Otto Urban Adjoint : Thomas Pertlwieser
Le rempart ouest : équipe suisse (Université de Zürich)
Responsable de la fouille : Philippe de la Casa
L’étude géoarchéologique : Responsable : Christophe Petit
Prospection sous forêt : habitats et parcellaires
Responsable : Dominique GogueyAdjointe : Ariane Ballmer
La fouille du plateau : équipe franco-allemande (Université de Bourgogne et Université de Kiel)
Responsables : Walter Rheinardt et Bruno Chaume
Participation de Frédéric Cruz et Laëtitia Huguet, doctorants d’ARTEHIS




Prospections et sondages à Annegray / été 2011

Collaboration franco-irlandaise Responsables : Sébastien Bully (UMR ARTeHIS) et Emmet Marron (université de Galway)Participation de Laurent Fiocchi (APAHJ), Roseanne Schott et Gerard Dowling (université de Galway) Le site : Objectifs et résultats : La prospection réalisée en 2010 avait permis d’identifier une vaste structure à double enclos quadrangulaire au pied de la butte sur laquelle se dressait l’église. La reconduction de la prospection par la méthode de la résistivité électrique a permis d’en affiner l’image et de découvrir d’autres structures archéologiques à l’intérieur ou en lien avec les enclos. Nous avons ensuite complété la prospection par l’ouverture d’un sondage de 3 x 7 m qui a démontré la présence d’une plateforme bordée d’un large fossé ; le mobilier associé est assurément antique en dépit de sa rareté. Ces premiers éléments plaident en faveur de l’identification du castrum dans lequel se serait établi Colomban, même si une poursuite des recherches est nécessaire afin de confirmer cette hypothèse.
Dates de chantier : 29 août au 16 septembre 2011
Le hameau d’Annegray sur la commune de la Voivre (Haute-Saône) est considéré comme ayant accueilli le premier monastère de l’Irlandais Colomban à la fin du VIe s. Des premières fouilles menées dans les années 1950 avaient révélé les vestiges d’une église romane et des sarcophages mérovingiens. C’est sur cette base que nous avons engagé une campagne de prospections par magnétomètre dès 2010 afin de tenter de localiser les structures du monastère précoce que l’hagiographie situe dans un « castrum [romain] ruiné que la tradition des anciens nommait Anagrates ».

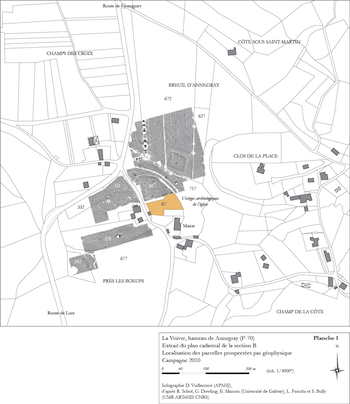
Prospection géophysique et sondages sur le site viticole gallo-romain de Brochon : « Bergis » et « Entre les ruisseaux » / septembre 2011
Resp. : Jean-Pierre Garcia En continuité du site « Audessus de bergis » de Gevrey Chambertin au sud, le nouveau programme de prospection thématique sur 3 ans, cherche à délimiter l’extension de la vigne gallo-romaine vers au nord et à connaître la significaiton de structures contigües observées en photographies aériennes, qui pourraient être rapportées à de possibles bâtiments d’exploitation. Une campagne d’imagerie géophysique extensive (électrique et magnétique) sur plus de 8 ha a permis d’explorer les deux lieux-dits de Brochon « « Bergis » et « Entre les ruisseaux ». Les résultats bruts qui sont encore en cours de traitement montrent effectivement des structures construites. Cette campagne a été complétée en 2011 par deux sondages de vérification. Ceux-ci ont mis au jour: – une longue haie dont le creusement contient du mobilier gallo-romain (clous de chaussures, céramiques) et de nombreux gastéropodes, montrant que la vigne gallo-romaine ne s’étendait pas vers le nord au delà de la limite de commune Gevrey/Brochon; – au moins un petit bâtiment en pierre de taille (de la Côte) immédiatement adjacent au vignoble gallo-romain; – des fosses-dépotoir du Néolithique moyen (riches en silex, argile rubéfiée, charbons, outils d’origine alpine etc) à mettre en relation avec celles observées à proximité lors des fouilles menées par l’INRAP en 2008. Les analyses post-fouille en cours vont préciser la chronologie et la significaiton de ce mobilier et de ces structures dans la perspective des opérations futures de 2012. photos Relevé théodolite laser pour la constitution d’un plan géoréférencé par GPS Extension de la fouilles : 3 secteurs Photos diaporamas site et fouille Matériel : céramique, charbon brûlé, éclats de silex
Participants : Florent Delencre, doctorant à l’UMR ARTeHIS, Ronan Steinmann, doctorant à l’UMR ARTeHIS, Emmanuel Chevigny, doctorant à l’UMR ARTeHIS1, 3 étudiants du Master 2 AGE (Archéosciences et Géo-Environnement)
Société Géocarta
Prospection géophysique : 1er et 2 septembre 2011
Sondages : du lundi 19 septembre 2011 au vendredi 23 septembre 2011.Objectifs de la prospection et des sondages 2011 :
Résulats de la prospection et des sondages 2011 :
Le site :
Les fouilles de Cluny / été 2011

Responsables : Christian Sapin (DR UMR 5594 ARTeHIS) et Anne Baud (MCF Université de Lyon II, UMR 5138 Archéologie, Archéométrie) Le site : La campagne de fouille 2011 s’inscrit dans le cadre d’une fouille programmée pluriannuelle de 3 ans. Cette première campagne se concentre sur la fouille de la chapelle Sainte-Marie attenante à la salle du chapitre (de Cluny II, Xe-XIe s.) ainsi que sur ce qui pourrait correspondre à une villad’époque carolingienne (VIIIe-IXe s.). Il s’agit de la reprise en partie des fouilles archéologiques entreprises par Kenneth J. Conant de 1928 à 1936. Objectifs de la fouille 2011 : La fouille devrait permettre de comprendre les relations entre la naissance de l’abbaye de Cluny et la « villa carolingienne » qui la précède, dont la dimension et la fonction de chaque espace restent à être préciser. Quel usage à l’arrivée des moines en 910 et quelle réutilisation des matériaux pour le monastère ?
Partenaires : université de Lyon II, Centre d’études médiévales d’Auxerre
L’équipe : Archéologues et dessinateurs du Centre d’études médiévales et étudiants en formation des universités de Lyon II, Paris X, et Liège.
Collaborations d’ARTEHIS : Fabrice Henrion, chercheur associéStéphane Büttner (étude des matériaux), chercheur associé
Dates du chantier : du 5 septembre au 20 octobre 2011
Extension de la fouille 2011 : 8 mètres sur 20 mètres. La campagne de fouille 2012 sera consacrée à l’étude de l’autre moitié du site, d’environ la même surface.

Quel lien unit la chapelle Sainte-Marie à la salle du chapitre ?
La chronologie du site sera établie via l’étude stratigraphique des murs et niveaux de circulation. L’étude des matériaux permettra de répondre aux interrogations quant aux réemplois ou non de certains éléments pour la construction du monastère.


Salins-lès-Bains (Jura) : le camp du Château / campagne 2011

Responsable du chantier : Philippe Gandel : Chercheur associé à l’UMR ARTEHIS Depuis 2002, un programme de recherche pluridisciplinaire est engagé sur les sites de hauteur de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge dans le département du Jura. Des fouilles programmées ont été effectuées en juillet-aout 2011 sur le site du plateau de Château-sur-Salins, correspondant à une éminence aux versants abrupts dont le sommet se compose d’une surface tabulaire d’environ vingt hectares Elle est localisée à l’entrée sud de la reculée qui conduit à la ville de Salins-les-Bains. Les prospections effectuées sur ce plateau ont permis de déterminer deux secteurs occupés dans la fourchette chronologique Ve – VIIe siècles. L’élément le plus visible de la dernière phase d’occupation est un système défensif partiellement implanté à l’emplacement de la citadelle hallstattienne. Les sondages entrepris montrent qu’il s’agit d’un mur construit au mortier de 1,3 m qui se prolonge sur plus de 170 m, jusqu’à la rupture de pente du versant nord. Plutôt qu’un arc de cercle sur à-pic, cette fortification serait de type éperon barré, avec un premier pôle d’occupation accolé au rempart et un second à 800 m, à l’emplacement d’un monastère médiéval occupé jusqu’à la fin de la période Moderne. La construction, entourée sur trois côtés par des galeries dissymétriques, occupe une superficie de 260 m2 (18 m par 15 m). La chronologie de l’occupation est encore mal fixée, elle s’inscrit dans une fourchette Ve-Xe siècles. Des éléments de vitraux ont fait l’objet d’analyses physico-chimiques montrant qu’il s’agit d’un groupe de verre au natron produit à partir de sable de la côte syro-palestinienne, à la fin du VIIe siècle-début du VIIIe siècle. Elles sont constituées de deux coffrages naviformes accolés. La sépulture 1 se distingue par l’emploi de dal-les de couverture et par un fond au mortier de chaux. L’emploi de coffrages naviformes se rencontre du VIIe au XIe siècle dans le massif jurassien et se trouve systématiquement associé à un lieu de culte. A ce stade de la recherche aucune interprétation globale du site ne peut être avancée. L’absence de données sur l’autre pôle occupé du plateau, sous les vestiges du prieuré clunisien de Château-sur-Salins, ne permet pas encore d’étayer d’hypothèses. La poursuite des recherches devraient permettre de mieux éclairer la fonction et la place de cet établissement.
Date du chantier : Juillet-août 2011
Participation de : David Billoin, chercheur associé à l’UMR ARTEHIS
Le secteur dénommé Camp du Château est situé dans la partie centrale du plateau, autour de son point culminant (626 m). Cet espace d’environ 7000 m2 a fait l’objet de fouilles par des protohistoriens au cours du XXe siècle. C’est sur ce secteur que portent les recherches actuelles qui se focalisent sur la phase d’occupation de l’Antiquité tardive et du haut Moyen-Âge jusqu’alors peu prise en considération.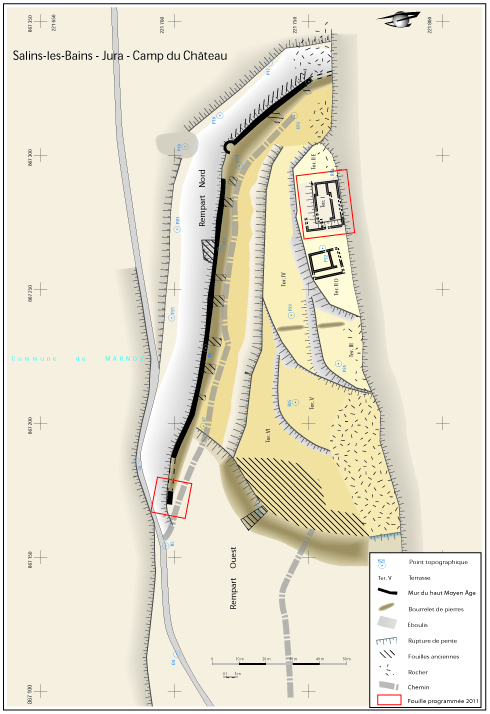
Sur la terrasse sommitale bordant le versant sud, un bâtiment quadrangulaire sur solins, aux dimensions extérieures de 9,76 m par 11,63 m, subdivisé en 3 pièces, a été mis en évidence. La céramique présente sur les sols en terre battue permet de dater l’occupation du VIe siècle. La fonction précise de cette construction reste à déterminer. Le type d’architecture et le plan se distinguent des habitats régionaux du haut Moyen Âge, généralement sur trous de poteaux, avec des élévations en terre et bois, à usage agropastoral. Certaines catégories de mobilier, notamment la verrerie et des petits objets, indiquent un statut social relativement élevé des occupants.
En 2011, toujours sur la terrasse sommitale, un édifice religieux à chevet plat a été identifié.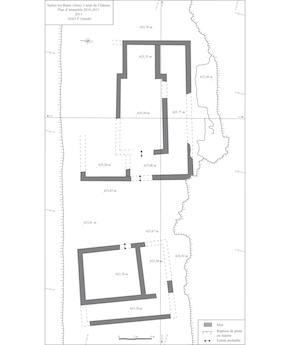
Des sépultures sont identifiées dans l’espace intérieur et la périphérie immédiate de la construction. Deux d’entre-elles ont été fouillées en 2011 dans la galerie latérale ouest.
Dans le département du Jura, aucun édifice religieux du haut Moyen Âge n’avait été mis en évidence sur des sites de hauteur, bien que l’existence d’une église soit probable sur le Camp de Coldres à Briod, dominant la reculée de Conliège. Leur présence est largement mieux attestée dans la région Rhône-Alpes, en Provence ou en Languedoc. Les tombes repérées, occupant la nef, le chœur et les galeries assurent du rôle funéraire de cette église. L’une des particularités est la mise en scène topographique dont a fait l’objet cet édifice, implanté au point culminant du plateau, dans un souci d’être visible dans un très large rayon.
Le Castelet (Fontvieille, Bouches-du-Rhône) / campagne 2011

Equipe : L’histoire du Castelet semble suivre de près celle de l’agglomération d’Arles, et reste intrinsèquement liée à celle du territoire des Alpilles et du Rhône. Fondé dès le tout début du VIe siècle avant notre ère (voire la fin du VIIe siècle) mais fréquenté depuis le Néolithique final, l’oppidum du Castelet a développé, au contact des premiers commerces méditerranéens –étrusques, grecs, italiques et ibériques- un faciès original où se côtoient très vraisemblablement population indigène et population grecque ou grécisée. Du milieu du VIe siècle à la deuxième moitié du Ve siècle, l’oppidum va connaître son apogée pour ensuite décliner progressivement, à l’instar d’Arles, aux alentours de 300 avant notre ère. Avec le monopole italique sur la Méditerranée, le site du Castelet reprend son activité (peut-être un rôle de relais entre la vallée du Rhône et le terroir des Alpilles), pour être finalement abandonné vers 50 avant notre ère. En revanche, l’occupation de bas de pente perdure au-delà du changement d’ère (Ier-IIe s. de n.è.), et semble fréquentée au cours du Bas Empire. L’oppidum du Castelet – fouillé entre 1953 et 1975 par Louis Poumeyrol- a été l’objet d’une campagne de prospections pédestres en septembre 2008, visant à reconnaître et estimer l’occupation de bas de pente préalablement détectée par le fouilleur. À la suite de cette première opération de reconnaissance, trois sondages ont été ouverts en 2009, l’un portant sur une concentration isolée lors des prospections pédestres, les deux autres sur une zone mentionnée par L. Poumeyrol et présentant en surface de très nombreux vestiges céramiques. Ces ouvertures ont permis la mise au jour des premiers niveaux d’occupation en place, à priori datables des IIIe-IIe siècles avant notre ère. La réunion de ces deux sondages, en 2010, a été l’occasion de mettre en évidence 3 espaces distincts, délimités par des murs. Des structures plus récentes, deux fosses, sont datables par le mobilier des Ier et IIe siècles de notre ère. L’une d’elle a notamment livré des fragments d’amphore (bétique, tarraconaise), une pilette d’hypocauste, un fragment de lampe à huile du type I de Loeschcke, de l’opus signinum,…
• Responsable du chantier : Martin-Kobierzyki Elodie (Centre Camille Jullian, UMR 7299, Aix-Marseille Université)
• Direction scientifique : Julie Clerc (ARTeHIS, UMR 6298, Université de Bourgogne).
• Topographie, MNT : Vincent Dumas (Centre Camille Jullian)• Prospection géomagnétique et analyse de susceptibilité magnétique : Yoann Quesnel et Pierre-Etienne Mathé (CEREGE, UMR 6635, Technopole de l’Arbois)
Avec la collaboration de :
• Le Service Régional de l’Archéologie Provence-Alpes-Côte d’Azur.
• Le Musée Départemental de l’Arles Antique.
• La Mairie de Fontvieille.
• Le CCJ.
• Le LAMM.
La campagne 2011, de courte durée, s’est concentrée sur les espaces dégagés en 2010 et sur deux extensions pratiquées au sud et à l’est. Les différentes structures mises au jour et fouillées (banquette en pierres sèches, niveaux de sol et rechapes, sole en argile) et les vestiges (meule en basalte, pressoir en calcaire) nous permettent d’envisager une vocation domestique et/ou artisanale de ce secteur. Le matériel recueilli dans ces différentes couches est en général très fragmenté et reste relatif au deuxième âge du Fer. Le mobilier plus ancien (VIe-Ve s.) est également très présent dans ces niveaux, laissant présager l’existence de couches d’époque archaïque.
La prochaine campagne se concentrera sur ces espaces dégagés afin de proposer une meilleure caractérisation de ce secteur et d’établir une chronologie plus fine de cette occupation de bas de pente.
Tavaux (Jura) : programme de recherches sur les nécropoles gallo-romaines du finage dolois, Tavaux (39) : les terres Saint-Gervais / campagne 2011

Responsables du chantier : Gérald Barbet, Chercheur associé à l’UMR ARTEHIS Si depuis plus de vingt années, des recherches archéologiques sont effectuées régulièrement sur la plaine appelée « Finage » et plus particulièrement sur le secteur de Dole – Tavaux, les travaux actuellement engagés par notre équipe pluridisciplinaire sur cette région portent sur l’étude des nécropoles antiques. La mise au jour à l’entrée nord de la commune, d’une nécropole de type familiale (nécropole I, au lieu dit : « Les Charmes d’Amont »), entourée par une enceinte et comprenant 25 sépultures à crémations, ainsi que 62 sépultures de périnataux en imbrex apporte des données nouvelles sur la population de ce secteur. En effet, une tombe fondatrice dont la datation se situe entre l’année 40 et l’année 60 de notre ère y a été mise au jour. Les études post-fouilles ont permis de confirmer qu’il s’agit de la sépulture d’un légionnaire, porte-enseigne ou plus probablement d’un bénéficiaire. La situation de sa sépulture au centre d’une nécropole familiale, pourrait indiquer sa position de chef de famille, probablement devenu ou redevenu propriétaire de terres faisant partie d’un domaine agricole de type villa. La découverte d’une nouvelle nécropole livrant également plusieurs indices de présence militaire a été localisée à la sortie sud de Tavaux dans un terrain agricole subissant d’importants préjudices du fait de labours récents et profonds (sous-solage) : Nécropole II au lieu dit « Les Terres Saint-Gervais ». Les travaux archéologiques effectués depuis de 2007 ont déjà permis d’étudier 109 structures, composée de crémations, d’inhumations d’adultes et de périnataux. Cette nécropole présente un panel caractéristique de la population qui vivait dans cette région entre 100 avant J.C et les années 180 après J.C. Ces recherchent permettront à terme d’apporter des informations sur la vie quotidienne, l’état de santé, l’alimentation, les carences, les causes et âges des décès … Nous tenterons aussi de comparer les textes antiques faisant état de révoltes de la population et d’interventions militaires, avec la découverte d’un matériel militaire caractéristique, comme des fragments d’armures, de harnachement, mais surtout de nombreuses armes ; lances, pointes de flèches, épées, balles de frondes et aussi d’armement lourd, comme des boulets et des pointes de traits utilisées par des machines de guerre ; catapultes, balistes… Une étude particulière est également en cours. Elle concerne la mortalité chez les nourrissons (périnataux) et sur les offrandes caractéristiques qui leurs sont associés. Outre les différents rapports sur nos travaux, une première monographie est en phase finale de rédaction.
Campagne 2011




Prospections subaquatiques dans le Doubs entre Saunières et Sermesse / campagne 2011

Nom de l’opération : Prospections subaquatiques dans le Doubs entre Saunières et Sermesse Les prospections subaquatiques menées en 2011, entre les communes de Sermesse et de Saunières, dans le prolongement de la zone investiguée en 2009 puis en 2010, ont permis de découvrir quatre nouveaux ensembles de pieux et de piquets en bois. Leur position dans le chenal et leur configuration permet de les attribuer soit aux restes de pièges à poissons, soit aux vestiges de digues destinées à diriger l’eau sur un moulin flottant. Ces deux activités ayant existé sur une longue durée dans ce secteur (périodes médiévale à contemporaine), les deux hypothèses sont à considérer. Seule une étude plus précise (décapage et sondages), et la découverte de mobilier associé, permettraient de conforter l’une ou l’autre de ces hypothèses. Le premier ensemble comprend 71 pieux verticaux formant plusieurs lignes prolongeant des groupes de pieux topographiés en 2011 et datés par 14C dans la fourchette 1448-1634. Cinq analyses effectuées sur les bois découverts en 2011 confirment le rattachement de cette structure à l’époque moderne, entre le XVe et le XVIIe siècle. Le second ensemble, localisé très près de la rive gauche, est formé de 93 pieux au total. Une ligne de pieux, longue de 57 m, parfois doublée par des pieux plantés de part et d’autre (renfort et réparation probables), est disposée en oblique depuis le chenal en direction de la berge. Elle forme un angle peu ouvert avec un autre groupe de pieux dont une partie est disposée parallèlement à la rive (fig. 1). Cinq datations radiocarbone permettent de placer le fonctionnement de cet aménagement entre le XVe et le XVIIe siècle. Le troisième ensemble de pieux est également très près de la rive gauche. Il est constitué de 84 pieux répartis en trois groupes qui forment, malgré des interruptions, un alignement légèrement oblique partant de la berge et allant en direction du chenal. A l’extrémité aval de cette structure, une meule entière (fig. 2), plusieurs fragments de meules et un gros bloc quadrangulaire percé en son milieu ont été découverts, ce qui laisse penser à une digue destinée à canaliser l’eau sur un moulin flottant. Un retour sur ce secteur permettra de dégager ces meules afin d’en faire un relevé précis, et de vérifier la présence ou l’absence d’épaves. Ces meules peuvent correspondre à des rejets effectués depuis le moulin flottant alors qu’il fonctionnait encore. Le moulin aurait ensuite pu être déplacé et les meules rejetées seraient restées à cet emplacement. Leur étude permettra sans doute de dire si on est bien en présence de meules usagées devenues inutilisables. Six pieux ont été datés par 14C : ils attestent la mise en place de ces lignes de pieux entre la fin du Xe s. et la fin du XIIe siècle. Parallèlement aux recherches subaquatiques, une prospection au sonar à balayage latéral effectuée par Jean-François Mariotti (Ministère Culture, SRA Poitou-Charentes) a permis de localiser vingt-trois anomalies entre Pontoux et Les Bordes, près de la confluence avec la Saône, qui devront faire l’objet de vérifications en plongée. Plusieurs images montrent nettement des concentrations de blocs, une probable pirogue ainsi qu’une anomalie ressemblant à une épave. La campagne 2011 a confirmé la richesse du chenal du Doubs entre les communes de Sermesse et de Saunières. Les vestiges découverts se rattachent, pour le moment, aux époques médiévale, moderne et contemporaine (début XIXe s.). Cependant, la présence contre la rive droite d’indices d’époque gallo-romaine, ainsi que les découvertes anciennes liées aux dragages, laissent augurer de possibles futures découvertes se rattachant à cette période. Grâce au recours à différentes méthodes d’investigation, prospection subaquatique systématique d’une portion de chenal dans des couloirs balisés, investigation au sonar, et recherche dans les archives, on a pu mettre en lumière le fort potentiel archéologique du lit du Doubs malgré les dragages qui l’ont touché.
Date : 2011
Responsable : Annie Dumont, Ministère de la Culture (DRASSM) et UMR 6298ARTEHIS
Participation de :Philippe Moyat, Claire Touzel, Michelle Hamblin, , Georges Lemaire (DRASSM), Sylvain Morgalet, Agnès Stock (Chrono-Environnement)
Le quatrième ensemble se trouve à une quarantaine de mètres de la rive gauche. Il est constitué de quatorze pieux disposés en deux lignes qui forment un V. A l’extrémité aval de cette digue se trouve un amas de briques et de tuiles provenant de la tuilerie de Navilly et datant du XIXe siècle (fig. 3). La Minute d’Etat Major, levée au 1 :40 000e au cours de la première moitié du XIXe siècle, montre qu’à cet endroit un moulin flottant était installé dans le chenal (fig. 4). C’est probablement ce moulin qui est cité dans deux documents d’archives retrouvés par Laurent Gourillon dans le cadre de son étude du moulin de Sermesse. Une datation sur un des pieux de la digue confirme son appartenance à la période contemporaine. Cette digue (ou benne) a probablement en partie été détruite par les dragages. Il est possible que l’amas de tuiles et de briques corresponde à la cargaison d’un bateau qui aurait fait naufrage en ce point après avoir accroché et déchiré sa coque sur les pieux qui formaient un écueil important au moment des basses eaux.